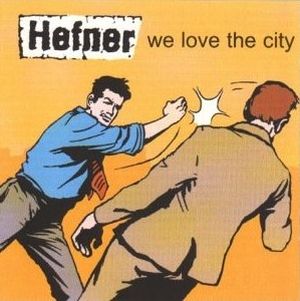La scène se passe dans un bar, au comptoir : le mec me dit qu’il est un spécialiste de rock des années 90, fanfaronne un peu, il dit qu’il adore Pavement et les Pixies. Intérieurement, je pouffe. Oh, l’occasion est trop belle, et je suis sûr de moi : j’ai trop hâte de lui dire ses cinq vérités sur le slowcore et ses groupes pourraves, la britpop plus obscure, les productions Shimmy Disc, tout ça tout ça. J’attaque : “Tu connais Octopus, des Écossais qui ont enregistré un album fabuleux, dansant comme du Pulp mais fin comme du Zombies ?”, non qu’il me répond, pris à revers. “Et tu connais Blueboy d’Unisex, délicat et foisonnant comme un jardin bien entretenu ?”, non qu’il me répond, déjà un peu contrarié. “Et tu connais Lida Husik, une New-Yorkaise qui faisait des petites chansons pop conçues comme des films d’horreur schématiques ?”, non qu’il me répond encore, cette fois sur la défensive, un pas en arrière. Mon orgueil gonfle, me voilà qui enchaîne les uppercuts et énonce comme un paon les Beulah, bim, les Chamber Strings, bam, Sun Dial, bing, John Cunningham, paf, et, croyant tenir la botte fatale : “Et tu connais les Gerbils ?”, encore une fois si sûr de moi. “Oui je connais les Gerbils, mais est-ce que tu connais Hefner, qui leur ressemble ?” qu’il me décoche. Du tac au tac. L’enfoiré ! J’avais baissé ma garde, mais voilà que ma mâchoire est emportée par un direct, soufflée putain. Le sourire change immédiatement de camp. Décroché de mon piédestal, vaincu comme Goliath, je m’effondre, et tente la parade “Non, mais je suis sûr que c’est de la merde”, tout en expliquant que, si ce n’est pas arrivé à mes oreilles, c’est que ça ne les mérite pas. Je suis à bout de souffle, les larmes me montent aux yeux, et groggy sur mon tabouret, j’avale ma bière en manquant de vomir. Bordel, j’ai été ridiculisé. Je rentre chez moi : c’est quoi Hefner ? Sans doute un de ces groupes merdiques comptant deux ploucs fans dans le monde entier car ils ont acheté un CD par hasard quand ils étaient adolescents, et cela leur rappelle à présent trop de choses de leur propre histoire pour qu’ils soient proprement objectifs. Allez, j’écoute le premier morceau que me propose la célèbre plateforme de vidéos au logo rouge : We Love The City. Vite, la pub, dégage, “Ignorer les annonces”, click click click, plus vite merde. La chanson commence, un bruit de train se fait entendre, une voix nasillarde maugrée “This is London, not Antarctica, so why don’t the tubes run all night ?”, et là, illumination blanche, le ciel s’éclaire et disparaît, les murs s’écroulent, le monde se désagrège. Le reste, je ne me le rappelle plus.
Hefner est un groupe, certes, mais tout se joue autour de la personne de Darren Hayman, originaire de l’Essex, qui rencontre le batteur Antony Harding en 1992. Petit détail qui aura peut-être son importance : Hayman n’a pas vraiment la gueule du gendre idéal. Il a une bouche immense (sur les photos, il se la cache souvent avec la main), est petit, frêle, et parle trop. Il souffre d’un lourd handicap : il est moche. Ce n’est que pure présomption, mais il ne serait pas étonnant qu’il ait passé sa jeunesse dans un profond état de frustration sexuelle… et bien évidemment, cela va alimenter sa musique. Attiré par la capitale britannique, la formation se trouve d’ailleurs un nom, Hefner (Hugh possédait, lui, toutes les femmes dont Hayman rêvait), évolue peu rapidement, et ne sort un premier single qu’en 1996, Another Better Friend. Le bouche à oreille fait son œuvre, et Hefner est signé par Too Pure. Le label est alors un des moteurs de la musique anglaise indépendante des années 90, et compte une star dans ses rangs, PJ Harvey, mais aussi quelques seconds couteaux qui ont leurs fans : Stereolab, Pram, Jack notamment. Hefner va, sous cette image “underground” de leur label, sortir un single nerveux, rappelant le Radiohead des débuts, mais aussi avec des voix étouffées à la Orgasm Addict, le très réussi Pull Yourself Together. Le style est pop, abrasif, et mêle l’intensité à de vraies intentions mélodiques. Les textes ne manquent pas de verve non plus : “And all your favorite authors, who wrote all your favorite books, which had all your favorite words, they do nothing for you now”. Un petit succès d'estime se concrétise, et à partir de là, la machine est lancée, et Hefner n’a plus qu’à dérouler. Le premier album, sous une pochette à la Roy Lichtenstein, s’intitule Breaking God’s Heart, sort en 1998, et marque le style du groupe, et surtout, la personnalité de Hayman.
A l’écoute, Breaking God’s Heart est pourtant encore un coup d’essai : il semble vite enregistré, pauvrement mixé, n’est pas toujours très bien joué, contient un morceau qui n’est rien de plus qu’une démo (le pénible Tactile), et, track by track, révèle un trop grand écart de qualité et pas assez de professionnalisme pour être pleinement convaincant. Mais il est intéressant, car, a posteriori, il contient tous les germes de la recette Hefner, et possède déjà des chansons étincelantes : il ne faut pas plus d’une écoute pour être emporté par la puissance et la ferveur de The Sweetness Lies Within, Love Will Destroy Us In The End, God Is On My Side (emmené par un drôle d’enthousiasme), et surtout le soufflant Eloping, nerveux, intense, très prenant. Hayman signe des chansons qui sonnent souvent punk, mais sans la rapidité inhérente au genre, et écrit des textes troublants, parfois poussifs mais révélant la fragilité et la frustration d’un homme mal dans sa peau. Il est souvent question dans toutes ces chansons de désir inassouvi, de réconfort sexuel, de séparation, de jalousie, de déception. A ce titre, Breaking God’s Heart se fait le fils spirituel du premier album éponyme des Violent Femmes. N’y voyez cependant qu’un parallèle stylistique : le premier opus de la bande de Gano est nettement supérieur à celui de la troupe de Hayman. Mais, aussi bien dans leur esprit que dans leur vigueur, les deux disques se rejoignent, au détail près de la guitare électrique. Clin d'œil au boxeur du comptoir : oui, effectivement, on pense aussi parfois aux Gerbils.
Au même moment, Hefner écrit et réenregistre des chansons à la pelle, qu’il sort en singles pour certaines (Christian Girls, Hello Kitten, Lee Remick, Goethe’s Letter to Vic Chestnutt, établissant la culture certaine de Hayman), truffe dans un second opus pour d’autres. Très vite, c’est au tour de The Fidelity Wars de voir le jour. Hayman en fait presque un concept album : chaque titre tourne de près ou de loin autour de la déception amoureuse, de la fin du couple et de ses conséquences (y compris une forte propension à l’alcoolisme). Début 1999, Hefner sort The Hymn For The Cigarettes en single, en guise de prélude à l’album. C’est un vrai succès pour le groupe, mérité, car il trouve ici son premier vecteur de réussite commerciale. Si vous deviez commencer par écouter un titre de la discographie de Hefner, ce devrait être celui-ci, car il est mélodieux, hargneux, bien construit, teigneux et pessimiste. Il contient, de surcroît, la plus belle ligne de tous les textes de Hayman : “How can she love me if she doesn’t even love the cinema that I love ?”. Car, c’est vrai, les choses tiennent parfois à ce genre de détails…
The Fidelity Wars n’est pas bien supérieur à Breaking God’s Heart, car, à nouveau, il est trop inégal. Il est bien mieux produit, le début est excellent, mais la suite plafonne, avec des ballades plaintives agaçantes et une tendance à la sur-écriture. Il est néanmoins l’album illustrant le mieux les forces et les faiblesses de Hefner, et il est, de ce point de vue, une pierre nécessaire à l’édifice global, on ne peut comprendre la discographie complète sans celui-ci. Hefner n’est pas très bon à l’exercice des morceaux acoustiques, Hefner manque de concision, Hefner est souvent geignard, Hefner a pour seule thématique la frustration sexuelle, mais Hefner est génial dans l’art du crescendo, Hefner dit des choses qui frappent, Hefner sait signer des morceaux merveilleusement intenses (ce seul mot les décrit parfaitement), Hefner possède une identité unique. On peut regretter les poussives Every Little Gesture, We Were Meant To Be, ou Don’t Flake Out On Me, sur lequel chante horriblement Gina Birch, l’horrible meneuse des horribles Raincoats (tout se recoupe), mais si c’est le prix à payer pour s’émerveiller de choses telles que le très menaçant et épique May God Protect Your Home, le tendu I Took Her Love For Granted, l’impressionnant I Stole A Bride, ou le paradoxal I Love Only You, alors peut-être le sacrifice en vaut-il la peine. Ce dernier morceau annonce également les grandes transformations : Hefner y affiche un groove inédit et une tentation pour le studio que les morceaux précédents n’avaient jamais évoqués. Hayman espère-t-il d’autres lendemains ?
Dans un timing très serré, Hefner sort un petit et excellent EP, compilation de titres qui n’étaient pas présents sur les albums (préférez néanmoins la version single de Christian Girls à celle de cet EP), et prépare un an tout pile après The Fidelity Wars un nouvel album : ce sera We Love The City, le chef-d'œuvre du groupe. Cette fois, Hefner ne se repose plus sur de vieux morceaux réenregistrés pour l’occasion, et doit composer de nouvelles pistes. L’écart entre ce disque et les précédents sera aussi grand que celui que les Beatles franchiront entre Rubber Soul et Revolver : finies les chansons enregistrées en une prise, finis les morceaux où l’énergie permet de compenser le manque de rigueur, fini l’amateurisme.
Dès l’ouverture éponyme, c’est un orage électrique qui s’abat sur la mélodie, pour un final anthologique qui rendra à leurs amours juvéniles les plus fervents adorateurs de The Bends. Puis Hayman se révèle adulte, montre qu’il sait aussi calmer le jeu, et que ses influences, des Kinks à la soul, sont vastes. Plus apaisé, le Britannique compose des morceaux dont la variété mélodique et instrumentale marquent un nouveau départ : les trompettes de Good Fruit et du mordant The Day That Thatcher Dies, les flûtes finales de The Cure For Evil, et surtout, la présence de chœurs faisant de chaque refrain d’entêtantes célébrations (assurés par Amelia Fletcher, une icone de la scène indé : Talulah Gosh, Heavenly, et des apparitions un peu partout), illustrent les nouvelles qualités pops du groupe, ici à son sommet, capable de groover sur la mort espérée de Thatcher comme de conter une histoire d’amour contrarié au son des radios londoniennes (The Greater London Radio, dont Ray Davies n’aurait pas renié le refrain). Le parallèle avec les Kinks n’est d’ailleurs pas déconnant : chaque chanson est aussi, à sa façon, une petite histoire douce-amère, de l’amour serein - mais pas trop - de Hold Me Closer au récit désenchanté de She Can’t Sleep No More. Hayman chante sur We Love The City le blues du citadin de trente ans, celui qui sait que sa jeunesse est passée et que le moment est de se ranger, moins parce qu’il est heureux que parce que c’est l’usage. A chacun de trouver sa voie dans cet album, entre espoir et fatalité, entre acceptation déçue et sérénité : il parle à tous, y compris à celui qui regrettera l’électricité des deux premiers. Même à son plus apaisé, Hayman reste un colérique, et il y a toujours des montées en puissance bien de chez lui ici.
Comment n’en avez-vous jamais entendu parler, vous qui connaissez les discographies de Blur et Supergrass sur le bout des doigts (on nage dans les mêmes époques et styles), et prétendez que le temps des plus grandes découvertes de mélomane sont derrière vous ? Je n’avais pas non plus de réponse lorsque j’étais dans ce bar. Mais peut-être se trouve-t-elle dans l’historique du groupe : en cinq ans très ramassés, Hefner va enregistrer quatre albums, plusieurs EP, une quantité mirobolante d’inédits qui paraîtront ensuite sur la compilation Catfight et sur des rééditions, pour au total entre cent et cent-vingt chansons. C’est trop, et pour les novices, difficile de savoir où commencer.
D’ailleurs, le quatrième album officiel, Dead Media, est intéressant, mais rend la discographie illogique : radicalement différent des précédents, il s’engouffre dans une direction plus électro, et fait régulièrement penser aux bidouillages minimalistico-proto-glam-post-Felt de Denim. Certes, il contient quelques très bonnes chansons : When Angels Play Their Drum Machines évoque ce que fera MGMT sur son album éponyme, Alan Bean est une folie sans égale, King of Summer est un beau stomp entraînant, et China Crisis et sa mélodie sinueuse n’auraient pas dérogé sur We Love The City (c’est la seule dans ce cas). Mais ce Hefner n’est plus le même. C’est d’ailleurs après cet album que Darren Hayman va scinder le groupe, pour poursuivre des milliers de projets solos, en groupe, lesquels sont si variés et en même temps si souvent proches de la personnalité de Hefner qu’il est encore une fois difficile de savoir par quel bout le prendre. Si un érudit pouvait se donner la peine d’éclairer le chemin…
Certes, Hefner n’est pas le plus grand groupe de tous les temps, et aucun de ses albums ne pourrait justifier d’être un classique absolu (même s’il ne manque pas grand-chose à We Love The City). Mais quelle identité… Mises bout à bout, ce serait près de vingt chansons énormes que l’on pourrait aligner, et surtout, ces chansons sont des chansons de Hefner, et aucun autre groupe n’aurait pu prétendre les enregistrer. La patte de Darren Hayman, la couleur de ces pistes, la frustration qui en suinte, la colère, la quête, le charme qui en émanent touchent profondément. Vingt chansons, c’est vrai, cela peut paraître peu. Mais posez-vous également la bonne question : de combien d’artistes et de groupes conserveriez-vous un best-of absolu allant jusqu’à vingt chansons ? Soyez honnêtes : passés les Beatles et les Kinks, il n’y en a pas tant. La conclusion est irrémédiable : Hefner est définitivement un de ceux qui comptent. Dernière chance de vous en persuader ? Ecoutez un peu Painting And Kissing, peut-être le morceau le plus brillant de Hayman, dans lequel il narrait une histoire d’amour vouée à l’échec, en créant l’exploit, avec si peu de choses, de la placer dans un contexte géographique et temporel tangible, de faire interagir deux personnages immédiatement campés, d’y projeter Londres en toile de fond, de donner du corps à la déception, de faire preuve d'auto-dérision, et d’écrire des choses si simples et pourtant si vraies sur les hommes, le quotidien, la vie, tout ça quoi.
On March the 23rd, She Said Something So Absurd,
She said : “You love to be in love, but you never really love.”
She said : “You love to be in love, but you never really love”
Oh, my love.
Merci à toi, William du bar.