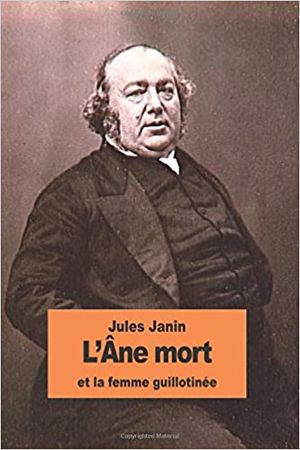C’est une caricature de l’horreur. Il y a eu une mode dans le romantisme, qui était de romantiser l’horreur, l’ignoble.
Jules Janin s’en amuse et fait une satire d’horreurs condensés en un roman.
Voyez donc cette belle et jeune fille des champs, folâtre et souriante sur son âne, qui se dirige gaiement vers Paris, c’est Henriette.
Être belle est bien, mais à quoi peut servir cet atout charmant dans la campagne ? Autant exploiter ce rare avantage dans la ville première des ambitions.
Allez savoir pourquoi, le personnage principal du roman va suivre son idole en lui témoignant un amour silencieux sans contrepartie.
Il aura beau tomber de déception en déception, son attachement reste intact.
Paris tout entier, ville de corruption des âmes, ne cesse d’écoeurer le personnage, mais par un fascination morbide, il se concentre sur cette Henriette, parfait modèle de jeune âme corrompue attirant tous les vices possibles.
Le personnage principal (sans nom, personnification de l’auteur) découvre, au gré de ses promenades parisiennes, toutes les visions morbides résultant de toutes les débauches et les vices.
Il retrouve sa chère Henriette à la morgue, où elle pointe du doigt le cadavre d’un beau jeune homme qui s’est suicidé pour elle et pour lequel elle se contente de dire froidement « c’est bien lui ! » sans autres réactions. Juste avant, elle virevoltait devant les boutiques parisiennes d’un air empressé, d’un air de vouloir tout acheter. Elle a déjà perdu toutes émotions, tout coeur, toute sensibilité.
Cela jette un effroi chez notre homme-spectateur, il tente vainement de se réconforter en repensant à de vieilles mélancolies de jeunesse mais son état s’empire.
Il doit quitter Paris, ce qu’il fait, mais voilà qu’il retombe à nouveau sur Henriette en pleine promenade romantique avec son galant qu’elle méprise. C’est déjà une reine dans l’âme. Comble de l’ironie, ses parents (vieux et pauvres agriculteurs) reconnaissent leur fille, mais celle-ci fait semblant de les ignorer et s’échappe discrètement dans l’impassibilité la plus totale.
L’impatience et l'ambition arrogante d’Henriette est pleinement récompensée : grâce au dernier nigaud d’amant issu de la haute aristocratie qui la traite en véritable comtesse, elle se pavane fièrement à l’opéra où elle suscite l’admiration de tous. Elle vit son propre conte de fées de vanité.
Aléa tout à fait banal, Henriette tombe malade et est clouée au lit un certain temps. Bon... Quelques jours ça va, mais des semaines entières… Pourquoi entretenir si cher une fausse comtesse si l’objet dysfonctionne ? Alors peu importe après tout, c’est une chose interchangeable, le noble qui l’entretient le sait bien, raison pour laquelle il l'a chasse littéralement de sa demeure alors même qu’elle est fragile, car encore sous le coup d’une maladie inconnue qui la ravage.
On revoit cette chère Henriette dans une sorte d’hôpital lugubre pour pauvres dans lequel elle subit une opération au scalpel à vif. Après cette dure opération, elle ressort immédiatement, livrée à elle-même dans cet océan d’inconnu qu’est Paris, encore toute frêle et maigre, en pleine hiver.
L’homme spectateur sort alors de sa passivité pour prendre la jeune fille dans son calèche et lui demande où elle veut aller. Elle n’en sait rien, tout juste a-t-elle mémorisée le nom de « Saint-Phar » qu’on lui a prononcé à l’hôpital, dans le cas où elle serait dans le besoin.
Effectivement Madame Saint-Phar s’intéresse aux filles en pleine détresse matérielle car c’est la gérante d’une maison close.
Henriette est acceptée sans difficulté dans l’établissement.
Bon, le métier sera difficile mais au moins elle aura un toit et sera entretenue à peu près convenablement ?
Non car son cas est spécial, la clientèle de la maison close est composée des mêmes aristocrates qu’elle voyait à l’opéra.
Or les clients reconnaissent tous Henriette, se moquent d’elle, sont même repoussés par elle et sont indignés de la voir tomber si bas, alors ils n’en veulent pas. Un seul client la prend toutefois comme un jouet, c’est justement son ancien compagnon noble qui l'a expulsé de sa maison car elle était malade. En pleine crise bien légitime de folie, elle se venge et assassine ce pervers bien vicieux.
Elle n’a pris aucune précaution, aussi elle avoue immédiatement les faits à la police.
Condamnée à mort, elle est conduite au cachot le temps de subir son exécution. Toujours aussi jolie, elle est remarquée par un geôlier hideux qui lui expliqua qu’elle pouvait être sauvée.
Le geôlier rend enceinte Henriette et un médecin suspend sa condamnation à mort (c'était la règle à l'époque pour les femmes enceintes). On est loin du plan miracle, elle est toujours prisonnière mais son exécution est repoussée.
Le spectateur-inconnu revoit quelques mois plus tard Henriette, jeune mère désormais d’un pauvre enfant frêle qu’elle tient dans ses bras la veille de sa condamnation. Elle venait d’accoucher donc pas un instant à perdre, le bourreau et le geôlier lui confisque son enfant devant ses yeux et le spectateur-inconnu lui fait en même temps culpabiliser en lui disant qu’elle aurait dû lui faire confiance « Henriette, lui dis-je, il faut mourir si jeune et si belle ; toi qui aurais pu être ma femme ». Au sommet de l’horreur, la pauvre Henriette, bien qu’elle soit d’ordinaire insensible, verse quelques larmes. Au lieu d'une douloureuse empathie, cela comble grandement la satisfaction du spectateur-inconnu « c’était les premières larmes que je lui avais vu répandre », comme si en quelque sorte il redonnait une âme à cette pauvre fille en lui forçant une émotion sincère, sorte d'expiation très malsaine.
Elle est fatalement guillotinée.
Quelques remords viennent au spectateur inconnu qui aurait voulu placer un beau linceul sur ce corps enterré dans un cimetière populaire.
Il s’arrange avec le fossoyeur en vue de déterrer le cadavre, ouvre le cercueil et enveloppe la tête décapitée du beau linceul tandis que des promeneurs curieux se moquent de lui « ah ces peines de coeur, que les hommes sont insensés ! » et que des femmes s'étonnent qu’un si beau linceul soit utilisé.
Le soir même, le fossoyeur revend le cercueil, des étudiants de l’école de médecine déterre le cadavre, et les femmes s’arrachent le morceau de linceul.
Mais comment peut-on lire ça ?! Cette agonie qui s’empire de page en page. Ah mais c’est bien volontaire, une bonne torture perverse sortie de l’imagination de Jules Janin.
Je tente de contextualiser, mais sans réelle certitude.
Jules Janin publie cet infâme roman quelques mois après le célèbre roman-thèse de Victor Hugo « le dernier jour d’un condamné ». Jules Janin avait à cette occasion commenté ce roman dans un article de presse.
Dans le roman de Victor Hugo, le condamné exprime directement ses pensées, ses impressions mais Jules Janin n’apprécie pas l’impersonnalité de ce héros :
« Il a crée son héros le plus abstrait qu’il lui a été possible ; à peine savons-nous qu’il a été bien élevé, et qu’il est coupable d’un meurtre.
Rien ou presque rien ne perce de son caractère, de ses passions, de ses croyances ; c’est presque une pure intelligence observant paisiblement »
Cette absence de personnalité était voulue par Victor Hugo, car l’idée était de créer un plaidoyer reproductible pour tous les cas de figure, quelque soit le condamné. Mais peut-être que son condamné apparait trop haut, trop élevé pour que l’on s’identifie à lui ou du moins à l’idée générale qu’on puisse se faire d’un prisonnier.
Aussi dans le roman de Jules Janin, c’est une fille banale de la campagne, froide, sans intelligence qui est condamnée et dont on suit la lente pente descendante depuis sa campagne natale aux bas-fonds parisiens puis à l’échafaud. Henriette est individualisée assez simplement, l’auteur lui condense tous les vices possibles et pourtant, c’est là le petit tour de force de l’auteur, il veut que l’on soit écoeurer non seulement de la peine de mort mais aussi des moeurs barbares qui vont avec et qui forment un tout. Je ne sais pas vraiment s’il réussit à nous persuader, mais il écoeure très efficacement.
Bref, Victor Hugo a réussi à enfanter chez Jules Janin, cette monstruosité assez géniale d’horreurs et d’atrocités, les deux romans se complètent dans leurs buts. Le style est radicalement différent : celui de Jules Janin marque bien plus l’esprit par les images que celui de Victor Hugo, mais celui de Victor Hugo développe des arguments bien plus variés pour être contre la peine de mort.