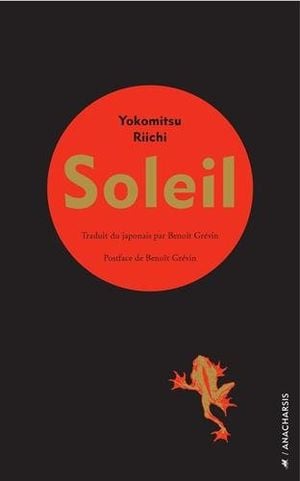Chronique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2016/08/soleil-de-yokomitsu-riichi.html
Voilà une très jolie trouvaille des éditions Anacharsis – un court roman japonais de 1923 qui, au-delà des influences qui l’ont marqué et d’éventuelles voies parallèles que je discuterai bientôt, conserve aujourd’hui toute sa force et tout son brillant.
L’AUTEUR
Yokomitsu Riichi, né en 1898, n’est probablement pas le plus connu en France des écrivains de cette génération de Taishô – celle des « écrivains maudits », parmi lesquels on compte toutefois quelques stars, comme Akutagawa Ryûnosuké ou le futur Prix Nobel Kawabata Yasunari ; ce dernier était d’ailleurs un ami et collègue de Yokomitsu Riichi, lequel a eu son importance en son temps, en prenant la tête d’un mouvement « moderniste », le « néo-sensationnisme » (shinkankaku-ha), appelant à dépasser jusqu’aux apports les plus récents, du côté du réalisme comme du roman prolétarien.
La dimension expérimentale de l’auteur avait cependant déjà été mise en lumière avec entre autres (l’auteur a aussi commis d’importantes nouvelles) le roman qui nous intéresse aujourd’hui, Soleil, paru tout d’abord en épisodes en 1923.
Yokomitsu, à partir de là, a eu un parcours un peu confus… ou pas ? Quoi qu’il en soit, le Japon nationaliste et militariste des années 1930 et 1940 l’a progressivement amené à revoir peu ou prou toutes ses conceptions, au point de la contradiction absolue et du reniement total… À sa mort en 1947, il n’avait sans doute plus grand-chose à voir avec le trublion d’antan, et sa réputation s’en est probablement ressentie.
DE SALAMMBÔ À SOLEIL
Mais nous n’en sommes pas là : quand paraît Soleil, notre auteur a tout juste 25 ans, et l’envie de changer les choses. Pourtant, dans l’optique de ce court roman, il s’agissait bien d’intégrer une influence fondamentale – mais tout autant de la dépasser à sa manière…
En 1919, Yokomitsu découvre émerveillé Salammbô, de Flaubert, dans sa première traduction japonaise, due à Ikuta Chôkô, et parue en 1913 (pour rendre certains aspects stylistiques du texte français, le traducteur avait d’ailleurs eu recours à des effets très personnels, parfois bien éloignés du texte original ; par un juste retour des choses, les dialogues, dans Soleil, reposent sur des traits spécifiques à la langue japonaise, en tant que tels intraduisibles ; le traducteur Benoît Grévin s’en explique dans sa passionnante postface, et ses solutions pour résoudre cette difficulté m’ont paru très pertinentes, si elles sont par essence différentes). Fasciné par cette lecture, Yokomitsu est pris de l’envie de s’en inspirer – mais pas pour en faire « simplement » un pastiche : bien davantage pour exprimer ses propres conceptions, qui plus est dans un cadre tout autre, changeant radicalement le rapport à l’authenticité historique et donc à la documentation.
LES SOURCES HISTORIQUES
Yokomitsu décide en effet de situer son histoire dans un cadre bien différent de la Carthage en proie aux mercenaires décrite par Flaubert : celui du Japon protohistorique – aux environs du IIIe siècle de notre ère (à la lisière des ères Yayoi et Kofun).
Or c’est là une période pour laquelle nous manquons cruellement de documentation… Si l’archéologie a pu mettre en évidence les traits saillants d’une culture matérielle de ce Japon d’avant l’écriture, et donc pas encore sinisé, l’absence quasi-totale, justement, de données écrites sur ces temps-là laisse le champ libre aux spéculations les plus variées.
Mais c’est une absence « quasi-totale », donc : nous disposons bien de quelques traces écrites, très limitées, et comme de juste originaires du grand voisin chinois. Yokomitsu s’intéresse tout particulièrement à un très bref passage de la Chronique des Trois Royaumes (Sanguo Zhi), qui date de la fin du IIIe siècle de notre ère, et qui discute des Barbares environnant l’Empire du Milieu ; parmi eux, le « peuple des Wa », ainsi que sont désignés les habitants de l’archipel nippon.
Or ce texte étonnant, s’il poursuit en partie les rares données antérieures décrivant hâtivement « l’organisation » du « peuple des Wa » au travers de petites chefferies rivales, comprend une anecdote pour le moins étrange – évoquant une sorte de « reine-chamane » du nom de Himiko, qui aurait suscité un embryon de centralisation étatique en unissant trois « royaumes », dont celui de Yamatai, désignation qui ne manque pas de faire penser au cœur mythique du Japon, appelé Yamato (à ceci près que l’emplacement géographique du Yamatai de Himiko et du Yamato « classique » diffère, le premier se trouvant sur Kyushu, le second sur Honshu).
Bien évidemment, les sources écrites japonaises, ultérieures de quatre ou cinq siècles, et notamment la tradition mythique contenue dans le Kojiki puis le Nihon Shoki, ne comprennent rien de la sorte – établissant de leur côté une succession dynastique impériale pour cette période dont on sait qu’elle n’a rien d’authentique (si les ultranationalistes la prenaient volontiers pour argent comptant, par principe)…
Séduit par cette « histoire parallèle », et peut-être là poussé par un vague sentiment de subversion à l’égard de tendances nationalistes (donc) qu’il ressentait peut-être, en même temps, Yokomitsu décide de raconter l’histoire de cette Himiko – mais pas vraiment celle que rapporte la chronique chinoise : l’auteur en livre en quelque sorte, pardon pour le vilain terme un peu ridicule ici, une « préquelle » ; il ne s’agit pas de parler de la reine-chamane Himiko régnant sur ses trois royaumes, dans son palais où les hommes étaient interdits de séjour, et pas davantage de la tradition matriarcale qu’elle avait semble-t-il mise en place ; ce qui intéresse l’auteur, c’est comment elle en est arrivée là.
Or les sources écrites n’en disent donc absolument rien, pas plus que du contexte culturel de ce pré-Japon largement inconnu… et fantasmé. D’où une différence essentielle avec le matériau historique : si Flaubert, pour écrire Salammbô, s’était abondamment documenté, les sources étant nombreuses et son ambition de réalisme essentielle, Yokomitsu, lui, profite en fait du vide des sources écrites pour recréer un monde – et c’est là une chose qui m’intéresse tout particulièrement, notamment en ce que cette approche me semble relever à certains égards davantage de la fantasy que du roman historique, j’y reviendrai.
LE RÉCIT
La trame est somme toute élémentaire – ce qui sied en fait bien à ce récit « mythique » –, et, par ailleurs, elle est très vive : le roman est court, une centaine de pages au plus, et perpétuellement en mouvement.
Nous y suivons donc Himiko, qui n’est pas encore la reine-chamane du peuple des Wa, mais « simplement » une princesse du pays maritime d’Umi (sur Kyushu, comme les autres « royaumes » cités, on ne traverse jamais la mer) ; elle doit épouser bientôt le prince Hiko no Ôe, qu’elle aime autant qu’il la taquine. Mais c’est alors que surgit en Umi un voyageur inconnu, ensuite identifié comme venant du pays rival de Na – on apprend bientôt qu’il s’agit en fait du prince du pays Na, Nagara… Malgré les tensions ancestrales entre les deux pays, Himiko plaide pour que l’on épargne l’homme de Na… et c’est là le début de ses malheurs.
Car Nagara est fou amoureux de Himiko – et, selon les mœurs du temps, qui nous renvoient en Europe, sinon à Hélène (mais peut-être, après tout), du moins aux Sabines (ceci étant, quitte à faire une référence à la fois antique et contemporaine, je serais tenté de mentionner la Lavinia d’Ursula K. Le Guin…), Nagara entend bien ravager l’Umi et enlever la beauté pour l’épouser – faisant de sa violence même un argument…
C’est le début d’un cycle d’affrontements barbares, les chefferies de Kysuhu n’étant en fait guère plus que des bandes, soumises au bon vouloir arbitraire de despotes régnant par la force et la cruauté. Les hommes, ici, sont tous (ou presque – Hiko no Ôe et Wakaro, les deux maris que Himiko s’est choisis successivement, sont peut-être différents, mais rien de certain au fond) autant de brutes avides de posséder la princesse par la force, et prêts pour cela à tuer quiconque se trouverait sur leur chemin ; elle passe ainsi de main en main, ses mariages « choisis » étant plus qu’éphémères… Et son itinéraire baigne dans le sang.
Germe bientôt en elle le désir de vengeance, plus particulièrement quand elle tombe aux mains des maîtres d’un autre pays, appelé Yamato (mais ce n’est donc pas le Yamato « classique » de Honshu), deux frères rivaux et visiblement prêts à s’entretuer pour elle. Maîtresse femme par la force des circonstances, habile à manœuvrer les hommes tous réduits en face d’elle à leurs pulsions les plus bestiales, elle saura aussi, le moment venu, paraître elle-même sur le champ de bataille pour mettre fin à un monde…
LA (RE)CRÉATION D’UN MONDE
L’histoire, pour être simple, ne manque pas de force – et elle s’habille régulièrement d’atours oniriques (ainsi avec la harde de cerfs emportant Himiko et Kawaro) autant qu’épiques (la bataille finale, avec un volcan en éruption à l’arrière-plan !).
Mais la grande habileté de l’auteur, dans cette (re)création d’un monde, réside dans une adéquation de tous les instants entre le fond et la forme, dont résulte un effet de dépaysement voire plus radicalement d’exotisme, les deux aspects se renforçant sans cesse comme dans une boucle de rétroaction.
Plus libre que ne l’était Flaubert pour recréer sa Carthage, Yokomitsu pioche certes dans le savoir archéologique, mais ne compte pas le laisser s’interposer entre lui-même et son histoire – il peut donc laisser passer sans y attacher plus d’importance quelques anachronismes qui lui paraissent préférables à l’authenticité, pour épicer son récit d’images fortes (ainsi des rites funéraires, par exemple, avec les tertres kofun et plus encore les « statues-cylindres » haniwa, en fait un brin postérieurs).
C’est qu’il vise à une authenticité d’un autre ordre – et dans un sens « supérieure », car liée aux fonctions du récit : c’est la puissance d’évocation qui doit l’emporter – et elle est tout autant immersion dans un monde radicalement différent (presque un « monde secondaire » de fantasy, en ce qui me concerne – oui, oui, j’y arrive…), où tout est prétexte à l’édification fascinée du lecteur, à condition de savoir doser les éléments pour que rien ne sombre dans l’artifice, et pas davantage dans une pénible exposition lourde de détails malvenus ; c’est à travers la fluidité et le naturel que s’exprime cette authenticité parallèle.
D’où, par exemple, les allusions nombreuses mais sans autres détails à la culture matérielle de la période – tout particulièrement les bijoux, et notamment les « pierres-courbes » (magatama) et « pierres-tubes » (kudatama), mais aussi ces étonnants colliers de becs d’oiseaux, etc.
LA NATURE ET LES HOMMES
Pourtant, la singularité et la force de Soleil, qui en font une vraie merveille bien digne d’attention comme d’éloges, réside encore dans d’autres procédés. Un, tout d’abord, oscille entre fond et forme, et c’est la dimension « naturalisée » du monde recréé par Yokomitsu – l’évocation, sans cesse entremêlée au mondes des hommes, qui du coup n’en est pas vraiment séparé, de l’animalité et de la végétation.
L’animalité s’exprime ainsi tant dans les nombreuses allusions à la chasse, avec notamment ces sangliers et plus encore ces cerfs omniprésents, que dans la thématique de la bestialité, à travers les pulsions irrépressibles de ces « chefs » qui sont autant de brutes.
La dimension « végétale » est probablement plus subtile – mais, au travers d’un champ lexical d’une précision et d’une richesse sensibles, elle imprègne tout autant cette humanité farouche d’avant la civilisation, vivant dans la nature et en faisant intégralement partie.
LES DIALOGUES ET LA LANGUE
Tout cela participe de la dimension « archaïque » de Soleil. Mais s’il est un point où elle ressort tout particulièrement, c’est encore ailleurs : dans les dialogues.
Je l’avais rapidement mentionné plus haut : le traducteur Benoît Grévin, qui a fait un superbe travail, évoque dans sa postface cette difficulté insurmontable, car témoignant de subtilités de la langue japonaise absolument inconnues (ou presque, mais à ce stade…) en français – Yokomitsu, dans Soleil, bouleverse la langue japonaise, en en exprimant un état « antérieur » (aux besoins de son récit, il est dans son livre parfois archéologue, parfois anthropologue, mais bien avant tout romancier) sans les complexes et subtils registres de politesse qui l’imprègnent, et sont autant de moyens de préciser, chez les locuteurs, les sentiments et les intentions ; il en va de même, d’ailleurs, pour le jeu des particules finales, qui ont un rôle éventuellement similaire, et dont l’auteur se passe délibérément ici.
Il en résulte une langue unique et tout à fait « autre », qu’il était impossible de rendre directement en français. L’idée étant cependant celle d’un archaïsme aux couleurs d’exotisme, le traducteur a eu recours à des procédés différents pour exprimer le même esprit, contre la lettre le cas échéant. Et si la dimension incantatoire des dialogues, presque chantés dans leurs nécessaires répétitions, peut s’accommoder de la traduction, l’archaïsme au regard des relations sociales et éventuellement hiérarchiques est rendu ici notamment par un emploi des « moi » et « toi » qui, tout en s’inscrivant globalement dans ce principe de scansion, le dépasse en exprimant, au-delà de la poésie ou dans un autre registre poétique, un caractère « brut », quelque part entre l’homme des cavernes et le mythe des origines, avec en outre quelque chose d’essentiellement autoritaire, appuyant la rudesse des chefs, tout en exigences, d’une manière étonnamment appropriée.
Ce n'est pas la seule difficulté de la traduction : il faut évoquer également les titres honorifiques, construits par association (par exemple « souverain-des-hommes » pour rendre « roi », etc.). Là encore, l'approche du traducteur est tout à fait pertinente.
LE GENRE, ENTRE ROMAN HISTORIQUE ET FANTASY ?
Inventif dans le fond comme dans la forme, Soleil est une lecture d’un charme étonnant, une affaire d’immersion autant que de poésie. Le roman, au-delà de l’influence assumée et même revendiquée de Salammbô, garde une forte singularité.
On peut toutefois être tenté d’établir des parentés, permettant de cerner un peu plus le propos. Mais c’est à plus ou moins bon droit… Quand la quatrième de couverture évoque « un Miyazaki par anticipation », ça me laisse passablement perplexe. Quand la postface évoque les mangas et animes de même, car c’est sans autre précision, et en traitant du médium plutôt que du genre.
Il y a pourtant une autre piste, qui n’est pas mentionnée une seule fois ici (sinon par la bande et par déduction à partir de ce que je viens de citer), et c’est la littérature de fantasy…
Le monde recréé par Yokomitsu dans Soleil, étant peu ou prou le fruit de sa seule imagination, à peine fortifiée par quelques rares données archéologiques sur la culture matérielle et quelques paragraphes perdus dans d’antiques chroniques chinoises, et prête le cas échéant à « violer l’histoire pour lui faire de beaux enfants », me paraît davantage appeler la comparaison avec la fantasy moderne, à cette époque même juste naissante dans le monde anglo-saxon, plutôt qu’avec la forme ici très aléatoire et pour le coup si peu appropriée du « roman historique ».
Et peu importe l’aspect surnaturel ou pas à cet égard – en relevant tout de même que ce « monde secondaire » est plus d’une fois ambigu (délibérément) à ce sujet.
J’ai en effet l’impression que cette parenté (et peu importe qu’elle soit consciente ou pas, admise ou pas) est d’autant plus remarquable qu’elle vaut pour les deux tendances qui se distinguent dans le genre naissant dans le monde anglo-saxon : on trouve après tout dans Soleil, tant un monde barbare et brutal, où la morale tente de se manifester mais cède éventuellement le pas au nihilisme, à la façon d’un Robert E. Howard, qu’une entreprise de (re)création d’un monde cohérent et « autre », archaïque par essence, (re)création qui passe au moins autant par la forme que par le fond, et affiche ainsi leur caractère indissociable – ce qui nous conduit plutôt du côté d’un Lord Dunsany ou d’un J.R.R. Tolkien.
Bien sûr, lecteur de fantasy, je prêche peut-être un peu pour ma paroisse… Mais d’autant plus que je suis persuadé que les amateurs du genre apprécieront ce très puissant roman qu’est Soleil, aussi fort que bref, à l’admirable pouvoir d’évocation et au style subtilement travaillé – et très joliment rendu.
Un excellent roman, une très belle exhumation.