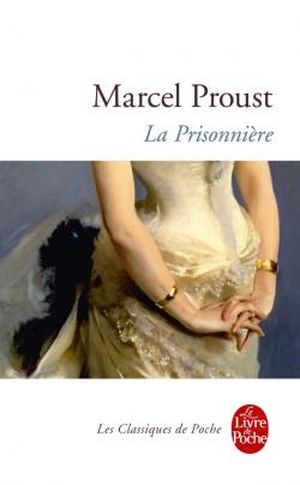Après deux volumes dédiés aux rapports mondains (Le Côté de Guermantes, pour le moment la partie que j'aime le moins dans la Recherche, et Sodome et Gomorrhe, où on côtoie surtout le salon des Verdurin), voici un cinquième tome juste magnifique et qui est découpé en deux parties qui paraissent, a priori, ne pas avoir de lien entre elles.
D'abord, il y a le sort que le narrateur réserve à Albertine et qui donne son titre au roman. Albertine est prisonnière de l'appartement parisien du narrateur (qui admet pouvoir, éventuellement, se faire appeler Marcel, seule apparition de son prénom putatif dans l'ensemble de La Recherche, et encore dans une tournure de phrase alambiquée). Prisonnière de la jalousie du narrateur. Une jalousie d'ailleurs bien paradoxale : si jamais il a la certitude, la preuve absolue d'être trompé, alors il n'est plus jaloux. Mais le sentiment renaît dans l'incertitude. Comme toujours chez Proust, les choses n'existent pas en elles-mêmes, tout naît en nous. Dans La recherche, le pouvoir de l'imagination investit le monde entier. C'est cette imagination qui fait naître des sentiments de jalousie chez le narrateur, comme elle faisait naître auparavant des images de châteaux forts à l'évocation du nom des Guermantes.
Et Proust en profite pour nous donner sa vision de l'amour. Une vision sombre et pessimiste. Là aussi, l'amour est tourné vers nous-mêmes. L'amour du narrateur pour Albertine est dans une aporie : c'est la recherche d'une emprise totale et absolue sur une personne, et, une fois cette emprise obtenue, c'est la nostalgie de l'époque où cette personne était une inconnue, où elle gardait des mystères. Le narrateur est à la fois un conquérant heureux et malheureux car la victoire lui a ôté le goût de ce qu'il cherchait à conquérir.
Et la jalousie devient, finalement, le seul lien qui les unisse. Le narrateur ne veut rester avec Albertine que tant qu'il est jaloux d'elle. Le couple ne tient que par ce lien de souffrance, comme si le narrateur disait « je suis jaloux, c'est donc que j'aime ».
Mais son amour est une possession absolue. Il se veut un amphitryon : le génie de l'écriture proustienne transforme Albertine en une œuvre d'art. « Elle est mon oeuvre » : il aime voir en elle les résultats de son influence. Et, au delà, c'est l'ensemble de l'univers qui subit l'esthétisation de l'écriture : tout devient œuvre d'art. Les appels des marchands de rue sont comparés à des airs d'opéra, le rituel matinal d'Albertine est calqué sur Esther de Racine, etc.
Cette vision esthétique du monde atteint son point culminant avec ces pages prodigieuses, qui pourraient servir d'art poétique à Proust, où il compare la vie à la musique de Wagner. Du coup, impossible de ne pas voir la présence de leitmotives qui traversent toute La Recherche, de petites phrases, de minuscules détails, de situations qui se répètent avec, parfois, d'infinies variations et qui structurent l'ensemble.
La seconde partie du roman est à nouveau consacrée à la vie mondaine, au salon des Verdurin (je les aime ceux-là, ils sont tellement ridicules) et au baron de Charlus. Rien à voir, a priori, entre les deux parties. Et pourtant, ce serait mal connaître Proust.
Sur le plan mondain, la Recherche est basée sur une description de la déchéance de la noblesse pourrissante (j'aime cette phrase terrible, « snob bien que duchesse », qui est une destruction monstrueuse de ces rameaux visqueux d'arbres généalogiques autrefois prestigieux) et sur le ridicule de la haute bourgeoisie qui essaie d'en copier les codes sans en avoir la finesse d'esprit. Dans La Prisonnière, deux évidences s'imposent : Charlus sert de lien entre les deux mondes, et surtout une incroyable jalousie de Mme Verdurin. Une jalousie qui anime la bourgeoise, la pousse à chercher les invités les plus précieux ou, s'ils refusent de venir, à les dénigrer le plus sèchement possible.
La jalousie.
Nous y revoilà. Et c'est ainsi que le roman trouve une unité inattendue.
Proust met alors en parallèle la comédie amoureuse et la comédie mondaine. S'inspirant plus que jamais de Balzac, dont l'influence est ici, une fois de plus, notable, il montre qu'il s'agit d'une comédie au sens théâtral du terme : on joue, on joue un rôle auprès des autres, auprès de ceux qui nous sont supérieurs ou inférieurs, et encore plus auprès de ceux qui nous sont proches. Et dans ce jeu social, impossible de savoir qui bluffe. Car pour cela il faudrait connaître les gens, sonder les personnalités, or s'il y a un constat flagrant dans l'ensemble de l'oeuvre proustienne, c'est que les personnes autour de nous resteront à jamais des inconnues, que rien ne nous les fera connaître.
Cette comédie, c'est sûrement l'ultime avatar de cette invasion de la vie par l'Art : faire des relations sociales une pantomime absurde et farcesque.
Il fallait le génie de Proust pour le mettre en évidence.