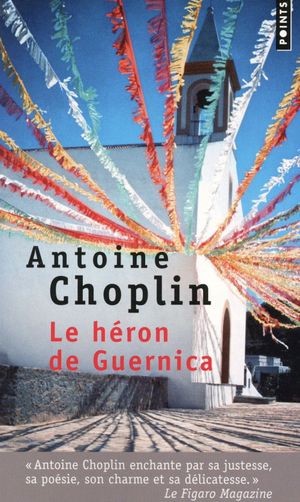Le Héron de Guernica par BibliOrnitho
Basilio est basque. Il vit à Guernica et se passionne pour sa peinture qu’il exerce en autodidacte. Son sujet favori est un héron qui vient pêcher chaque jour dans le marigot bordant la rivière à la sortie de la ville. Il l’a peint souvent et a promis une toile à Célestina qu’il aime beaucoup. Et un peu plus que cela sans doute.
Il est d’ailleurs consciencieusement occupé à peindre quand, en ce 26 avril 1937, la première bombe est larguée sur la ville. Durant 90 minutes, de 16h30 à 18h00 en ce jour de marché, celle-ci est copieusement pilonnée par l’aviation. Basilio a laissé ses pinceaux au bord de l’eau, mais tout en courant en direction de la place du marché, continue de penser à son héron. Le bombardement n’est pour lui qu’une interruption dans son travail. Il se promet d’y revenir dès que possible. Pour achever cette toile qu’il veut parfaite pour Célestina. Célestina qu’il croit à l’abri dans l’usine de la ville, proche d’un bâtiment connu ses sympathies nationalistes.
Mais Hitler n’est pas venu déloger les républicains pour le compte de son ami le Généralissime. Il ne s’agit pas d’une campagne d’altruisme : si l’armée allemande a choisi cette petite ville de 7000 habitants, c’est pour tester le Blitz qui fera fureur trois plus tard en Angleterre. Le bâtiment « nationaliste » ne compte donc pas dans l’équation. Et l’usine dans laquelle Célestina poursuit son travail encore moins. C’est en apprenant sa mort que Basilio prend conscience de la catastrophe. Le héron lui aussi est blessé. L’artiste achève néanmoins sa toile en hommage à sa bien aimée et qu’il se propose de montrer à Picasso au cours de l’exposition universelle qui se tient la même année à Paris et au cours de laquelle le maître doit présenter sa célèbre toile évoquant la ville martyre.
Un livre court mais efficace sur l’un des épisodes les plus sombres de la guerre d’Espagne. Hormis le premier chapitre parisien et le dernier en compagnie de Picasso, tout le récit se déroule sur 24 heures à peine, entre le bal du dimanche, veille de la catastrophe, et la soirée du lundi alors que la ville brûle et que le nuage de poussière ne s’est pas encore totalement dispersé. Comme les basques, le lecteur est écrasé sous le tapis de bombes, déroulé par une écriture brute, très sèche et totalement dépouillée de fioriture. Rusticité qui m’a rappelé celle de Ramuz et de sa grande peur dans la montagne. Juxtaposition de la légèreté du pinceau, de la poésie et de la violence la plus brutale, de l’art pictural et de l’art de la guerre. Terrifiant !