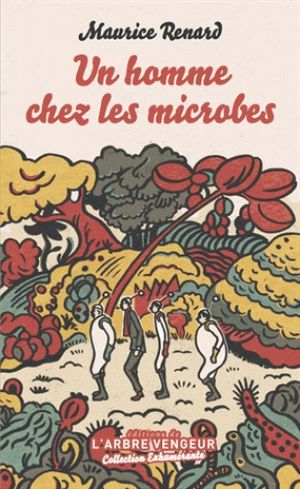Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2018/01/un-homme-chez-les-microbes-de-maurice-renard.html
MERVEILLEUX SCIENTIFIQUE ET HUMOUR
Maurice Renard, auteur essentiel du « merveilleux scientifique » français, à cette époque où la science-fiction ne portait pas encore ce nom, est à nouveau, après L’Homme truqué il y a quelque temps de cela, « exhumé » par les belles éditions de L’Arbre Vengeur, qui nous ont également régalés de l’œuvre de certains des plus brillants de ses compères, comme les un peu plus récents Régis Messac (Quinzinzinzili) et Jacques Spitz (L’Œil du purgatoire). Un homme chez les microbes, toutefois, est publié dans une collection un peu à part, dite « Exhumérante », et dont le propos est de rappeler au bon souvenir du lecteur des « classiques oubliés » du registre humoristique.
Et sans doute est-ce à bon droit, car ce bref roman de 1928 conjugue en effet imaginaire scientifique et drôlerie, dans un registre où les deux domaines fusionnent sans qu’aucun ne prenne vraiment le pas sur l’autre (ou, plus exactement peut-être, en offrant à chacun son moment pour briller). Ce n’est pas la moindre singularité, ni le moindre atout, de ce roman qui, pour être d’un style agréablement suranné, parvient toujours, quatre-vingt-dix ans plus tard, à faire rire et à émerveiller. Le ton est dès lors assez différent de celui de L’Homme truqué, sans que l’œuvre y perde en cohérence.
Cela tient peut-être, pour partie du moins, à la multiplicité des formes de l’humour dans le roman, dont témoigne, avec toute la gouaille d’un bateleur, l’enthousiasmante préface de Claro. Mais, à vrai dire, l’imaginaire scientifique également se voit traiter sur des modes différents, où le voyage extraordinaire a sa part, ainsi que le laisse d’emblée entendre le titre du roman – au point en fait où le thème lorgne plus que jamais sur l’utopie, sans jamais perdre de vue le rire et plus particulièrement la satire, ce qui doit sans doute tirer le présent roman du côté de Swift et de ses Voyages de Gulliver.
UNE QUESTION DE TAILLE
En effet, le roman procède en deux temps – de manière très symptomatique, il est divisé en deux parties, approximativement de taille égale, et dont l’approche est assez différente ; ceci en laissant un peu de côté l’étonnant « Prologue (pourquoi pas ?) cinématographique ».
Dans la première partie, nous faisons la rencontre du docteur Pons, un jeune médecin non dénué d’ambitions mais qui a dû brutalement les remiser au placard, en s’installant à Saint-Jean-de-Nèves – qui n’est pas exactement Paris. Le docteur Pons, jamais avare de bons mots et encore moins des plus mauvais, reçoit un jour la visite de son ami Fléchembeau, grande gigue qui a fait son droit et se verrait bien épouser la mignonne Mlle Olga Monempoix, délicieuse fille du magistrat local, le voisin de Pons. Las ! Les parents ne veulent pas… Ou pas tout de suite. Sans doute est-ce parce que cette canaille républicaine en a après le monarchiste Fléchembeau ! Oui : 1928, une autre époque…
Mais le docteur Pons mène son enquête, et découvre que le refus des Monempoix est motivé par tout autre chose : la taille du prétendant ! Cet homme est trop grand – peu importe qu’il soit monarchiste ou non. Mlle Monempoix est bien menue à côté… Le couple ne pourrait être que mal assorti ! Et parfaitement ridicule, surtout en société ! Si seulement le fringant jeune homme pouvait être plus petit, de quelques centimètres à peine… Rêverie futile.
Et cependant… Le bon docteur Pons pourrait peut-être aider son ami Fléchembeau ? C’est qu’il travaillait sur un traitement médicamenteux destiné à réduire les dimensions – cela semble avoir fonctionné sur sa chatte… Inutile pour l’amoureux éconduit d’en savoir davantage : il gobe aussitôt les pilules – bien imprudemment…
Et le traitement fonctionne ! Fléchembeau perd quelques centimètres : le jour requis (car Pons avait, sans expliquer pour quelle raison, obtenu un délai d’un mois auprès des Monempoix), l’avocat a « la bonne taille », et tout le monde s’en réjouit : champagne, félicitations, reparties spirituelles ! Incluant un affligeant « Je vous salue, mari ! »
Mais voilà : contrairement à ce qui avait été prévu, Fléchembeau continue de rétrécir… et c’est bien fâcheux.
C’EST LE POMPON !
On en arrive à la seconde partie du roman – si la première est narrée à la troisième personne, la seconde est à la première personne, sous la forme d’un compte rendu écrit par Fléchembeau concernant son incroyable odyssée.
En effet, quoi que tente un docteur Pons aux abois, même aimablement secondé par Mlle Olga, Fléchembeau diminue jour après jour. Bientôt réduit à la taille d’un homoncule, l’avocat ne s’y arrête cependant pas, et il devient de plus en plus difficile de le suivre comme de communiquer avec lui – jusqu’au jour fatidique de la disparition pure et simple…
Sauf que non : le voyage de Fléchembeau est tel qu’il se poursuit en fait dans l’infiniment petit – l’univers des microbes… et au-delà ? Car notre homme qui rétrécit fait la rencontre de toute une civilisation, brillamment avancée – probablement bien plus que la nôtre. Ces Mandarins, ainsi que les surnomme notre héros, sont anthropomorphes en tous points ou presque, mais avec des bizarreries çà et là – dont la plus flagrante est ce pompon qu’ils ont sur la tête, et qui leur confère une sorte de sixième sens inaccessible aux humains ; plus tard, Fléchembeau découvrira d’autres faits étonnants, dont, pas le moindre, la division de cette espèce en trois sexes. Quoi qu’il en soit, ces « microbes », auxquels notre voyageur malgré lui confère des noms naturellement grecs, parviennent à mettre un terme à son rétrécissement ininterrompu jusqu’alors, et songent, pour l’un d’entre eux du moins, à trouver un moyen de rendre à Fléchembeau sa taille humaine – un processus qui demandera beaucoup de temps…
D’ici-là, il a toute une utopie à découvrir ! Et à la manière d’un Gulliver...
L’HOMME QUI RÉTRÉCIT (VRAIMENT BEAUCOUP TROP)
Il a pu être tentant (et cela a semble-t-il été tenté par les héritiers de Maurice Renard ?) d’établir une filiation entre Un homme chez les microbes et L’Homme qui rétrécit, le fameux roman de Richard Matheson. Mais, à tout prendre, au-delà du dispositif de base (et encore ?), de cette idée donc d’un homme qui rétrécit, les deux romans ne sauraient être davantage opposés : ils ne racontent pas du tout la même chose, et, qui plus est, le font sur un ton qui n’a absolument rien à voir.
Quelques séquences, sans doute, à mi parcours de la diminution de Fléchembeau, peuvent bien se retrouver dans les deux œuvres, mais c’est un leurre auquel il ne faut pas attacher trop d’importance. Après tout, ce qui importe vraiment chez Renard, c’est de rétrécir l’homme aux dimensions d’un microbe, lui offrant ainsi l’aperçu d’une civilisation aliène même si anthropomorphe et terrestre – il joue de l’infiniment petit, et corrélativement de l’infiniment grand, dans une perspective tenant de la faculté d’émerveillement. Le roman de Matheson, par contre, se concentre sur un homme de taille insectoïde, confronté à la menace nouvelle d’objets et de créatures anodins et tout sauf redoutables dans le quotidien de l’humanité. Les deux personnages ne sont pas forcément très sympathiques, ce qui les rapproche certes, mais, au-delà, ils ne vivent pas du tout la même chose, aussi les échos de leurs expériences sont-ils très différents.
Ce qui ressort d’autant plus du ton et du style. Chez Renard, la plume est enjouée, abondant en mots d’esprit, surtout dans la première partie du roman, avec le frénétique Pons – la seconde partie, le rapport de Fléchembeau, est certes plus posée. Chez Matheson, c’est tout autre chose, avec une approche plus prosaïque qui, en même temps, est chargée d’horreur – que ce soit sur le long terme, avec la misère sociale du personnage abandonné de tous, ou sur le vif, avec la fameuse araignée… En outre, la psychologie du personnage principal est traitée bien différemment, c’est peu dire. Le rire n’est vraiment pas de la partie, dans L’Homme qui rétrécit...
DEUX FORMES DE SATIRE SOCIALE
Alors que c’est bien une dimension essentielle d’Un Homme chez les microbes, roman abordant la satire sociale sous deux angles très différents.
Dans la première partie, l’humour domine – l’imaginaire, progressivement déployé au travers du traitement du docteur Pons faisant rétrécir son ami Fléchembeau, est finalement au service de la satire plus qu’autre chose. Une satire délicieuse, heureusement – où l’auteur ne prend pas de gants à l’égard de la bourgeoisie de province, et des ambitions des bien-nés ; sans forcément que cela vire au pamphlet, cela dit, car le ton très léger du récit, et rendu plus léger encore par les traits d’esprit du docteur Pons (du genre qui sont tellement mauvais qu’ils en deviennent magnifiquement bons), rend l’ensemble plus drôle que méchant. Et, oui, toujours drôle en 2017 – un tout autre monde pourtant. La plume de Maurice Renard est sans l’ombre d’un doute surannée, mais elle est tout aussi vive et chatoyante, un vrai régal – que les mauvais jeux de mots rendent plus humain et non moins savoureux. Claro, dans sa préface (qui en dit peut-être un peu trop, en même temps ?), donne de bons aperçus de l’humour de l’auteur se traduisant dans son style, et c’est parfaitement délicieux.
L’humour persiste dans la deuxième partie du roman, mais de manière moins frontale, et moins systématique. Le récit du pauvre Fléchembeau, par la force des choses, ne peut pas faire preuve de la même insouciance badine – et Pons n’est plus là pour émailler l’histoire des blagues les plus éculées et du goût le plus affligeant.
Cependant, notre homme qui a rétréci, plus ou moins consciemment, est donc typique de ces visiteurs en Utopie que la littérature a plus qu’à son tour repris depuis Thomas More, et assez clairement dans la veine du « voyage extraordinaire » ou plus globalement du « conte philosophique » : le roman mentionne à plusieurs reprise le Micromégas de Voltaire, et il me faudra y revenir, mais la figure à laquelle nous renvoie presque automatiquement le roman, dans ces pages, est bien le Gulliver de Swift. En même temps, et comme de juste, Fléchembeau chez les Mandarins a aussi quelque chose des Persans de Montesquieu égarés en France…
L’exotisme du cadre, qui autorise de beaux moments de merveilleux scientifique, joue en effet son rôle traditionnel de miroir de notre monde : à travers les Mandarins, et à travers Fléchembeau découvrant candide le monde des Mandarins, Maurice Renard évoque bien notre monde dans l’entre-deux-guerres (le monde des Mandarins, d’une certaine manière, est également dans cette position guère enviable – à mi-chemin entre les tranchées noyées sous les gaz de combat, et la menace d’une future guerre d’extermination), un monde chamboulé par la science et l’industrialisation, avec ses gloires mais plus encore ses ridicules, dans l’académie comme dans les salons – qui renvoient directement aux ambitions mesquines d’un Fléchembeau comme d’un Pons. Mais le rire est donc alors beaucoup moins franc, et ne dissimule pas toujours une angoisse fondamentale, aux dimensions peu ou prou cosmiques.
LA FACULTÉ D’ÉMERVEILLEMENT, POURTANT
Car le roman, sous la blague, a un véritable contenu « merveilleux scientifique », si l’on ne veut pas encore dire « science-fictif » (mais, après tout, pourquoi pas ?). C’est bien sûr particulièrement sensible dans la seconde partie, qui se veut à cet égard plus « précise » que le « voyage extraordinaire » classique, mais, déjà dans la première partie, certains échanges entre le docteur Pons et Fléchembeau le laissaient deviner. Toutefois, la prise de conscience de ce qu’il y a un monde infiniment petit avec sa propre civilisation change forcément un peu la donne… La référence revient souvent, à Micromégas donc, et elle a des implications colossales – car il ne s’agit pas seulement d’imaginer un monde infiniment petit, recelant en lui-même la potentialité d’autres mondes infiniment petits (c’est le souci, avec l’infini...), mais aussi, le cas échéant, d’envisager notre monde de la sorte, avec de l’infiniment grand par-dessus. Le débat a ainsi des implications d’ordre cosmique, annihilant tout anthropocentrisme, qui ont quelque chose de vertigineux – c’est déjà, dans sa forme la plus pure en dépit du ton humoristique, le « sense of wonder » de la meilleure science-fiction (et cela a pu me faire penser, antérieur, à l’extraordinaire Flatland, d’Edwin A. Abbott). Le roman tente d’ailleurs de jouer également de cet aspect sur le plan temporel, mais sans doute avec moins de pertinence et de réussite.
Mais ce vertige est bien ce qui importe le plus, ici – car la société des Mandarins, en tant que telle, est plus ou moins enthousiasmante, avouons-le. Maurice Renard, en effet, et sans doute parce que cela sert son propos via l’intégration plus ou moins dissimulée de Fléchembeau parmi les Mandarins, a conçu une société que l’on pourrait trouver trop anthropomorphe – il y a certes le pompon, dont le nom même ne fait pas très sérieux, mais pas grand-chose d’autre pour l’essentiel, à part, à terme, cette idée d’une espèce à trois sexes, supposée battre en brèche les préjugés de Fléchembeau et tant qu’à faire ceux du lecteur avec, mais sur un mode finalement bien timide. Les « nègres verts » feront probablement hausser quelques sourcils, par ailleurs.
D’autres aspects, heureusement, sont plus intéressants – comme ces deux « soleils », l’industrialisation à outrance de la civilisation mandarine, ou son rapport intéressé à la science. Il y a là quelques belles idées, qui font d’Un homme chez les microbes un roman non seulement drôle mais aussi fascinant dans sa veine science-fictive.
Mais cela débouche sur quelques chose d’assez étrange : une dimension peu ou prou apocalyptique qui n’est certes pas dans le ton de la majeure partie du roman. Ici, Maurice Renard, est-ce compulsion ou hommage ou que sais-je, revient à nouveau, ai-je l’impression, à la manière de son modèle H.G. Wells – le roman n’a à ce stade plus rien de léger, et laisse entrevoir des futurs non mandarins sinon non humains, qui ne seraient pas si étrangers aux ultimes visions de La Machine à explorer le temps, ou à l’imminence de la disparition de l’humanité dans La Guerre des mondes.
La rupture de ton est saisissante. Mais je ne suis pas bien certain de ce qu’il faut en penser, au regard de la qualité du roman.
À LA HAUTEUR
Reste que celui-ci, globalement, se montre plus qu’à la hauteur (aha). Le ton du roman ne doit pas leurrer : il contient de beaux moments de merveilleux scientifique, tout à fait dignes d’un ouvrage qui s’afficherait « plus sérieux ». Si l’anthropomorphisme de la société mandarine est un peu décevant, les bonnes idées ne manquent heureusement pas dans ce contexte, qui contribuent tant à asseoir la singularité du roman qu’à en exprimer quelque chose de latent qui s’avère à terme peu ou prou visionnaire.
Toutefois, son atout essentiel est bien son humour. À sa manière quelque peu passée de mode, Un homme chez les microbes demeure pourtant un roman très drôle, et la plume très travaillée de Maurice Renard, dans ce registre dangereux, faisait et fait encore des miracles. Très bonne idée, donc, que de rééditer ce roman délicieux dans la collection « Exhumérante ».
En attendant, peut-on l’espérer, d’autres rééditions ? Sans doute cela en vaudrait-il la peine – car Maurice Renard était donc un auteur à la palette riche et variée, un des plus brillants de ces « précurseurs » que le genre science-fictif aime à s’attribuer. Toute nostalgie malvenue mise à part (sans même parler de quelque chose d’aussi absurde que le « patriotisme littéraire »...), il y a là un domaine à creuser.