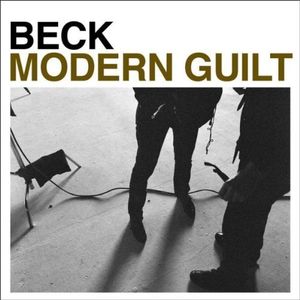Si la perte d’entrain scénique de Beck continue de forcer l’inquiétude, son dixième album vaut tous les check-up soniques de la terre. Car le blond diaphane, dont la silhouette malingre se tient désormais presque systématiquement à l’ombre d’un couvre-chef noir – effet J.T. LeRoy garanti –, rayonne par sa forme discographique. En guise de premiers symptômes, Chemtrails, morceau de bravoure mené tambour battant par un Joey Waronker plus “reitzellien” que jamais, et balancé à la manière d’un teaser sur MySpace quelque temps avant la sortie du disque, laissait déjà le souffle court. On y croisait le spectre de vierges suicidées s’adonnant dans l’au-delà au péché originel en compagnie d’Alan Parsons. Le paradis, quoi. Sauf que l’on avait encore aucune idée de son étendue. Car dans des registres pourtant radicalement différents, le reste de Modern Guilt est à l’avenant. Si l’on parle souvent de la capacité de Beck à se réinventer, le sang neuf arrive ici par transfusion. Dangermouse, producteur costaud (sic) croisé au chevet de Mark Linkous ou Gorillaz, a été chargé de soigner la forme en lieu et place des habituels Dust Brothers et Nigel Godrich, autrefois collaborateurs privilégiés du Californien. Dès Orphans, morceau introductif où Chan Marshall fournit des chœurs tout en vapeurs d'éther (tendez bien l'oreille, elle apparaît aussi un peu plus loin sur Walls), la moitié de Gnarls Barkley apporte une attention toute particulière aux pulsations. Réguliers ici, haletants là, les beats constituent l'organe principal du disque, et fournissent par leur diversité un contrepoint idéal à la léthargie vocale du chanteur. Tous deux capables des plus impressionnantes pirouettes stylistiques, le songwriter et le producteur parviennent sans surprise à sublimer les genres, du surf sixties de Gamma Ray au R&B le plus actuel de Youthless (avec claviers vintage façon Grandmaster Flash). S'ils se vautrent dans la facilité d'un Replica qui porte bien son nom tant il rappelle Radiohead période Kid A (2000), sur l'enlevé Profanity Prayers, l'envoûtant Volcano et le précieux Walls (érigé autour d'un sample d'Amour, Vacances Et Baroque de Paul Piot et Paul Guiot), les deux forment une paire aussi fusionnelle qu'idéale. Que trouver à redire enfin sur l'éponyme Modern Guilt, uniquement coupable d'allier l'efficacité du Feel Good Inc. de Gorillaz à la féminité du My Moon My Man de Feist ? Pas grand-chose. Beck is back, et ceux qui le voyaient déjà un pied dans la tombe peuvent aller creuser ailleurs . (Magic)
C’est une rumeur bébête qui avait couru sur les pelouses du parc de Saint-Cloud lors du dernier passage parisien de Beck, il y a deux ans au festival Rock en Seine : l’Américain, devenu adepte de la scientologie, imposerait désormais de nouvelles conditions lors de ses déplacements professionnels, et interdirait notamment à qui que ce soit (dont son kinésithérapeute) d’oser le toucher. Soit. On appréhendait donc un peu la rencontre avec l’artiste la semaine passée, quelques minutes avant sa présentation, sur la scène de l’Olympia, de son nouvel album Modern Guilt. On avait tort, Beck nous a très ordinairement serré la main et s’est confié tout aussi simplement, ravi d’en avoir terminé avec la phase d’enregistrement. “Cette période a été intense. Nous avions assez peu de temps et avons dû travailler tous les jours jusque tard dans la nuit. Je jouais les instruments tout en écrivant les chansons car j’aime composer les morceaux en studio. Tout ça m’a demandé une concentration immense, j’ai mis toutes mes compétences au service de cet album. Je n’avais aucune pitié envers moi-même, je ne me suis pas fait de cadeau. J’en suis sorti épuisé mais je suis convaincu que le disque nécessitait ces efforts. Je dois travailler dur, je pense que ma musique pourrait être franchement médiocre si je ne m’imposais pas cette rigueur. Je suis de plus en plus maniaque.” Une autodiscipline et une exigence qui ont poussé Beck à poursuivre la belle aventure qui depuis des années le lie avec la sainte famille des producteurs, puisqu’après avoir remis ses chansons entre les mains des Dust Brothers et de Nigel Godrich sur ses précédents albums, le blondinet a cette fois-ci fait appel au décidément boulimique Dangermouse. “J’avais envie de travailler avec Dangermouse depuis un moment et je me suis dit qu’il fallait saisir l’occasion avant qu’il ne devienne totalement inaccessible. J’aime le fait qu’il garde toujours une oreille dans le hip-hop et les musiques électroniques, et l’autre dans le rock expérimental. C’est difficile de trouver une personne qui partage votre sensibilité musicale et nous avons en commun cette ambivalence, ce penchant pour des styles de musiques différents. J’ai consacré beaucoup de mon temps à réconcilier ces extrêmes et je me suis dit qu’il pourrait comprendre ça.” Né à Athens en Georgie, ville à l’histoire rock riche et célèbre (B-52's, REM, le collectif Elephant Six), DangerMouse a cependant grandi dans la très hip-hop cité d’Atlanta, fief d’Andre 3000 et Big Boi (Outkast) ou encore de Cee-Lo, avec qui il forme la géniale paire Gnarls Barkley depuis quelques années. Aussi, quiconque a déjà lu le CV de Beck comprendra vite le béguin du chanteur pour l’éclectisme du producteur : après avoir été élevé par un père arrangeur de cordes puis une mère danseuse pour le Velvet Underground (et régulière de la Factory d’Andy Warhol), Beck s’est rapproché de son grand-père, représentant du mouvement artistique Fluxus. De cette multitude d’influences, il a conservé un goût certain pour la diversité musicale, qui l’a poussé à emprunter les détroits de l’anti-folk et de la pop, mais aussi du hip-hop, de la soul et du punk pendant quinze ans. Et qu’on retrouve aujourd’hui encore au cœur de Modern Guilt, album aux influences bigarrées bien qu’à l’enveloppe ostensiblement rock. “J’avais envie de composer un album rock, avec certains aspects classiques, sans jamais tomber dans la variété ou la répétition. Je voulais quelque chose de frais. J’arrive à un moment de ma carrière où il devient difficile de ne pas radoter. J’ai déjà fait beaucoup de choses, et avant moi des tas de gens avaient fait des tas de choses. J’avais en tête l’idée d’un album court, d’une demi-heure. Un disque assez concis pour que n’importe qui puisse l’écouter d’une traite. Je tiens beaucoup à l’idée de l’album, au fait que les chansons coexistent. Une chanson comme Norvegian Wood des Beatles dure deux minutes et elle est pourtant parfaite. Avant, on pouvait mettre trois fois Norvegian Wood dans mes morceaux. Cette fois, j’ai essayé de dire plus avec moins. Je sais aujourd’hui qu’on dissimule souvent la pauvreté d’une chanson derrière des arrangements, des longueurs. Là, je voulais qu’on voie le squelette.” Or si squelette il y a, la colonne vertébrale de Modern Guilt tient en deux chansons, fantastiques : l’introductive Orphans, d’une part, avec ses grosses bobines de batterie en cascade, qui pourrait ressembler au fruit d’une improbable rencontre entre un Kurt Cobain slacker et les magiciens fous de feu The Beta Band. La gigantesque Chemtrails, d’autre part, au refrain colossal clairement estampillé 1968 et à la basse en culbuto. Aussi bête (et peu sexy) fût-ce à dire, et n’en déplaisent aux scientologues : le batteur et le bassiste touchent. Choyant l’emballage de ses chansons comme peu de ses contemporains, Beck déballe une section rythmique diabolique, d’ailleurs parfaitement en place lors du concert à l’Olympia. Invitant par ailleurs la savoureuse Chan Marshall de Cat Power à poser sa voix sur deux titres, Beck agence au final un album à la fois parfaitement rétro (l’irrésistible Gamma Ray) et terriblement moderne (les boucles de Replica). Et se paye le luxe de réserver, six mois avant Noël, une place d’honneur sur le podium des disques de l’année. (Inrocks)
J'irai droit au but : Beck nous livre ici une pièce magnifique. Je pourrais même aller jusqu'à dire sa meilleure. On savait l'Américain particulièrement doué, mais il faut bien admettre que ses albums ont toujours eu du mal à convaincre de bout en bout (à l'exception d'"Odelay", peut-être, et encore !), tant le touche-à-tout a une fâcheuse tendance à les polluer avec un tas d'incursions dispensables, voire carrément énervantes et/ou inintéressantes. Eh bien, ce n'est pas le cas de "Modern Guilt", qui colle admirablement bien à la route, sans jamais, ne serait-ce qu'un instant, feindre le dérapage. Alléluia, enfin un disque du Sieur Hansen que l'on peut écouter d'une traite (en même temps, il ne dure que trente-trois minutes), et réécouter et réécouter encore -bref, le pied quoi. Mais quelle est donc la clé de cette réussite ? Serait-ce la superbe production signée Danger Mouse (aux manettes sur "The Grey Album", mashup du "White Album" des Beatles ; ou encore sur l'album de "The Good, the Bad and the Queen") ? La maturité peut-être ? Il y a sans doute un peu de tout cela. Outre les qualités nées de sa collaboration avec Danger Mouse, Beck confie avoir travaillé sur cet album comme jamais il ne l'avait fait auparavant. Et plutôt que de s'évertuer à dissimuler des failles derrière des arrangements stériles, il a préféré se concentrer sur la qualité et exprimer, en un minimum de temps, plus qu'il n'en aurait dit, par le passé, sur la longueur. Le résultat : un diamant ouvragé, étincelant et exempt d'impuretés. De quel plus joli mea culpa pouvait-on rêver ? Le précieux joyau compte donc dix facettes, toutes plus brillantes les unes que les autres. Au menu : la marque de fabrique Beck, définitivement vintage, mêlant excellemment sonorités modernes ("Replica") avec l'atmosphère sixties / seventies. Ce serait tenir un discours creux que de vouloir en dire plus. Je n'ai même pas envie de vous parler de l'intervention futile de la pourtant talentueuse Chan Marshall (Cat Power). Non, tout est dit et, à l'instar de Beck, je préfère me concentrer sur l'essentiel plutôt que de m'étendre inutilement sur le sujet en enfonçant des portes déjà grandes ouvertes. Allez hop ! Filez donc acheter ce splendide album.(Popnews)
Beck est une éponge. Un homme imprévisible qui, toute sa vie, aura absorbé de multiples influences. Toujours, il aura su multiplier les ambiances, les humeurs, conserver intacte son intégrité, sa curiosité, sa soif de nouvelles expériences. Qu’on lui parle de hip hop, de folk, de rock, de RnB, de garage, ou même d’electro, n’ayez crainte, le blondinet aura toujours du répondant. Pour son dixième album qui marque un retour vers les labels indépendants, “Modern Guilt” renoue avec un registre plus grave que sur les précédents disques, celui qu’on avait laissé lors de “Sea Change”, une de ses oeuvres références qui n’avait pas encore connu d’équivalent jusqu’ici. Mais Beck n’est pas le seul responsable de ce retour gagnant puisqu’il a trouvé en Dangermouse un acolyte de taille avec qui il forme une belle complémentarité. Tous deux capables de grands écarts entre vieille et nouvelle école, ils parviennent ici à un condensé de sa discographie, assez fin pour que ce nouvel album détienne lui aussi une réelle cohérence. Même lors des relents drum n’bass de “Replica” comme inspirés de Radiohead. Une fois encore, la pochette trahit le contenu en affichant une imagerie qui renvoie vers la sombre pop psyché des sixties, fil rouge de ce “Modern Guilt” et marque de fabrique du producteur qui ne s’en est jamais caché jusqu’ici. Que ce soit au sein de Gnarls Barkley (à qui il aurait mieux fait de léguer l’écoeurant “Gamma Ray”), The Good The Bad And The Queen, Martina Topley Bird, ou avec The Black Keys, la patte de Dangermouse s’entend (”Orphans”, “Youthless”) et fait inévitablement le lien entre tous. Pourtant, on ne serait pas loin de dire que Beck restera peut-être comme sa collaboration la plus fructueuse, tant la majorité de ce disque sonne le plus naturellement du monde. Suivez mon regard: le blues incandescent de “Soul Of Man”, le rugueux “Profanity Prayers” dans le sillage de Queens Of The Stone Age, le single “Chemtrails”, seul titre sur lequel le producteur n’y va pas d’un beat ou d’une boucle… Chose plus évidente qu’auparavant, Beck accouche ici de ses plus belles mélodies vocales, les plus simples et efficaces aussi (”Modern Guilt”, “Walls” et “Volcano”, à jamais un de ses plus beaux titres), pourtant toutes portées par des thèmes lestés de paranoïa et de mal être dans la société actuelle. À plusieurs reprises en effet, il choisit de s’attarder sur l’état du monde dans lequel il vit, celui des guerres, du terrorisme, des préoccupations écologiques, et de toutes ces maladies modernes qui l’aident à dresser un bilan effrayant. Bien qu’il opère un radical changement de cap en revenant à un registre beaucoup plus sombre et concis (dix titres pour une demi-heure environ, on est loin de l’abondance des deux précédents albums), Beck reste Beck, avec son sens de la mélodie à lui, ses guitares surf, ses synthés rétros et ce fun (si, si…) qu’il faudra cette fois plutôt aller chercher dans le fond que dans la forme. Différent de tous ses aînés mais tout aussi indispensable à l’intégralité de son oeuvre, “Modern Guilt” reflète parfaitement son époque. Il est aussi la preuve, en musique, qu’on peut véritablement s’amuser en mélangeant les étiquettes. Et Beck comme Dangermouse ont toujours été des maîtres en la matière. (mowno)