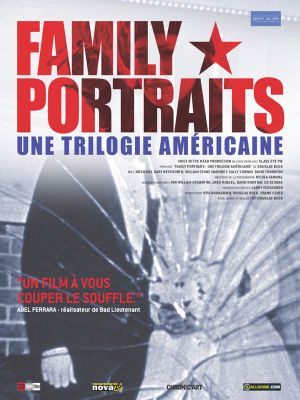Family Portraits par Zogarok
Family Portraits est une trilogie, un work in progress composé de deux courts et un moyen-métrage empilés. Ce triptyque réunissant les premiers travaux de Douglas Buck gravite autour du même sujet. Il expose des corps sans raison, des organes sans foi, des hommes sans orientation. Le premier film est cauchemardesque, le second abominable, le dernier désespérant. A chaque fois tout est vrai, le cinéaste relie le dérisoire neurasthénique et l'essence blessée, présentant une anthologie de la souffrance avec un regard absolument naturaliste, inspirant la terreur d'une âme virginale devant l'horreur d'une venue au monde dans la désillusion.
Contrairement à ce que suggérerait une grille de lecture schématique, Douglas Buck n'a pas un problème avec l'Amérique mais avec la race humaine : il connaît ses zones d'ombre, ses faiblesses et ses détresses les plus sordides. En effet il n'y a pas de propos social objectif et référencé, et le cadre mélancolique et neurasthénique des 60s, de la middle class US ou celui de l'Amérique rurale désenchantée pourrait trouver des substituts : simplement il correspond à merveille aux besoins de la description de Buck. L'anachronisme de ces portraits ne servent pas un quelconque discours sociétal et les envisager ainsi serait un contresens ; ils servent une peinture à la fois subjective, personnelle (à la nostalgie paradoxale) et universaliste. Le sujet est la famille livrée à elle-même, tapie dans un coin de la civilisation, ou carrément absente et suffisamment repliée pour devenir le théâtre des angoisses les plus sordides, celui où jaillit et imbibe les murs le morbide le plus sourd et imperceptible.
Le grand sujet de Family Portraits, c'est la dégénérescence galopante demeurée à l'intérieur d'une société épanouie et plus encore, la rupture avec le monde réel et avec l'existence. Pour ses personnages, c'est comme s'il n'y avait plus de lien à la vie, sociale bien sûr, mais générale, même intime. Gris et invisibles, ils sont déjà rendus dans le couloir de l'extinction. Ils ont dépassé le cap où on redoute la mort ou l'oubli ; nullement dissociés, ils habitent pourtant un corps fardeau et sont totalement desséchés. Leur contenance et leur vitalité appartient déjà à une ère antédiluvienne (premier court), voir n'a jamais été (second) ; dans le dernier film pourtant, cette vibration intérieure presse encore et s'agite comme s'il y avait moyen de ressusciter ; il y a là une force qui n'est plus accessible à la femme du premier film. Si elle poursuit désespérément cette vibration intérieure, elle n'est plus en état de comprendre ce qui l'anime.
Le premier film, Cutting moments (1997) nous entraîne totalement au-delà du monde sauvage, car dans celui-ci les individus retrouvent leur force primitive ; or ici leur instinct de survie lui-même s'est évanoui. Il évoque l'horreur d'être né pour une femme réduite à sa chaire elle-même devenue artificielle. Le spectateur est précipité auprès d'un couple évanescent, dans un contexte où ils ne sont plus accessibles ni à la conscience, ni à la culture ; et même plus à leur nature. Des objets inertes, aliénés, sans limites, ouverts et cloîtrés sur le néant, perdus au milieu de l'abîme le plus terne et définitif. Le geste si dérangeant de la femme délaissée foudroie par sa virulence gore, mais il ne fait qu'affirmer sa fureur sourde et sa frustration. Il ne rassure pas, car il porte au comble de l'horreur ; mais il apporte un échappatoire, une réponse définitive, à un délabrement immuable et global et en cela, cet auto-destruction est une délivrance. La plus ignoble mais la seule, l'évidente.
Home (1998) prend un chemin différent. Il emmène regarder ce qu'il y a de candide et d'élémentaire avec un désespoir froid, sans aucune introspection consentie, plutôt dans le carcan du prisonnier d'un présent inhibant, donc sans alternatives. Moins déroutant que les deux autres, il plonge cependant sur un sujet beaucoup plus prégnant, commun et usuel, en présentant un homme atrophié, intégré socialement par défaut. Le thème est tellement trivial et jamais on aura senti à ce point au cinéma la toxicité de cette absence (à soi comme au reste) partagée (un homme et une femme totalement épurés et leur fille, otage évanouie encore trop jeune pour essayer de se consumer et disparaître de cet antre fonctionnel et spectral). Le personnage central de Home est un normopathe par compensation et défense devant le vertige : au premier abord, vivre est une maladresse, une fatigue, un hasard vain. Mais plus avant, on saisit que cette réalité est beaucoup plus coriace et dérangeante, car vivre sans être ni s'animer est une prison et une punition de chaque instants. Cette fois encore le monde civilisé a été abandonné, mais le père dogmatique s'y accroche pour esquiver ce malaise, ce cri intérieur inaudible et déchirant : sa connexion empruntée et factice est celle du fanatique aveugle non par passion, ivresse ou illumination, mais parce qu'il est une toile vierge qui doit se remplir pour éviter d'être balayée. Pourtant il y a bien ces tentatives de fusions, cette quête d'émotion partagée, le père s'intéresse à fille et tente d'exprimer un affect sincère. Il y a encore une chaleur, ou son invocation, et la vague sensation d'une vérité qui n'est pas là, ou bien trop loin – mais la lumière n'est nulle part et là encore, Buck montrera une famille cédant, de dépit, au retrait et à la froideur absolue, par l'auto-consumation la plus brutale, la marque de déception face à la condition humaine la plus flagrante et laide.
Le troisième fragment, le plus long, invoque et met à l'épreuve toute l'empathie et les tripes qu'on puisse contenir. Prologue (2003) est aussi celui qui nous libère des enfers pour nous engluer dans une réalité triste, mais une réalité enfin, une condition émergée. Le malaise devient plus limpide (et manifeste - au point d'être caricatural compte tenu des jaillissements tétanisants ayant précédé), plus proche de l'homme du quotidien ; puisqu'on se débat dans la vie, sans jamais l'ignorer, juste en la subissant. C'est terrifiant et ça vous retourne l'âme, mais il y a des morceaux d'espoirs, des élans, une rémission possible ; et parce que c'est seulement terrifiant et atrocement humain, il y a aussi l'envers, l'aptitude à surmonter le mal et le pourri. Ce dernier film, d'une beauté sidérante, envisage l'après, alors que les précédents n'avaient plus de références spontanées et mobiles, ne serait-ce que celle du temps. Sa noirceur est omniprésente mais les efforts auxquels on assiste la gomme déjà : on sait que plus rien ne sera jamais heureux, mais au moins la vie est possible et il n'y aura pas besoin de la simuler. Et la douleur a un nom alors même quand elle est atroce, elle n'est pas seulement à l'intérieur : la désolation est dehors et dehors, on peut réparer et les autres sont là pour ça aussi. Réparer et être réparés.
Ces trois séquences sont le théâtre d'individus qui ont rompu, ne sont plus sur la scène de la vie. Ils ne se sentent plus, ou alors seulement comme des symptômes blafards, des boursouflures, mais de rien ni de personne. Mais il y a des nuances, entre la vie avortée et impossible (Cutting), la vie intenable et psychotique (Home), la vie frustrée et ratée (Prologue). Si le second morceau marque un traumatisme et une non-vie, le premier égare vers une vie non pas suspendue, repoussée ou travestie, mais annulée ; le troisième en revanche marque un retour à la vie, avec la conscience et l'implication, ou au moins le lien, au monde autour. Ses personnages éprouvés voient d'autres vivre et même s'ils peinent, même s'ils le font mal, ils font face à une noirceur et une abîme identifiée. Il n'y a pas cette humanité dans le second (Home) où il s'agit de composer avec, sans jamais trouver de ressource ni de subterfuge, sans d'ailleurs rêver d'une délivrance qui trahirait l'échec ; c'est encore moins pire que dans Cutting où non seulement il n'y a pas de recul sur cet abîme, mais où on y est enseveli au point qu'on ne se rappelle plus d'aucun mythe, même pas des siens ni d'avoir pu exulter.
Family Portraits permet de voir la vie comme jamais on ne veux la subir ; somme toute, tous nos efforts sont exécutés afin d'éviter exactement les états inhibés ici. Chacun ne poursuit rien d'autre que les substituts de ses instincts les plus vitaux ; or cette morale organique échappe aux personnages du film et c'est pour ça qu'eux connaissent l'horreur réelle, cadenassée et irréversible. Ainsi ce chef-d’œuvre est plus nocif et percutant qu'un document à charge politiquement téméraire qui remettrait à plat quelques certitudes parmi les plus élémentaires sur l'Histoire telle que nous l'avons apprise ; c'est un brûlot fou contre les recoins de vie et de mort les plus repoussants mais tapis, prêts à surgir lors des radicaux mouvements de régression et de solitude. Ce film, comme nul autre, pose ce que tout le monde réprime, lève le voile sur ce qui, en vérité, nous écorche et nous angoisse.