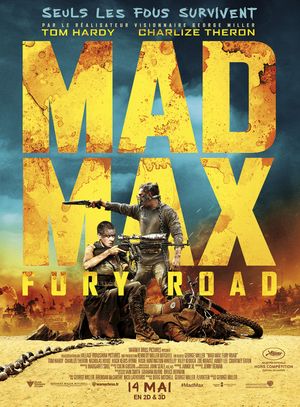Immobile, presque résigné, Max, regard vers le vide, est comme le spectateur ; il se fera happer par la monstruosité mouvante de Fury Road. La furie est là. Radicale. Hystérique. Courbé dans son univers post apocalyptique où l’eau devient le symptôme du pouvoir et de la domination, George Miller décide de redistribuer les cartes de sa propre mythologie Mad Max où il sera question de la subsistance de la femme et donc de l’humanité en quelque sorte. Dans une imagerie freak, où la difformité en devient presque une norme, dans la veine lointaine d’un Total Recall de Paul Verhoeven, le sable et le néant l’emportent sur l’environnement, où se jouent alors, une course poursuite vers l’espoir et la rédemption, une quête démesurée vers un foyer propice à l’émergence, une virée en enfer tonitruante dans les tempêtes les plus rutilantes.
Car, oui, Fury Road fait part belle aux femmes, à sa survie, à travers un monde à l’espoir infime qui voit la naissance perpétrée par la gente féminine dépouillée par la violence et la destruction engendrées par l’homme. Malgré l’iconisation visuelle de Max, d’emblée, l’homme solitaire et intraitable, devient une proie, un loup égaré qui se laisse approcher, une marionnette prise en otage, une petite sirène qu’on attache sur le capot de la bagnole comme le simple trophée d’une partie de chasse entre amis. Un globulard qui se ronge, un male alpha presque castré, loin de l’image du vagabond invincible l’on peut avoir de lui, même si ce dernier au cours du long métrage, montrera toute sa singularité quant aux enjeux déployés. D’ailleurs, sans avoir rien à redire sur la prestation de Tom Hardy, mi animal mi psychotique, les insertions peu subtiles des flashbacks qui poursuivent son personnage ne sont pas la meilleure idée du film, participant à l’émotion un peu too much du film.
Il n’empêche, que c’est de là, que Fury Road tire toute sa force, cette façon de phagocyter son propre mythe, de s’amuser des attentes et de se jouer des temporalités. De ce monde binaire, où l’homme combat la femme, où la musculature athlétique torture la sensualité féconde, où le monde d’en haut gouverne celui d’en bas, où les esprits faibles s’endoctrinent jusqu’à se tuméfier et se tuer pour une cause évocatrice, la seule issue s’appelle Furiosa. Son look androgyne, son ambiguïté existentielle, son rôle de chef militaire aux blessures de guerre palpables, fait de Charlize Theron, un personnage inclassable, entre attirance évidente et répulsion malsaine, non sans rappeler une Sigourney Weaver d’Alien. Un personnage, un vrai, celui qui marque au fer rouge. L’anti héros dans toute sa symbolique qui s’entrecroisera avec l'animalité de Max.
Ainsi, Fury Road, empoisonne son univers de toute sa hargne, de sa haine, de sa vélocité, et pourrait se retranscrire comme une sorte de western sur roues gonflées à l’adrénaline et au Red Bull, qui jonglerait avec l’esprit chancelant d’un Tex Avery. Une œuvre qui ne baisse jamais sa garde tout en plaçant ses coups avec minutie. Un film profondément ancré dans son temps qui se bat envers une certaine idée du féminisme, la déshumanisation d’une espèce, une protection des ressources naturelles, la réflexion sur l’embrigadement pour une mort salutaire d’une guerre sainte destructrice, mais s’accoquine de son versant cinématographique 80’s. C’est un rouleau compresseur, grandiloquent, où les carambolages et les explosions fructifient le rythme technique et narratif du film dont l’errance physique des uns et des autres se supplantent aux fêlures psychologiques d’eux-mêmes. Chaque poursuite, chaque course, chaque démonstration détient ses propres enjeux et finalités, s’octroie son propre montage démentiel.