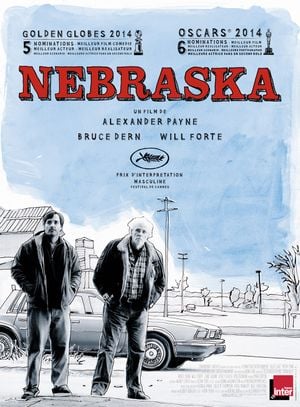« You’d drink too if you were married to your mother »
Vieux, acariâtres et sans-gêne : il faut un certain temps pour s’adapter à la singulière antipathie des personnages que l’on va devoir fréquenter deux heures durant. Forcés, avec David, le fils patient, de lever les yeux sur ces reliques d’un autre temps et d’un autre monde, dans un noir et blanc à la fois légèrement prétentieux et pudique.
Les pièges sont nombreux sur une trame aussi éculée : le road movie, la découverte du passé d’un père jusqu’alors mutique, la vision pseudo insolite d’une Amérique provinciale et paumée, la tendresse retrouvée… A un détail près, la musique, trop présente et typique du film indé américain, un peu irritante.
Le film fonctionne sur un principe constant : la désactivation. Les composantes traditionnelles de ce type de film sont systématiquement dénuées de leur potentiel pathos, à commencer par les vertus de la communication : le silence serait souvent préférable à ce qui se dit dans les échanges familiaux. Entre l’incapacité du fils à raisonner son père, le fiel constant de la mère (notamment dans cette très drôle et acide visite au cimetière où l’éloge funèbre tourne au jeu de massacre) et les malaises phatiques des retrouvailles, rien ne fonctionne.
Face à ce rempart, David, diplomate, l’effroi poli dans les yeux, qui continue d’avancer. Pudeur et silence sont les seuls armes qu’il oppose à ce déploiement d’amertume et de rancœur qui va trouver toutes les raisons de se réactiver durant les retrouvailles avec la famille laissée dans le bled des origines. Figés dans un passé qui ne passe pas, coupés du monde, ces bouseux ont au moins le mérite de nous rendre attachants ceux qu’on méprisait au départ.
De temps à autre, par petites touches, affleurent à la surface des souvenirs qui composent une vie passée violemment émouvante et nous rendent subtilement attachants les vieillards qui la traine avec peine.
L’autre trouvaille du récit est ce pseudo élément perturbateur généré par l’annonce publicitaire du gain d’un million de dollar que le père prend au pied de la lettre. Toute la motivation du récit est là aussi désactivée à l’avance, et met en place une petite comédie humaine pour les désespérés, où l’on s’accroche avec enthousiasme à cet Eldorado de pacotille avant de mépriser celui qui a apporté ce brasillant mensonge, honteux qu’on est de l’avoir partagé un temps avec lui. Le quiproquo, souvent drôle, est surtout assez féroce sur la vision qu’il propose de la famille et des convoitises, où la cohorte des losers se presse en compliments intéressés, sorte de Fargo sans crime où la médiocrité atteint des sommets.
Le parcours de muera en tentative de réconciliation : avec un passé, avec ses rêves, avec ceux qui sont condamnés à rester les membres de notre famille. Modeste, à hauteur d’homme, celle-ci se soldera par le déchiffrement de quelques-unes des énigmes du regard livide du père traversé çà et là par de brillants soleils.
S’il valait mieux se taire que parler, trouvons au moins du charme au mensonge : du million de dollar, il reste une casquette, et le dévouement du fils au père, qui filera la mise en scène pour combler les désirs somme toute bien modestes de son géniteur : solder ses comptes avec son passé, et transmettre à ses fils ce petit fragment du rêve américain qu’est le « brand new truck ». La parade finale qui achève le road trip, émancipation du père sous l’œil complice du fils, n’est pas parvenue à se défaire totalement de l’illusion et du recours à la supercherie pour accepter de continuer à vivre ; mais si le silence sur la vérité demeure, il s’accompagne désormais de quelques sourires.