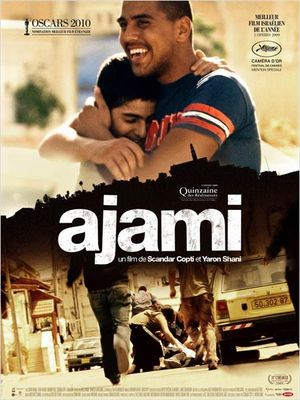Associant deux jeunes cinéastes israélien et palestinien (Scandar Copti et Yaron Shani) pour leur premier long-métrage, Ajami a été salué unanimement par la critique, la presse, récompensé au Festival de Cannes comme à la remise des Ophirs israéliens (équivalents des Oscars ou des Césars). On a loué son naturalisme (vaguement scorsesien), sa puissance et son originalité dramatique : il faut dire qu’il se distingue par une mise à l’épreuve originale du casting, tout entier recruté auprès d’amateurs issus du contexte de violence et d’agacements inter-ethniques représentés à l’écran. De plus, ces acteurs néophytes n’ont eu le plus souvent droit qu’à une seule prise, où des homologues leurs soufflaient des répliques inattendues, ou les précipitaient dans des retournements fraîchement annoncés par les réalisateurs.
C’est donc un film choral avec tous ces destins croisés qui sans raison, alors qu’ils se côtoient mais s’ignorent et se fuient chaque jour, se trouvent soudain précipités dans des face-à-face inextricables jusqu’à devenir chair à climax péremptoire. Élémentaire, le film s’en tient à représenter les tensions entre Arabes, Juifs, Musulmans d’Ajami (quartier populaire de Jaffa) tout en jouant sur la fibre des amoureux de petit théâtre de l’absurde agrémenté d’humanisme déphasé-mais-avec-une-pointe-d’espoir au bout du tunnel.
Ce qui est agaçant avec un tel objet, c’est qu’il ne se prête ni à l’analyse, ni à l’opinion ; il est plutôt propice à servir d’illustration dans le cadre d’un éditorial, d’exemple à la sauvette. En ré-actualisant les tics du film noir et tissant une toile tragique (fruit d’un scénario élaboré sur six ans) à la Roméo & Juliette (amours impossibles et haines éternelles, enracinées jusque dans les murs), Ajami parvient à convertir sa banalité ambulante en support audacieux. Or il passe son temps à mettre à distance un sujet sur lequel il n’a rien à ajouter ; et dans le même temps, alors qu’il semble vouloir le laisser parler de lui-même, il l’inhibe par la conjugaison plombante de son non-interventionnisme et de son écriture foisonnante, dispersée et redondante.
La volonté documentaire écrase le film, l’embourbe dans un déroulé maladroit, en accumulant les poses vivaces comme des données sociales empiriques. L’œuvre n’y gagne rien, déguisant son impuissance à dresser un véritable état des lieux. Le réalisme clinique et le pathos criard et revendiqué s’accordent mal, débouchant simplement sur un produit superficiel et sans volonté claire.
Comme souvent lorsqu’il s’agit d’illustrer l’atmosphère dans l’état Israélien, Ajami manifeste ce mélange d’universalisme froid et bizarrement compartimenté, d’absence de vision et de sens profond, seulement capable d’aligner une chronique en arborescence, parée pour être dégoulinante et paradoxalement tout à fait platonique et banale.
En cela, le film ne trahit pas son sujet car il traduit bien le fatalisme qui règne sur cette région du Monde. Sa façon d’éclairer et mettre en parallèle des vécus différents d’un même contexte relève toujours de ce même pacifisme mou, qui n’oserait pas dire son nom (contrairement au crânement candide et libertaire The Bubble). Partant, l’œuvre elle-même est en quelque sorte le fruit du hasard, un produit non-désiré et pourtant peaufiné à fond, existant comme en sursis. Ajami est bien un symptôme fidèle, son absence de franchise, son incapacité à confronter le réel même lorsqu’il est face à soi en atteste.
https://zogarok.wordpress.com/2015/05/09/ajami/