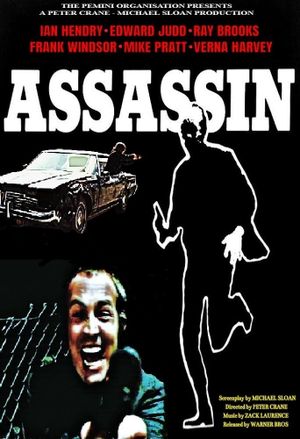Assassin s’efforce, par son imagerie et par son scénario, de déconstruire l’image des Swinging Sixties, opposant à l’esthétique pop et à la frénésie joyeuse qui gouverne les soirées dansantes un urbanisme froid et anxiogène dans lequel évolue notre tueur à gages, dépourvu de nom et d’histoire sinon par l’indication d’un agent du MI5 l’informant qu’il le trouve vieilli. Le film veille ainsi à mettre en parallèle, tantôt par un montage croisé tantôt par des lieux symboliques communs telle la chambre à coucher, immaculée d’abord – celle de l’hôtel – qui se réchauffera dans les bras de l’amante, ces deux dimensions qui forment une brèche dans l’identité londonienne à même de restituer un climat paranoïaque de surveillance et d’oppression dénoncée quelques années plus tard par le mouvement punk. La course-poursuite dans un entrepôt désaffecté, séquence rémanente qui transpose la peur en abstraction, rejoue l’accident qui elle aussi revient hanter notre protagoniste.
Notons d’ailleurs l’obsession manifeste pour les miroirs, les vitres et toute autre surface réfléchissante, sans oublier les dispositifs d’espionnage comme l’appareil photo miniature ou les portiques de l’aéroport, ainsi que les recherches artistiques menées par la réalisation et par le montage pour figurer cette réflexion des corps perçus selon des points de vue subjectifs auxquels participe d’ailleurs la caméra – voir à ce titre la sortie de l’aéroport, avec de beaux mouvements d’appareil parmi de véritables passagers comme si nous scrutions, tapis dans l’ombre, les déplacements du tueur à gages. Une curiosité anglaise qui mérite le coup d’œil, en dépit d’expérimentations formelles quelque peu envahissantes.