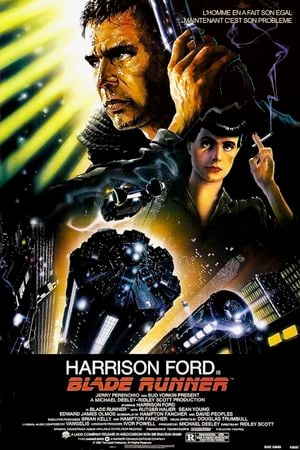Ouverture nuit, une ville sous la pluie, monstre endormi mais paré d’enseignes publicitaires lumineuses, tâches de lumières dans le noir. Apparaît une voiture volante et monte doucement la musique de Vangélis. En quelques instants, quelques images furtives, ce que sera Blade Runner coule de source, un film d’anticipation intimiste et éternellement unique dans l’univers de la science fiction au cinéma.
Deux quêtes opposées s’affrontent, celle de Deckard, chasseur chargé d’apporter la mort à des réplicants qui, à travers le personnage de Roy tentent eux de gagner du temps sur une vie dont ils ne connaissent pas la date de péremption. Cette quête est au fond celle de chacun d’entre nous, celle d’une curiosité malsaine qui nous pousse à vouloir connaître envers et contre tous l’heure à laquelle la grande faucheuse viendra nous abattre.
C’est par l’intimité que Ridley Scott donne vie à cette lutte entre deux personnages, peu de plans panoramiques mais beaucoup de plans rapprochés, au plus près des scènes et des personnages enveloppés par une obscurité bienfaisante et oppressante. L’obscurité et la pluie semblent le dernier combat d’une Nature repoussée au loin par une civilisation amenée à son point culminant d’artificialité et symbolisée par l’existence d’êtres humanoïdes.
Mythe lui-même, Blade Runner multiplie et explore les références universelles qui ont fondé la philosophie à travers l’histoire de l’humanité. Qu’il s’agisse de Frankenstein, du complexe d’Œdipe ou, bien plus largement de la question du divin et de savoir s’il faut réserver à Dieu le droit de donner la vie, Ridley Scott prend le temps, à travers un univers onirique, de donner vie à l’une des plus belles paraboles cinématographiques.
L’âge de ce film semble à peine croyable tant tout semble avoir été posé sur pellicule la veille et, c’est sans doute l’une des plus belles réussites, avoir su créer un univers visuel qui semble pouvoir communiquer des émotions universelles à travers le temps et l’espace. Scott a trouvé un langage qui parle à tous et qui, à travers une œuvre visuellement parfaite, parvient à faire que tous, nous parvenons à appréhender les lourdes questions qu’on nous pose.
C’est les larmes aux yeux qu’on assiste à la fin de Roy, à cette longue tirade, tour à tour leçon d’existence, d’un être qui sait sa vie courte, quasi sermon d’un prêcheur qui réclame le droit à la « vie » pour lui et les siens. Cette courte scène résume à elle seule le film, à la fois renoncement à une existence qu’on lui refuse, mais aussi pensée d’espoir d’une vie pleinement vécue, peut-être plus que ne l’ont fait ses créateurs.
Alors que reste-t-il ? Peut-être la vraie grande question : Qu’est-ce que la vie ? Peut-on d’ailleurs en donner une définition ? S’agit-il de notre état de créature nées de la nature, dotées d’un cœur et peut-être d’une âme ? Ou alors est-ce une aventure ? Celle de la soif de connaissance, du goût de l’aventure et des autres, et peut-être et surtout pour Roy, avoir enfin une conscience pleine et entière de soit. Sans doute le plus difficile.