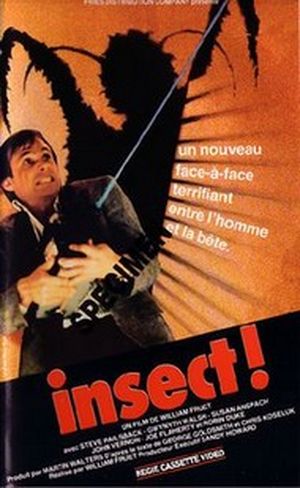Blue Monkey associe une couleur – le bleu, omniprésent durant tout le film – à un animal – le singe – souvent utilisé comme cobaye dans les laboratoires mais qui paraît ici davantage constituer la métonymie d’une maladie contagieuse venue de Micronésie. Du singe à la fourmi géante en passant par l’homme qui court en tous sens, il n’y a qu’un pas, qu’une série de transformations d’autant plus intéressantes qu’elles évitent l’apparition ex nihilo du monstre mais le construisent mutation après mutation, expérience après expérience. La réussite de ce modeste long métrage de série B réside dans le geste artistique d’une caméra en mouvement permanent qui capte l’effroi sur des visages en gros plan, qui poursuit les personnages dans des dédales de couloirs délabrés et allumés par des néons bleu conférant au sous-sol des aspects électriques et inhumains.
Tout cela recopie allégrement Aliens de James Cameron, sorti un an auparavant (1986), mais reconnaissons qu’il s’agit là d’un plagiat artisanal en ce sens où le réalisateur et son équipe refusent (n’ont pas les moyens) de recourir aux effets spéciaux numériques pour se cantonner au costume latex et autres assemblables plutôt répugnants à voir, donc plutôt réussis : les scènes de ponte ou de consommation des corps vivants réussissent à engendrer une sensation de malaise, rappelant au passage les mutations traumatisantes de The Thing signé John Carpenter (1982). En résulte un petit film cliché qui n’a pour intérêt véritable que d’attester l’impact esthétique des modèles qu’il décalque avec les moyens du bord. Moyens doublés d’une créativité suffisante pour divertir, même inquiéter à quelques (rares) occasions.