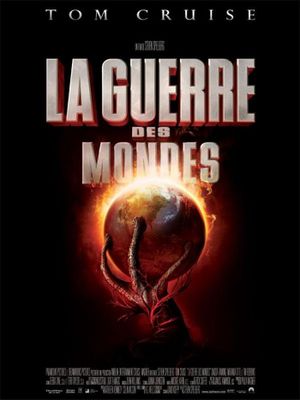Dès La liste de Schindler, la filmographie de Steven Spielberg aura pris une tournure résolument plus réaliste et mature, entièrement consacrée à la mise en images d'une humanité "autrefois" déchirée par les conflits et la barbarie. Une vision éminemment pessimiste de la condition humaine qui s'opposait radicalement à la candeur de la plupart de ses précédentes productions familiales (E.T., Hook, Jurassic Park et toutes les productions Amblin).
En 2001 pourtant, Spielberg entama un retour à la Science-Fiction en reprenant un projet de longue date de Kubrick que ce dernier lui céda en toute confiance. A.I. fut néanmoins sévèrement critiqué à sa sortie, certains professionnels et spectateurs accusant Spielberg de corrompre le propos originel de Kubrick par son sentimentalisme si coutumier. De fait, ces critiques mirent à l'index ce nouvel E.T. robotisé et un happy-end que n'aurait jamais pu cautionner Kubrick. Ces spectateurs-là n'auront évidemment pas saisi toute l'ampleur du propos du film, sa noirceur sous-jacente et surtout cette perte de foi en l'humanité. Un point d'autant plus essentiel qu'il détonne clairement dans la filmographie d'un réalisateur qui n'aura eu de cesse de croire en l'homme et en son devenir à travers chacun de ses précédents films.
Deux ans plus tard, Spielberg adapte une nouvelle de Philip K.Dick, un auteur dont les obsessions sur les réalités truquées et tronquées semblaient à priori inconciliables avec les préoccupations et le style du réalisateur. On se sera à nouveau trompé, Spielberg livrant avec Minority Report l'une des meilleures adaptations d'une oeuvre de l'écrivain et une très adroite réflexion sur l'appréhension de l'avenir. A cela, s'ajoute cette vision noire et désespérée d'une humanité qui se voit progressivement privée de tout libre arbitre et s'enfonce dans l'aveuglement général.
Ces deux chefs d'oeuvres du genre en disent alors suffisamment sur l'état d'esprit du Spielberg d'alors.
En 2005, Spielberg collabore à nouveau avec Tom Cruise (et peut-être une dernière fois, suite au délire qu'à piqué la star chez Oprah Winfrey et qui aura suffisamment agacé Spielberg pour qu'il déclare ne plus vouloir travailler avec l'acteur). Tous deux se retrouvent pour une variation actualisée du classique de H.G. Wells, La Guerre des Mondes, publié en 1898.
L'occasion pour le réalisateur de tourner le dos à ses célèbres extra-terrestres messianiques pour mettre en scène une race d'alien toute aussi belliqueuse qu'implacable dans sa détermination à anéantir notre espèce.
A cette époque le traumatisme de l'effondrement des deux tours était encore vivace dans les esprits du monde entier, trauma auquel ce film fait indéniablement écho à travers divers détails d'ordre narratifs et surtout visuels. Il suffit d'ailleurs de voir le protagoniste un temps recouvert d'une poussière grise qui s'avère être les cendres d'autres personnes littéralement vaporisées par la puissance de frappe des envahisseurs. Une image qui nous ramène quelques années auparavant où le monde entier contemplait hagard son poste de télévision sur lesquels été diffusés les mêmes images de new-yorkais épouvantés et recouverts de poussière. Au-delà de cet aspect de notre histoire encore très récente, le film va également chercher plus loin en convoquant ni plus ni moins que le spectre de l'Holocauste, les aliens devenant ici une allégorie de tout ce que l'humanité contient de détermination à haïr et éradiquer l'Autre.
Sortant d'une longue période d'expérimentations cinématographiques et pris dans une certaine vague science-fictionnelle, Spielberg va néanmoins réussir l'exploit de surprendre à nouveau son public en allant à l'encontre de tout ce que l'on était alors en droit d'attendre de son nouveau film SF. Car on était bien en droit d'attendre de Spielberg une nouvelle fresque dont l'ampleur des événements se verraient narrer par une multitude de points de vue.
Et pourtant, loin de coller à l'ampleur de la narration du roman et de tout autre film de ce genre, Spielberg, toujours bien servi par son génial scénariste David Koepp, se détourne consciencieusement des clichés d'usage et toute autre figure imposée pour privilégier une approche plus immersive en collant continuellement aux basques de son protagoniste, qui n'est ici rien de plus qu'un modeste docker. On est bien loin de l'ampleur narrative d'oeuvres catastrophe plus convenues telles Independence Day.
En filmant les événements d'un point de vue isolé et quasiment unique tout le long du métrage, le cinéaste se prive donc d'une narration épique du conflit et choisit judicieusement de limiter la finalité de l'intrigue à des enjeux strictement personnels et de l'ordre du sacré puisqu'ici le héros, tout d'abord présenté comme un père divorcé et immature, n'a d'autres objectifs que de préserver à tout prix ses enfants, non seulement du péril qu'ils encourent mais également de l'horreur à laquelle ils sont confrontés, en leur cachant au maximum les proportions du désastre (la scène de l'épave de l'avion de ligne).
Spielberg renoue ainsi avec l'un de ses thèmes de prédilection, à savoir la famille, et se confronte également pour la première fois depuis... E.T. l'extra-terrestre à la question du divorce. Il faut dire que la figure paternelle, qu'elle emplisse l'écran ou en soit totalement absente, a longtemps hanté la filmographie de Spielberg, qui enfant, avait mal vécu le divorce de ses parents et le départ de son père (ce qui est pleinement évoqué dans E.T. à nouveau dans lequel le père n'était qu'un fantôme déterminant le comportement de son jeune héros mais jamais vraiment évoqué). Ici, en revanche, le père fait figure d'anti-héros. Présenté comme un célibataire désinvolte dont l'attitude a certainement précipité le divorce, ce dernier accueille pour le week-end ses deux enfants que lui confie son ex-épouse. Si la cadette lui manifeste toujours autant d'amour et d'admiration, il n'en est pas de même pour son fils aîné qui, en pleine adolescence, semble garder un certain ressentiment envers ce père immature en lequel il ne décèle aucun modèle.
La suite des événements confirmera alors cette opposition morale entre le père et le fils, lorsque ce dernier au détour d'une scène de panique choisira de rejoindre les troupes de résistance pour affronter hors caméra l'envahisseur et ainsi s'émanciper définitivement de la figure protectrice patriarcale. Car si son fils finit par se détourner de sa famille pour embrasser une cause plus ample, le père lui a rapidement fait le choix de renoncer à toute forme d'héroïsme archétypale pour protéger uniquement les siens et ce dès cette scène charnière de la première attaque des tripodes dans laquelle il vole la seule voiture en état de marche (la technologie des aliens a désactivée toute source d'énergie électrique) à un de ses voisins qu'il tente néanmoins vainement de convaincre de les rejoindre lui et ses enfants dans le véhicule.
Ce père ne reculera ainsi devant aucun obstacle moral pour préserver ses enfants. Une scène voit ainsi le personnage embarquer sur un ferry avec ses enfants en abandonnant sur le rivage ses amis qu'il vient à peine de retrouver. Une autre le confronte à une foule paniquée en voulant à sa voiture et qu'il tente maladroitement de tenir en respect avec un pistolet (hélas, il n'est pas le seul à être armé). Mais le passage qui finit de prouver toute la détermination de ce "héros" est évidemment celui où lui et sa fille trouvent refuge dans une cave sinistre, enfermés avec un redneck totalement délirant (interprété par Tim Robbins) qui par ses jérémiades incessantes menacent d'attirer à tout moment l'attention des aliens sur leur cachette. Confronté à un véritable dilemme moral, le héros décide de réduire le dément au silence de la manière la plus radicale qu'il soit. Ce passage à l'acte est alors l'un des rares moments du film où le spectateur perd de vue son référent, celui-ci commettant un homicide de sang-froid derrière une porte close, Spielberg braquant alors sa caméra sur le visage terrorisé de sa fille laquelle se bouche les oreilles comme son père le lui a demandé. Encore une volonté de ce dernier de préserver sa fille de l'horreur qui l'environne, sauf que cette fois c'est lui qui en est l'instigateur par la force des choses.
Mais Spielberg ne s'arrête pas en si bon chemin et poursuit aussitôt sur une scène des plus oppressante, où les aliens investissent la cave plongée dans l'obscurité et menacent à tout moment de débusquer le père et la fille qui réussissent tant bien que mal à se dérober à leur vue. En plus de dévoiler enfin l'aspect de ses aliens sanguinaires, cette scène est aussi un moyen pour Spielberg de s'auto-citer en renouant avec son génie chorégraphique de la séquence de la cuisine dans Jurassic Park, au cours de laquelle deux jeunes protagonistes se livraient à une partie de cache-cache avec des raptors.
C'est au terme de cette séquence haletante que le protagoniste découvre que les parois ternes de la cave se teintent de pulvérisations rouge sang ayant d'ailleurs recouvert l'essentiel du paysage alentour. Une couleur qui vient littéralement tâcher la palette chromatique extrêmement réduite pendant tout le reste du film et qui révèle la finalité de l'invasion alien, à savoir modifier l'éco-système terrien en aspergeant la flore de sang humain.
Tout l'acte en huis-clos du sous-sol embrasse alors l'horreur dans toute son aura cauchemardesque, non seulement en faisant du protagoniste un meurtrier de sang-froid mais en imposant pleinement le film comme une métaphore SF de la notion de génocide. Le passage devient ici le point culminant et traumatique d'un film qui ne manque pourtant pas de distiller les purs morceaux de terreur et les visions d'horreur explicites (voir la scène de la rivière à la surface de laquelle flotte une multitude de cadavres, tout cela sous le regard d'une gamine) ou plus subtiles (des lambeaux de tissus, tout ce qu'il reste d'humains désintégrés, dansent délicatement au-dessus d'un paysage bucolique).
A ce moment-là, on est en droit de s'interroger, autant de nihilisme et de cruauté viscérale est totalement inhabituel de la part de Spielberg, un réalisateur qui n'aura eu de cesse de croire en l'homme et en son devenir à travers chacun de ses films. A croire que le trauma du 11 septembre aura radicalement changé la perception du cinéaste jusqu'à réduire toutes ses illusions humanistes à néant. Ce que vient pourtant in fine contredire une scène moins anodine qu'elle ne semble l'être, celle où le protagoniste se voit retenu captif parmi d'autres humains dans une cage suspendue sous un tripode. Aspiré par la machinerie alien pour être littéralement broyé et siroté, le héros se voit tiré hors d'une mort certaine par un bidasse téméraire et tous les autres prisonniers. Un geste tout aussi héroïque que marquant dans un film qui en est presque totalement dépourvu.
Au final, La Guerre des mondes s'attache moins à étudier l'ampleur des événements qu'à dresser le portrait d'une humanité (qui a dit Amérique ?) individualiste et contradictoire à travers le parcours de son protagoniste. En s'attachant au seul point de vue de ce dernier, Spielberg consacre toute sa réalisation à la mise en valeur de l'inconnu et du hors-champ. La défaite des envahisseurs sera alors d'autant moins explicable que le héros n'en sera finalement qu'un simple spectateur parmi tant d'autres.
Un simple ouvrier qui réussira malgré tout à préserver sa fille et à la ramener saine et sauve à sa mère, y retrouvant par ailleurs son fils, perdu de vue au cours des événements. Mais loin de se vautrer dans le banal happy-end, Spielberg préfère tenir à distance son protagoniste de son ex-épouse et de ses riches ex-beaux-parents, lesquels le toisent au sommet d'un escalier qu'il n'est pas invité à franchir. On cherchera quelques raisons de se réjouir dans la survivance du héros et de ses enfants, mais ce serait oublier tout ce que cet homme aura dû faire pour préserver les siens face à l'horreur.
Loin des conventions d'un genre balisé à l'extrême depuis les grands classiques des années 50, La Guerre des mondes version 2005 s'impose au final comme une nouvelle démonstration du génie narratif et visuel d'un cinéaste dont on doutait alors des capacités à transcender un énième film d'invasion extra-terrestre. Cette adaptation semble en définitive combiner les deux facettes de la filmographie du cinéaste qui mêle ici le pur divertissement à l'horreur viscérale de ses drames historiques. Qui plus est, l'approche adoptée par Spielberg, à savoir filmer les événements d'un unique point de vue et le plus souvent à hauteur d'épaule est d'autant plus immersive qu'elle fait face à l'ampleur d'un désastre que le regard d'un seul homme ne peut englober. Une approche hautement efficace qui fera école et sera repris par la suite dans bon nombres d'oeuvres du genre, de Cloverfield à Godzilla version 2014 en passant par Les Fils de l'homme. Comme quoi, Spielberg reste encore et toujours une influence majeure pour les cinéastes d'aujourd'hui.