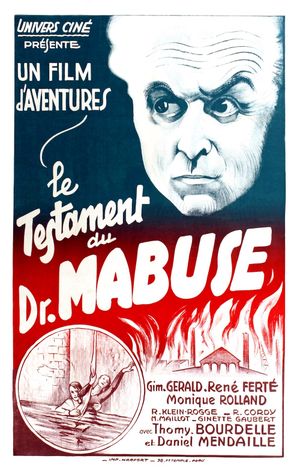Les arcanes de l’empire absolu du crime.
Pour sa première version parlante de Mabuse, Lang célèbre le son. Dans une exposition in medias res particulièrement audacieuse et énigmatique, un bruit sourd et répétitif de machines dans une imprimerie (auquel les sirènes lancinantes de l’incendie final seront l’écho) ponctue de façon hypnotique la gestuelle hallucinée d’un personnage en perdition. La machine est lancée, à savoir un récit aux multiples ramifications, dans lequel les pièces ne s’assemblent que progressivement (peut-être aussi en raison des restaurations successives d’un négatif partiellement perdu), mais très travaillé dans sa structure. Les transitions entre les récits parallèles ne sont jamais dues au hasard : la photo d’un suspect s’anime lorsqu’il apparaît à la scène suivante, l’inondation d’une pièce close répond à l’assaut d’un appartement par la police, le son d’une horloge anticipant celui d’un couteau contre un œuf à la coque… Tout se joue selon une logique, un plan qui symbolise la mainmise diabolique et télépathique du Dr Mabuse, qui écrit inlassablement l’organisation de « l’empire absolu du crime ».
N’exagérons pas la portée « expressionniste » du film, qui n’apparaît réellement que dans les belles visions des personnages en transparence et dans les plans finalement assez épars du Dr Mabuse.
Comme pour King Kong, (http://www.senscritique.com/film/King_Kong/critique/23761405) de la même année, on est impressionné par les moyens mis en œuvre : course poursuite, inondation, incendie et explosion d’une usine, le récit suit une logique de gradation bien maitrisée.
Mais le plus intéressant reste bien entendu le propos général, à savoir la mise en place, à distance, d’un complot dont les exécutants ignoreraient tout. On est à ce titre surpris par deux superbes séquences: le rideau derrière lequel les ordres surgissent, et la route de nuit lors de la poursuite finale renvoient à l’imaginaire d’un autre visionnaire : David Lynch.