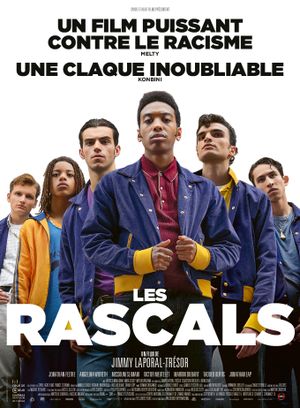L’histoire, comme la mémoire, est cyclique : après un long purgatoire dédaigneux, les années 80 ont enfin droit à la lumière, et n’ont jamais été aussi vivaces dans la nostalgie contemporaine, notamment dans l’exploration sous forme de série ou de film des débuts du groupe NTM. Jimmy Laporal-Tresor qui signe ici son premier long métrage, se penche ainsi sur la jeunesse d’une décennie qui a oublié depuis longtemps l’idéal du flower power, et doit faire face à des résurgences de haine raciale face à la montée en puissance des groupes skinheads.
C’est donc la cartographie d’une guerre des gangs qui se profile, s’attardant moins sur une époque qu’un motif tragiquement récurrent des haines et de l’intolérance. L’étrange ancrage temporel en témoigne, puisque la bande multiculturelle des protagonistes voue un culte pour une autre époque révolue, celle des 60’s, à renfort de coiffure, de veste à l’américaine et de surnoms improbables, comme pour raccorder d’avantage le drame à venir au grand modèle qui plane sur le récit, à savoir West Side Story. Cet emprunt intégré par les personnages atteste ainsi de la référence, et surtout, des décalages presque incongrus dans les transferts culturels, qui n’empêchent pas pour autant à une génération de se fantasmer en héros de fiction. Et c’est sur cet équilibre fragile entre réalité brute et imaginaire romanesque que s’écrira la destinée de ces jeunes n’ayant d’autres horizons que ceux qu’ils rêvent. On comprend dès lors ce prologue où un jeu de gamins vrille soudain vers le massacre, et qui dictera toute la dynamique des échanges à venir : celles d’enfants encore vivaces dans des corps d’adultes, ivres de virilité, de pose et de vengeance, mais dont les yeux s’écarquillent d’effroi lorsque le tragique s’invite à la fête.
La première réussite du film tient dans sa capacité à capturer cette vigueur et les élans d’une jeunesse qui présume de sa capacité à conquérir tout ce qui s’offre à elle : outre l’interprétation impeccable des comédiens, la formidable musique de Delgres accompagne avec une sorte de bienveillance cette illusion constante de la victoire, entre euphorie et pose presque caricaturale. La mise en scène de Jimmy Laporal-Tresor impressionne, pour un premier film, dans sa capacité à dynamiser les échanges, et à dériver progressivement vers des espaces clos, nocturnes et souterrains pour accompagner la collective descente aux enfers. On retiendra aussi la manière dont il enferme les personnages dans des espaces clos lors des moments cruciaux, notamment par la répétition du motif du véhicule (une rame de métro, un bus, un fourgon) qui les éloigne du lieu du drame sur lequel ils ne peuvent agir. Cette thématique de l’immobilité (référence au prix de l’avion, la voiture volée qui ne démarre pas) suffit à évoquer les impasses d’une jeunesse issue de l’immigration, qui n’aura pas droit à son porte-parole, ni à sa mention dans le JT. Le récit parvient, dans ses intrigues parallèles fatalement vouées à converger, à mobiliser tous les enjeux d’une époque sans verser dans le didactisme, et à travailler l’ambivalence des personnages, dont la violence n’est jamais assez canalisée, que ce soit chez Rico, le jeune frère interrompant un concours de hip-hop ou, dans le camp d’en face, le très intéressant transfert d’un facho repenti vers la radicalisation de sa sœur.
On a vu récemment Romain Gavras s’essayer avec pesanteur à la réécriture tragique dans Athena : Jimmy Laporal-Tresor a bien des leçons à lui offrir en termes d’écriture, laissant le rythme et les espaces prendre en charge les ressorts de la catharsis, comme en témoigne cette superbe scène dans la station de métro, et la manière dont les lieux se décapent progressivement de toute mythologie, du bal au disquaire, du concert au meeting, de la rue au fourgon. En ne perdant jamais de vue le motif de la désillusion, le cinéaste parvient à convoquer l’ampleur d’un drame qui rejoue les invariants de la haine humaine.