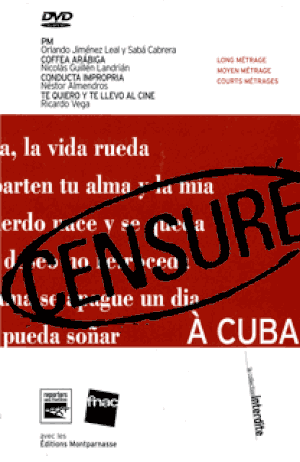PM, emblème du cinéma cubain clandestin malgré lui
L'exemple le plus emblématique des limites officielles du cinéma cubain est sans doute PM, un court-métrage de 14 minutes de Orlando Jimenez Leal et Saba Cabrera Infante réalisé en 1961. Il est considéré comme le premier film indépendant de l'histoire du cinéma cubain, car il est tourné grâce à de la pellicule non fournie par le régime, mais également comme le film le plus problématique de toute l'histoire du cinéma cubain. En effet, ses deux réalisateurs, cinéastes déjà connus au moment de sa réalisation, étaient également des militants politiques. Leal et Infante ont lutté contre Machado : n'étant ni anti-communistes ni marxistes mais plutôt sympathisants d'une gauche libérale, ils reçoivent une commande dont le thème serait une lutte se préparant contre les Etats-Unis. Leal et Infante doivent tourner pour la télévision un film qui témoignerait de l'engagement du peuple dans son entier, tous les cubains étant soi disant tous prêts à la lutte. Leal et Infante tournent donc une première version du film mais ils ne rencontrent pas que des personnes prêtes à combattre, contrairement à ce qu'affirme le régime. Les réalisateurs rencontrent également des personnes qui dansent, qui boivent, qui n'ont pas de préoccupations politiques ; ils décident alors de réaliser un film en montage alterné, qui montre alternativement les personnes prêtes à combattre et celles qui ne font rien pour la lutte. Les autorités cubaines n'en veulent pas : l'ICAIC ne souhaite conserver que la moitié du film montrant les cubains qui veulent combattre. Leal et Infante décident alors de rencontrer les gérants du dernier cinéma n'appartenant par à l'ICAIC, le Rex, et leur vendent le film tel qu'ils l'ont réalisé. Les spectateurs apprécient le film, le trouvent frais, novateur. Mais sans autorisation, le film finit par être confisqué par les autorités : Infante écrit alors à son frère Guillermo Cabrera Infante, figure importante du régime, pour comprendre quel est le problème que pose son film au régime : Jimenez Leal parle de « 14 minutes qui durent un demi-siècle ». La censure de PM se révèle contre-productive : l'interdit fait que les spectateurs veulent le voir. Sans censure, le film n'aurait pas pris une telle importance. Cette censure s'est faite en plusieurs étapes : des discussions, des réunions et des méprises amènent le régime a considéré ce film nocif « en cette année de l'Education », son crime majeur étant de ne pas être en adéquation avec ce qui se passe à Cuba au moment où ils tournent. On accuse les réalisateurs de « défigurer » l'attitude du peuple cubain. Fidel Castro n'intervient qu'à la fin de cette polémique et, observant que le phénomène prend de l'importance, il réunit les intellectuels pour prononcer son discours le plus célèbre, qui affirme une règle qui deviendra celle du cinéma cubain : « dans la Révolution, tout, contre la révolution, rien ». Alfredo Guevara, président de l'ICAIC, se prononce contre PM, tandis que Tomás Gutiérrez Alea quitte l'ICAIC. Leal et Infante, quant à eux, quittent Cuba. Le film, au fond, était plutôt neutre du point de vue critique. Pourtant, de nombreuses oppositions qui préexistaient au sein de la société cubaine se sont exprimées de façon exacerbée à travers cette polémique et cette censure : le movimiento 26 de julio contre les comunistas, les liberales contre les marxistas, la revue Lunes de revolucion (dirigée par Guillermo Cabrera Infante) contre l'ICAIC, les partisans de Carlos Franqui contre ceux d'Alfredo Guevara, mais également, d'un point de vue cinématographique, le Free Cinema contre le réalisme socialiste et le néoréalisme.
« L’interdiction de PM était aussi une machine de guerre contre le quotidien Revolucion, organe du Mouvement du 26 juillet (castriste), et son magnifique supplément culturel Lunes de Revolucion. Depuis plus d'un demi-siècle, la formule binaire de Castro plane sur les libertés : tous les citoyens ne sont pas égaux devant la loi, les droits ne sont pas universels, ils sont réservés aux fidèles. Les autres sont condamnés aux ténèbres, comme du temps de l’Inquisition et de la chasse aux sorcières. »
(Paolo A. Paraguana, « La censure à Cuba, du film « PM » à Internet », article du blog « América Latina (VO) », www.lemonde.fr, 8 février 2013)
Les castristes pensaient que leur fidélité au régime les protégeraient de la censure. Ce ne fut pas le cas, comme on peut le voir, pour nombre d'entre eux, malgré le caractère révolutionnaire de leur œuvre. Ainsi, Humberto Solas et Sara Gomez ont vus leurs films interdits, tout comme Tomas Gutiérrez Alea avec Mémoires du sous-développement, en 1968. Le régime est même allé plus loin avec Nicolas Guillén Landrian, interné dans un institut psychiatrique.