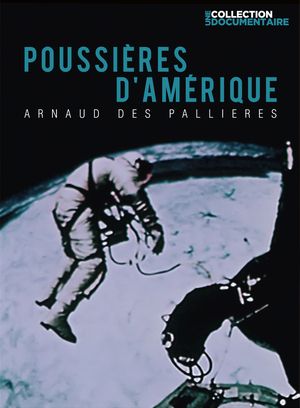Vacances chez Super8land : Il pleut, l'été sera pourri, j'ai eu une crise d'épilepsie. Bisous.
Comment dire ?
On s'attend à voir, par le truchement du titre, une vision personnelle de l'Amérique. De façon plus modeste, peut-être, que le monument « Route One USA » de Robert Kramer. Une invitation au voyage, en somme. Mais Des Pallières ne fonctionne jamais où on l'attend, et c'est bien le problème.
Le film est constitué à partir d'archives, tournées en Super 8 pour la plupart, piochées ça et là dans divers fonds documentaires. Ces archives contiennent des représentation de la famille, des absences, des présences. Des évolutions. On comprend : montrer les Amériques, enfin les États-Unis. Il nous le dit : « Ce film est une improvisation. Ça parle d’Amérique. Donc de nous. » Par le passé, chercher à établir des connexions, tisser des liens entre le rituel oublié, la madeleine de Proust ou bien le souvenir d'enfance et le présent : eux, outre-Atlantique. Et nous.
Mais ce dispositif, apparemment complexe, se dérobe au bout de la première demie-heure. Des Pallières ne réagit qu'à un concept : une somme d'images diverses, et puis un carton (traduction : un écran noir avec du texte) toutes les 20 secondes. On se dit : c'est un documentaire muet. Mais non, ce n'est pas encore ça : le texte affiché sur ces cartons raconte une histoire, des histoires. On se dit : c'est un conte. Non content de cela, il densifie le propos à en perdre le sens : ces textes ne sont pas des phrases, mais des portions de phrases, qui sont sensées être cohérentes entre elles. Seulement : fatigue. Voir « The boy from other side », deux séquences sans lien apparent « The parents didn't want him to come », puis trois séquences sans lien apparent « And Mum cried », une séquence « But he wasn't afraid », bref C'EST TRÉS FATIGANT.
Ne prétendant pas être bourru, acceptant bien des détours cinématographiques, trucs, astuces, ellipses, entourloupes, travers de récit, parallèles, revers, il m'est hélas difficile de dire que j'ai pu accorder du sens à l'entièreté de cet essai mystico-perclus. « Voyage autour de ma table de montage » ?
Énième rebuffade, le vocabulaire est pauvre, comprenez : ce sont des traductions de français. Si logique est une langue, sa camarade l'est autrement : comment accorder de l'attention à du « petit anglais » ? Peut-être faut-il le prendre seulement en tant qu'« improvisation » (sic) ?
Si le cinéma peut accorder une large part à l'improvisation, celle-ci est magnifiée par le montage, qui lui rend ses plus beaux éclats. Ici, c'est le montage, l'histoire, la vision, la langue, l'intention qui est improvisée. Terrible épreuve, que de subir (pas d'autre mot) cette succession anti-narrative pendant plus d'1h40. Parfois, cette impénétrabilité de l'œuvre transperce la paroi, et une archive est belle. Hélas, seulement en tant que telle.