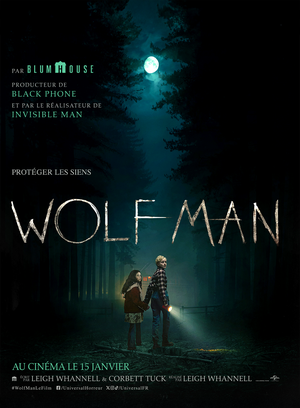Les films de loup-garous suscitent toujours en moi un peu d’attente, car trop rares par rapport aux vampires et autres zombies. Mais la réussite est rarement au rendez-vous (An American Werewolf in London, The Howling, ou le méconnu The Wolf of Snow Hollow si l’on est déviant), livrant souvent des films tout au plus sympathiques (Ginger Snaps - sans doute référencé par le prénom de la gamine - , Dog Soldiers…). Il est donc possible que je sois plus indulgent dans mon appréciation, trop heureux de voir une revisite du mythe portée sur nos écrans. Et en même temps, j’avais plutôt apprécié le travail de Leigh Whannell sur Upgrade et The Invisible Man, ce dernier tentant déjà d’actualiser une des figures mythiques des Universal Monsters. Il était donc naturel que je laisse sa chance à ce Wolf Man malgré les premiers retours plus que mitigés.
Et en parlant de naturel, l’ambition naturaliste du cinéaste est affichée d’entrée de jeu, dans une séquence introductive où des fourmis dévorent une guêpe en défense de leur territoire, montrant la prédation sous sa forme organique, une chaîne alimentaire témoignant d’un ordre biologique et d’une approche aux antipodes de l’urbanisme technologique de ses deux précédents films. Et si j’ai eu un doute passé l’incipit (un poncif narratif néanmoins efficace dans sa mise en scène), alors que l’on nous présente la petite famille de protagonistes à San Francisco, on reviendra vite se perdre dans la verdure claustrophobe de l’Oregon.
Cette ambition accompagne tout le métrage, Whannell allant au bout de son idée. La progéniture prend la place de son ascendance par le parricide dans une analogie léonine. On s’éloigne du canon religieux traditionnel pour adopter une croyance amérindienne plus proche de l’infection, établissant au passage de nouvelles règles, dont une transformation progressive, par étapes. Elle est d’habitude traitée comme la scène clé des films de lycanthropes, permettant la bascule dans l’horreur et l’exposition d’artistes tels que Rick Baker ou Rob Bottin qui se font un malin plaisir à déformer les chairs pour épater la galerie. Ici, elle constitue le fil rouge de l'œuvre, démarrant très tôt et finissant très tard, et rappelant la lente transformation de Seth dans The Fly (mais sur une nuit). Et là aussi, elle est accompagnée d’un design sonore organique qui fait grogner les robinets, rugir le bois du chalet et hurler le vent dans les arbres, participant à l’expérience sensorielle. On émettra juste un bémol sur la vision du lycan, le rendu en néons et négatifs étant douteux, bien que l’idée soit originale. Enfin, on appréciera l’usage parcimonieux de la CGI au profit de maquillages et de prothèses qui apportent une tessiture elle aussi plus naturelle. Et le spectacle final de cette vallée au petit matin ne fera que conclure l’exercice en toute logique.
Non, vraiment, il y a de l’idée dans la conception, et une volonté honnête d’hybrider du Cronenberg à du Herzog dans le style. Mais une hybridation du pauvre.
Car si Wolf Man va au bout de ses idées sur la forme, il en manque cruellement sur le fond. L’absence de jumpscares putassiers ou de personnages sceptiques clichés n’empêche pas aux thématiques familiales d’être au ras des pâquerettes. Les relations père-fils qui s’enveniment par une incapacité à communiquer qui se répercutent plus tard sur l’union maritale à la ville, pour se conclure par une incompréhension littérale lorsque l’homme devient finalement bête, ça ne vole pas bien haut. D’autant plus quand on y adjoint un discours sur la peur générée par une surprotection qui fait office de boomerang peu finaud.
Un discours suffisamment éculé pour que l’on prête attention à des bêtises scénaristiques qu’une immersion complète aurait effacé. Comme la décision débile d’un local qui avertit contre les sorties nocturnes mais rentre tout de même dans le camion des citadins pour leur indiquer le chemin, sous-entendant qu’il a prévu de rentrer à pied dans le noir, seul, dans la forêt, alors qu’il aurait pu les guider avec son propre véhicule. Ça, l’idée de se réfugier sur une serre bâchée de deux mètres de haut, ou la séquence interdite où la nuit devient jour entre deux plans. Du pinaillage qui n’aurait pas lieu dans un film plus tenu.
Alors Wolf Man tombe dans cet entre deux malheureux, où les trouvailles de départ se heurtent à des bégaiements dans l’exécution. Au moins je ne m’y suis pas ennuyé, mais je l’oublierais sûrement, cette œuvre aux idées mi-bonnes, mi-floues.