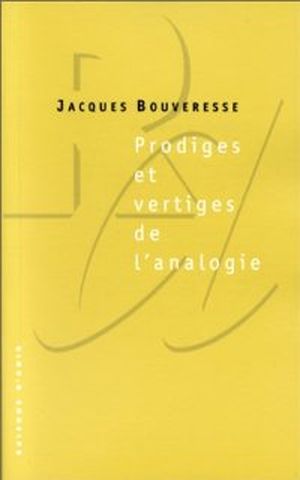Bibliophilie pas vraiment obsessionnelle — 2018
Résolution 2018 (que je m’empresserai malgré moi de ne pas tenir, encore une fois) : lire plus.
Prochains achats : Le Culte de la charogne. Anarchisme, un état de révolution permanente (1897-1908) — Le cinéma, un art subversif — De sang-froid — Ni Dieu ni maître, une histoire de ...
5 livres
créée il y a plus de 7 ans · modifiée il y a plus de 6 ansProdiges et vertiges de l'analogie (1999)
Sortie : 1999. Essai, Philosophie
livre de Jacques Bouveresse
Morrinson a mis 8/10.
Annotation :
[ peterKmad via gallu ]
Un de ces essais qui s'attachent à la déconstruction lente et méthodique d'un concept, qui si on y est sensible procurent une certaine jouissance. Dans la ligne de mire de Jacques Bouv., l'utilisation abusive de la métaphore, dans la lignée d'une revendication issue du milieu littéraire dite du "droit à la métaphore" et qui consisterait à tolérer à peu près n'importe quelle analogie à des fins de vulgarisation. Il s'attaque plus particulièrement au cas des analogies en sciences sociales que certains penseurs contemporains s'autorisent, en puisant dans les sciences physiques ou mathématique des notions mal comprises et mal retranscrites. Un procédé qui semble excuser presque toutes les approximations.
On est donc aux antipodes du "ce qui se conçoit bien s'énonce clairement" : si Bouv. s'en prend à plusieurs reprises à Régis Debray et à son utilisation abusive des théorèmes d'incomplétude de Gödel, il s'agit surtout d'une réaction à l'affaire Sokal. À l'origine de cette histoire, la publication d'un article qui s'avéra a posteriori être un canular par le physicien Alan Sokal dans une revue postmoderniste. L'article s'intitulait "Transgresser les frontières : vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique" et fut publié en 1996, suite à quoi Sokal et son collègue Jean Bricmont enfoncèrent le clou dans l'ouvrage "Impostures intellectuelles". Il s'agissait, encore une fois, de souligner l'utilisation métaphorique et abusive de notions mathématiques ou physiques complexes, avec pour résultante un effet d'autorité immédiat dans l'apparence trompeuse de scientificité.
Si le livre est un peu difficile à lire (malgré sa concision) et parfois un peu répétitif, il n'en reste pas moins extrêmement pertinent dans sa charge. Les dangers de l'analogie et de la généralisation à outrance sont omniprésents, bien au-delà du strict cadre des sciences sociales (dernier exemple en date : "L'intelligence des arbres", un documentaire pratiquant la métaphore familiale de manière scandaleuse). On est toujours à la frontière avec l'imposture intellectuelle. L'essai de B. est solide, très argumenté, d'une rigueur vraiment appréciable — c'est-à-dire l'exact opposé de ce qu'il dénonce. Sa tâche de déconstruction ("de flic") s'attaque aux fondements des discours de commerçants de la pensée, les ardents défenseur de ce "droit à la métaphore" qui mystifient les foules par la grâce d'une rhétorique assaisonnée au verbiage pseudo-scientifique.
Rue de la Sardine (1945)
Cannery Row
Sortie : septembre 2000 (France). Roman
livre de John Steinbeck
Morrinson a mis 8/10.
Annotation :
Même en concevant qu'il s'agit d'un Steinbeck mineur (au même titre, à mes yeux, que "La Perle" ou "Des Souris et des hommes"), même en admettant qu'on se situe bien loin de jalons comme "Les Raisins de la colère", ce "Cannery Row" me pousse à placer Steinbeck très haut sur le podium de mes auteurs de littérature préférés. Et me rappelle à quel point la lecture de "East of Eden" se fait pressante.
Le style est toujours le même, en grande partie, que ce soit dans le vocabulaire, dans la description des lieux et des mœurs, ou encore dans le recours aux ellipses entre les chapitres qui alternent les temps longs et les temps cours, donnant à la chronologie des événements une consistance élastique (ce que "Les Raisins de la colère" faisait avec une dextérité incroyable). On reconnaît très vite Steinbeck, aussi, à son attachement pour les gens que d'autres auraient pu qualifier de misérables. Comme le dit très bien la couverture, on peut les voir soit comme des filles, des souteneurs, des joueurs de cartes et des enfants de putains, soit comme des saints, des anges et des martyrs. "Ce serait revenu au même" : ce sont des hommes, tout simplement.
Et Steinbeck de décrire la banalité de l'existence d'une petite bourgade californienne avec une empathie et un enthousiasme géniaux, une série de portraits hauts en couleur, une série de regard sur l'errance, sur l'ennui, sur une certaine réalité sociale américaine. Le groupe de protagonistes sont presque tous, évidemment, de gentils truands mais pourtant, c'est leur humanité, à travers leur solidarité et leur générosité maladroites, qui transperce l'épaisse couche de malhonnêteté et de petits larcins.
Le livre peut dérouter car il s'agit surtout d'une succession de petites histoires, avec une trame générale assez évasive. Des chemins qui se croisent et qui interfèrent plus qu'un chemin général emprunté par tous. Parfois, ici, Steinbeck me fait penser à Faulkner dans la description d'un microcosme américain, de ses bruits, de sa crasse. Mais Steinbeck est sans aucun doute un de ceux qui aiment le plus les parias poisseux et les rebuts de la société qu'ils décrivent. Et la relation entre Doc et le reste de la population, avec son épicier, sa patronne de bordel, et sa bande de joyeux voyous, constitue une interdépendance vraiment très intéressante.
"Ce qui m’a toujours frappé, dit Doc, c’est que les choses que nous admirons le plus dans l’humain: la bonté, la générosité, l’honnêteté, la droiture, la sensibilité..."
La fable des abeilles
The Fable of the Bees
Sortie : 1714 (France). Essai, Culture & société
livre de Bernard Mandeville
Morrinson a mis 4/10.
Annotation :
Quelle lourdeur dans la tentative de démonstration, pour exposer le point de vue selon lequel la somme des vices (entendus au sens de la recherche de son intérêt propre) qui constituent nécessairement une société contribuent à la prospérité de cette dernière. Et au-delà : Mendeville y voit une condition nécessaire, en affirmant que les conditions de probité et de prospérité sont antinomiques.
C'est une thèse (parmi beaucoup d'autres, à commencer par Ayn Rand et son "La Vertu d'égoïsme") de l'utilité sociale de l'égoïsme qui ne brille pas franchement pas sa subtilité, à l'image de l'exemple choisi du libertin : il agit par vice, mais "sa prodigalité donne du travail à des tailleurs, des serviteurs, des parfumeurs, des cuisiniers et des femmes de mauvaise vie, qui à leur tour emploient des boulangers, des charpentiers, etc.". Une logique qui invite à pourrir les couloirs et les trottoirs pour donner du travail au personnel de ménage et aux agents municipaux... Mais Mandeveille va plus loin que ça dans le cynisme, en affirmant que les pauvres doivent être sacrifiés en peinant et en travaillant afin de permettre aux riches de disposer de leur argent. Il n'y voit pas un inconvénient, simplement la fatalité du sort, aux fondements de la société.
Libérer les appétits pour produire de la richesse par ruissellement : on connaît la chanson (une fable en soi), selon laquelle la richesse des plus fortunés atteindraient les plus pauvres comme des mies de pain tomberaient de la table d'un festin pour alimenter les souris mortes de faim en dessous. Mandeille n'hésite pas à affirmer que "la guerre, le vol, la prostitution, l'alcool et les drogues, la cupidité, etc. contribuent finalement à l'avantage de la société civile". Selon lui, il faut être "aussi avides, égoïstes, dépensier pour votre propre plaisir que vous pourrez l’être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens". C'est une vision morale assez peu étayée dans ce livre, et fortement discutable, on le comprend beaucoup mieux, 3 siècles plus tard... On comprend pourquoi la pensée libérale y trouve une source d'inspiration (l'intérêt personnel comme moteur universel), même si Adam Smith s'était montré extrêmement critique envers Mandeville.
En résumé, aussi subtil que l'œuvre : soyez altruiste et vous contribuerez à la destruction de la société car seul le vice appelle la vertu.
Conquête de l'inutile (2004)
Eroberung des Nutzlosen
Sortie : décembre 2008 (France). Essai
livre de Werner Herzog
Morrinson a mis 9/10, l'a mis dans ses coups de cœur et a écrit une critique.
Annotation :
Je l'ai bien savouré, ce livre, et j'aurais pu en lire encore pendant des mois et des mois, je crois, des carnets comme celui-là. Même si je m'en doutais un peu, au final, cette "Conquête de l'inutile" en dit beaucoup moins sur le film ou sur son tournage que sur Herzog lui-même : je l'ai plutôt perçu comme une plongée dans les pensées profondes du cinéaste, avec sa perception des événements, ses délires personnels, mais aussi sa constance de capitaine sur un bateau en plein milieu d'une immense tempête. Rarement des récits autobiographiques et introspectifs auront été aussi captivants, enrichissants et passionnants. Un complément parfait au documentaire tourné par Les Blank, "Burden of Dreams".
"Conquête de l'inutile" est structuré au jour le jour, comme un journal de bord, du début à la fin de l'expédition de Herzog et son équipe au Pérou, au début des années 80, pour le tournage apocalyptique (et le mot est faible) de "Fitzcarraldo". On est très loin de l'exposé scolaire du tournage et de la progression linéaire d'un film qui s'écrit peu à peu sur des bobines : c'est avant tout un compte-rendu subjectif de cette période, où les faits et les interprétations s'entrechoquent aussi violemment que régulièrement. Il y a des passages à vide et des accès de folie furieuse, de longues descriptions factuelles et des interruptions fréquentes liées aux aléas du tournage (rien que de très classique avec Herzog...), des constations très terre-à-terre et des envolées lyriques ou oniriques caractéristiques de son œuvre cinématographique. Et cette obsession pour la jungle suinte de partout : "I say this all full of admiration for the jungle. It is not that I hate it, I love it. I love it very much. But I love it against my better judgment."
On ne compte plus les anecdotes de tournages, que Herzog relate avec un calme clinique qui fait peur, parfois bien plus peur que les accès de folie presque classiques de Klaus Kinski. Herzog prend d'ailleurs un malin plaisir à montrer comment ses colères sont presque systématiquement déclenchées quand le centre de l'attention n'est plus focalisé sur sa personne. Et les occasions furent extrêmement nombreuses, entre les destructions des campements, les accidents d'avion à répétition, les jambes découpées à la tronçonneuse après une morsure de serpent, la guerre entre Pérou et Équateur, les maladies généralisées (qui éjecteront Jason Robards du tournage), les retards successifs (qui élimineront Mike Jagger du film), etc.
Suite...
Le Seigneur des porcheries (1999)
Lord of the Barnyard: Killing the Fatted Calf and Arming the Aware in the Corn Belt
Sortie : 1998 (France). Roman
livre de Tristan Egolf
Morrinson a mis 8/10 et a écrit une critique.
Annotation :
Je comprends très bien, au final, la comparaison du style de Tristan Egolf avec celui de Steibeck ou de Faulkner. Comme une réactualisation d'un regard tourné vers la description des classes (très) populaires américaines, avec toutefois ici une composante un peu méchante et vindicative que je n'ai jamais ressenti comme tel chez les deux autres auteurs.
En suivant le parcours de John Kaltenbrunner, Egolf dessine un portrait complexe et diversifié, celui du protagoniste et de son incroyable mauvaise chance qui conduira à plusieurs reprises à des explosions de rage particulièrement violentes (et jouissives, du point de vue de la lecture), mais aussi le portrait de cette ville de Baker, petite ville désenchantée perdue au milieu de la Corn Belt.
Du point de vue du style, si j'ai beaucoup apprécié la qualité de la description des lieux et des situations (que ce soit l'incendie de la maison de gens qui voulaient du mal à sa mère, le conflit qui l'opposa aux harpies de l'église méthodiste, ou bien sûr ce final complètement dingue où un match de basket se transforme peu à peu en apocalypse générale), quelques effets de style répétitifs m'ont un peu dérangé, comme par exemple cette façon d'annoncer la colère à venir, "mais on n'avait jamais vu ce qui s'apprêtait à arriver". Des effets de manche qui virent presque au systématiques et qui deviennent un peu désagréables quand on a eu la malchance de se focaliser dessus. Mais rien de fondamentalement gênant, ceci dit.
Le plus beau passage, au sens propre, c'est sans doute lorsque John rencontrera le groupe travaillant dans l'entreprise de nettoyage des ordures de Baker, souvent décrits comme des rebuts de la société. C'est là que le sous-titre anglais trouve tout son sens : "tuer le veau gras et armer les justes". La grève dans laquelle s'engagera le noyau dur réuni autour de John est un moment magnifique, dans l'impact qu'elle aura sur la communauté, et assez horrible dans les conséquences à court et long termes. Le final conjuguera tous les vices de cette ville très conservatrice perdue au fin fond des États-Unis, pétrie de racisme, d'homophobie, de bigoterie, d'alcoolisme, et bien sûr de violence. L'histoire d'une vengeance, celle de l'ennemi public n°1 en quelque sorte, exclu parmi les exclus au sein d'une société cruelle, en dépit de son intelligence et sa bonne volonté.
Difficile de ne pas être (très) profondément ému par un tel récit, au terme du voyage, à la fin du cataclysme.