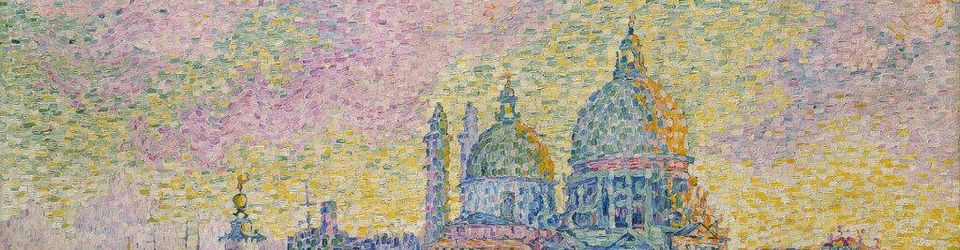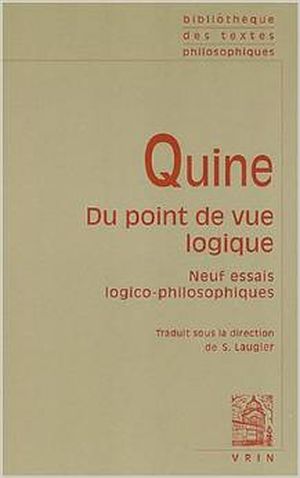Écrire un livre de métaphysique analytique
Chaque tradition philosophique a ses propres stratégies d'écritures. La France semble toujours avoir privilégié des stratégies d'écriture livresques. Un classique de la littérature française ne peut être qu'autre qu'un livre. Au contraire, dans le monde anglo-saxon, depuis l'essor de la philosophie ...
Afficher plus25 livres
créée il y a 11 mois · modifiée il y a environ 2 moisDu point de vue logique (1953)
Neuf essais logico-philosophiques
From a Logical Point of View: Nine Logico-Philosophical Essays
Sortie : décembre 2003 (France). Essai, Philosophie
livre de Willard Van Orman Quine
Holzfallen a mis 8/10.
Annotation :
From a Logical Point of View est un recueil d'articles sortis après la guerre. Recueil d'articles donc, mais le livre a une cohérence. L'ordre des articles est important et Quine met en place un système de notations qui permet de renvoyer aux différents articles. Il y a donc une certaine systématicité de l'ouvrage même si certains articles sont moins importants que d'autres.
C'est vraiment ce livre qui lance la MA. Les raisons sont très nombreuses. Tout d'abord, "On What There Is" redéfinit complètement la manière de faire de l'ontologie à partir de la méthode de l'enrégimentation et de la théorie de l'être comme quantification dans un système logique. La méthode quinienne est unanimement utilisée par les métaphysiciens maintenant. Cf article "Ontological Commitment" de la Stanford. L'article relance aussi la question des universaux. Ensuite "Deux dogmes" lance un débat métamétaphysique vis-à-vis de Carnap. Il en résulte une naturalisation de la métaphysique, elle aussi très en vigueur, par exemple chez Armstrong. Pour le débat, cf "Analytique-Synthétique" sur Encyclo-Philo. "Identité, Ostension, Hypostase" revient sur deux points qui deviendront des grandes questions de la MA : (1) La question de l'identité à travers le temps. En gros Quine défend une position perdurantiste. Voir "Temporal-Parts" sur la Stanford. (2) La question des universaux. Quine tente de penser sur le même plan l'identité des particuliers et des universaux. Il montre que ça ne fonctionne pas. Enfin, dernier article qui lance véritablement la MA : "Reference and Modality" où Quine développe à la fois un antiréalisme modal et le refus d'un "essentialisme aristotélicien" de par son principe d'extensionnalité. Cf ici l'article "Modalités" de Encyclo-Philo.
Ces articles, ce sont avant tout des défis lancés aux prochaines métaphysiciens. Si Quine refuse d'ontologiser les modalités, il faudra inventer les mondes possibles. Si Quine refuse l'existence des universaux, de par son goût des déserts ontologiques, il faudra développer une théorie réaliste immanentiste naturalisante...
Les Individus (1959)
Essai de métaphysique descriptive
Individuals : An Essay in Descriptive Metaphysics
Sortie : 1973 (France). Essai, Philosophie
livre de Peter Frederick Strawson
Holzfallen a mis 9/10.
Annotation :
On distingue classiquement, en MA, métaphysique descriptive et métaphysique révisionniste. Pourtant, personne n'utilise cette distinction. Elle vient de la préface de ce livre. Strawson oppose Descartes, Leibniz et Berkeley (révisionnistes) à Aristote et Kant (descriptivistes). Être descriptiviste, ce n'est pas dire comment la réalité doit être, mais décrire minutieusement comment nous nous rapportons à la réalité, en gros.
Il est difficile de dire si ce livre fait vraiment partie de l'histoire de la MA. Il n'utilise pas les mêmes schèmes argumentatifs, ne raisonne pas en termes d'engagement ontologique mais de schème conceptuel (autre grand concept quinien). Ainsi, ce livre se contente de décrire comment notre pensée commune et partagée parvient à individualiser des entités. Strawson n'est donc clairement pas ontologue. Il reste dans notre schème conceptuel et montre simplement comment celui-ci fonctionne pour l'individualisation. En cela, il est très kantien.
Strawson va distinguer deux types d'individus : les corps matériels et les personnes. Il montre alors comment on va les individualiser. Cela nécessite notamment un système spatio-temporel unifié. Il s'intéresse enfin au système monadologique de Leibniz dans la quatrième partie. Pour un commentaire de l'oeuvre voir Central Works of Philosophy, Tome 5.
Strawson n'a guère d'héritiers dans la MA et même dans la philosophie tout court. Il est important de souligner sa présence dans l'histoire de la MA même s'il en est à la frontière.
Identity and Spatio-Temporal Continuity (1967)
Sortie : 1967 (Royaume-Uni). Essai, Philosophie, Version originale
livre de David Wiggins
Counterfactuals (2013)
Sortie : 21 décembre 2013. Essai, Philosophie, Version originale
livre de David Lewis
Holzfallen a mis 7/10.
Annotation :
Lewis développe une théorie formelle des conditionnels contrefactuels en s’appuyant sur une sémantique des mondes possibles. Rejetant l’analyse strictement matérialiste de ces conditionnels, il propose d’évaluer leur vérité en termes de proximité entre mondes possibles. Un énoncé contrefactuel « Si A avait été le cas, alors B aurait été le cas » est vrai dans le monde réel si, dans les mondes les plus proches où A est vrai, B l’est aussi.
La notion de proximité entre mondes possibles devient ainsi centrale. Lewis défend un critère de similarité structuré par des considérations modales et contrefactuelles plutôt que strictement physiques ou nomologiques. Il rejette une métrique rigide et admet une hiérarchie de priorités : minimisation des violations de lois fondamentales, puis des différences historiques. Cela lui permet d’expliquer pourquoi certains contrefactuels ont des valeurs de vérité plus stables que d’autres et d’éviter des résultats contre-intuitifs, notamment dans les cas où de petits changements locaux produisent des divergences massives.
Sur cette base, il construit une logique des contrefactuels, en formalisant des principes comme la transitivité et la connexité de la relation de proximité entre mondes. Il examine les conséquences de sa théorie pour divers débats philosophiques, en particulier la causalité et la nécessité conditionnelle. En insistant sur la dépendance contrefactuelle comme critère de causalité, il ouvre la voie à des analyses ultérieures, notamment son propre travail sur le causalisme.
The Nature of Necessity (1974)
Sortie : 1974 (Royaume-Uni). Essai, Philosophie, Version originale
livre de Alvin Plantinga
Annotation :
Le premier grand classique de métaphysique modale. Plantinga y défend une métaphysique modale ersatziste (selon la terminologie imposée par D. Lewis). C'est-à-dire qu'il s'engage ontologiquement vis-à-vis des possibilia et des mondes possibles sans en faire des réalités physiques (ce que fait Lewis). Chez les ersatzistes, les possibilia sont pensées comme des êtres abstraits, de différentes sortes. Chez Plantinga, ce sont des états de choses maximaux. Il s'inspire en cela de Chisholm qui s'inspire lui-même de toute la tradition autrichienne (depuis Brentano). Il faudrait d'ailleurs discuter de la légitimité de Chisholm de figurer dans cette liste. Bien pointé par Lewis, il y a un problème de circularité dans les théories ersatzistes des modalités. Nous y reviendrons.
Plantinga lance aussi une nouvelle dynamique vis-à-vis des essences. Il défend l'idée que certaines propriétés sont nécessaires à un objet, tandis que d'autres sont accidentelles (essentialisme modéré).
La possibilité d'un tournant théologique inhérent à la métaphysique analytique est déjà bien présent dans ce livre. Plantinga applique en effet sa métaphysique modale à des questions directement théologiques. Il y montre notamment que Dieu existe dans tous les mondes possibles. Des conclusions moralement discutables.
Nominalism & Realism (1980)
Universals and Scientific Realism, Volume I
Sortie : octobre 1980 (Royaume-Uni). Essai, Philosophie, Version originale
livre de David Armstrong
Annotation :
Avec ce livre, Armstrong relance le débat scolastique sur l'existence des universaux. Il défend dans ce livre une position dite réaliste a posteriori. Plus précisément, son réalisme est immanentiste. Il défend donc une position néo-aristotélicienne.
La philosophie d'Armstrong se situe dans le sillage de la naturalisation de la métaphysique opérée par Quine. Si Armstrong s'engage vis-à-vis des universaux, c'est qu'ils sont cohérents avec les résultats de la science. Comme en philosophie de l'esprit, Armstrong maintient aussi une position physicaliste, ce qui explique sa position immanentiste.
D'autres découvertes sont à noter : le principe de l'identité partielle, la thèses des universaux structuraux, le débat sur la parcimonie des universaux...
Sameness and Substance (1980)
Sortie : 1980 (Royaume-Uni). Essai, Philosophie, Version originale
livre de David Wiggins
Annotation :
Ouvrage fondamental pour la métaphysique de l'identité et de la persistance. Une des grandes thèses défendue est celle de la dépendance sortale de l'identité. Grossièrement dit : être tel objet nécessite d'être un objet de tel sorte, sinon l'on ne peut individualiser et identifier le même objet. Comme les objets, dans leur individuation et leur identification, dépendent toujours de différentes sortes (sortal terms), Wiggins se voit obligé de défendre un essentialisme modéré qui affirme que les objets possèdent des caractéristiques essentiels ou non. Il reprend alors la théorie des substances d'Aristote. Enfin, il applique toutes ces réflexions à la théorie de l'identité personnelle.
La Logique des noms propres (1980)
Naming and Necessity
Sortie : 1 février 1982 (France). Essai, Philosophie
livre de Saul Kripke
Holzfallen a mis 8/10.
Annotation :
C'est surtout la troisième partie du livre qui a des conséquences et des ouvertures métaphysiques. Les deux premières lectures étant surtout sémantiques, et relevant de la philosophie du langage (dans un combat anti-frégéen).
A partir de réflexions sémantiques, Kripke développe une théorie modale de l'essence. C'est-à-dire que l'essence est vue comme les propriétés d'un objet qui subsistent dans tous les mondes possibles. On distingue depuis l'article de Kit Fine entre les théories modales (Kripke) et les théories non modales de l'essence (Fine). Kripke distingue alors différents types d'essences. Il s'intéresse notamment aux natural kinds, dans la lignée des travaux de Putnam. C'est-à-dire que les natural kinds (comme l'H2O) possède nécessairement certaines propriétés que l'on découvre progressivement. Les propriétés de l'H2O sont nécessaires mais a posteriori. Kripke s'intéresse aussi à la nécessite de l'origine. C'est-à-dire qu'un objet possède nécessairement, dans ses propriétés, son origine.
De la pluralité des mondes
On the Plurality of Worlds
Sortie : mai 2007 (France). Essai, Philosophie
livre de David Lewis
Holzfallen a mis 9/10.
Annotation :
Sans doute le livre le plus marquant de l'histoire de la MA. La thèse de Lewis est simple. C'est un réalisme modal : il défend le fait qu'il existe une pluralité infinie de mondes possibles. C'est une thèse assez fascinante. Dans la 2e et la 3e partie du livre, Lewis s'intéresse à des théories concurrentes et des objections.
La 1e partie du livre peut se diviser en deux. Dans un premier temps, Lewis montre que de s'engager ontologiquement vis-à-vis de mondes possibles permet de résoudre un certain nombre de problèmes de la MA. Cela permet tout d'abord un réductionnisme modal. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir rendre compte des modalités en termes intensionnels, on peut désormais en rendre compte de manière extensionnelle. C'est tout l'enjeu du texte de Quine. Ainsi, les modalités sont en fait une simple quantification sur les mondes possibles pour faire vite. Cf "Modalités" dans Encyclo-Philo. Ensuite, les mondes possibles permettent de rendre compte des énoncés contrefactuels en termes de proximités de mondes possibles. Troisième avantage : rendre compte des propriétés. Enfin, ils permettent de rendre compte de nos connaissances et croyances modales. En fait, Lewis est un réductionniste fou. Pour rendre compte des entités complexes tels que les contenus mentaux, les propriétés/universaux ou les contrefactuels, il décide de s'engager ontologiquement vis-à-vis des mondes possibles. Le deuxième temps du chapitre dégage 4 propriétés fondamentales des mondes : (1) leur isolement : les mondes sont des unités spatiotemporelles closes isolés causalement. (2) leur concrétude : Lewis n'aime pas les entités abstraites donc il montre que les mondes possibles sont des concrets. (3) leur plénitude : partie compliquée où Hume se sert de sa thèse de la survenance huméenne et du principe de complétude. (4) leur actualité : Lewis développe une théorie indexicale de l'actualité.
La 2e partie du livre développe une théorie des contreparties, c'est-à-dire s'attaque au problème de l'identité transmonde. Je ne développe pas ici. Voir "Transworld identity" sur Stanford.
A Combinatorial Theory of Possibility (1989)
Sortie : 1989 (Royaume-Uni). Essai, Philosophie, Version originale
livre de David Armstrong
Annotation :
Autre ersatzisme modale. Par souci naturaliste, Armstrong rejette l'idée que les mondes possibles de Lewis sont des entités réelles. A la place, il développe un théorie combinatorialiste de la possibilité. Les possibilia sont définies par les éléments réels. Elles résultent simplement de la combinaison différente de différents éléments réels et actuels. Cela nécessite une métaphysique statale (des états de choses : voir A World of States of Affairs). Cela implique un nominalisme et un réductionnisme. A noter que Armstrong est très influencé par Wittgenstein et par la notion d'espace logique.
Les Universaux (1989)
Une introduction partisane
Universals: An Opinionated Introduction
Sortie : 24 septembre 2010 (France). Essai, Philosophie
livre de David Armstrong
Holzfallen a mis 7/10.
Annotation :
Livre qui a vraiment mis sur le devant de la scène philosophique le problème des universaux. C'est sans doute la meilleure introduction à la MA. Armstrong avait déjà écrit sur les universaux en défendant un réalisme scientifique a posteriori et immanentiste. Ici, le livre présente toutes les théories des universaux de manière relativement pédagogique. La lecture est vraiment accessible. Le chapitre 2 et 3 s'attaquent aux deux grandes types de nominalisme. Puis, les chapitre 4 et 5 s'intéressent davantage à la théorie de l'objet. Le chapitre 4 s'intéresse à l'objet comme faisceau de propriétés. Et le 5 à la théorie des universaux comme attributs. Enfin, le chapitre 6 présente la théorie la plus intéressante, à mes yeux : la théorie des tropes ou particuliers abstraits.
Pour la question des universaux, cf le très bon article homonyme sur Encyclo-Philo.
Des êtres matériels (1990)
Material Beings
Sortie : 2024 (France). Essai, Philosophie
livre de Peter van Inwagen
Annotation :
Ouvrage extrêmement important pour l'histoire de la métaphysique analytique. Van Inwagen s'intéresse ici au problème des objets matériels. Les objets matériels posent, métaphysiquement, un problème de composition. En effet, ils sont composés de matière. La métaphysique y répond par des théories méréologiques (sciences des touts et des parties). Van Inwagen défend alors une position hyper-révisionniste par rapport à notre schème conceptuel commun. Il défend un nihilisme méréologique : les objets composés n'existent pas, seuls les atomes de matière existent. Sauf pour les objets vivants car la vie est un processus unificateur.
Différents arguments soutiennent ce nihilisme méréologique. Le plus important est celui de la redondance causale. C'est-à-dire que l'explication que l'on peut donner de l'objet matériel à partir de celui est redondante par rapport à l'explication que l'on peut donner à partir de ses atomes. Il faut alors réduire au plus simple. Il y a aussi l'argument de la colocation : les atomes occupent le même espace que l'objet matériel lui-même. Comment expliquer cela ? En fait, là ou Van Inwagen reste quinien, c'est qu'il montre que, en réduisant aux atomes, on s'évite un bon nombre de casses-têtes métaphysiques.
Il faut alors comprendre comment, malgré tout, nous voyons et nous utilisons tables, chaises, livres... Cela pose le problème de la "maintenance"...
Le livre a eu une portée exceptionnelle. Il faut mentionner l'utilisation par Jonathan Schaffer. Schaffer utilise les réflexions de van Inwagen pour soutenir un monisme. C'est-à-dire qu'il montre que le nihilisme méréologique le plus intéressant est celui qui admet l'existence d'une seule entité : le monde.
Holes and Other Superficialities (1995)
Holes and Other Superficialities
Sortie : 1995. Philosophie
livre de Roberto Casati et Achille C. Varzi
Annotation :
Est-ce qu'un trou existe ? C'est la question - très scolastique - que pose ce livre, devenu un fameux représentant de la skholè analytique (cf les EPR de Benoist).
Un trou ne peut pas exister seul puisqu’il est toujours dépendant d’un objet hôte. Il possède des caractéristiques telles que la forme, la taille et la position, bien qu’il ne contienne pas de matière propre. Il peut aussi être déplacé, par exemple lorsqu’un trou est perforé dans une feuille de papier. Ces caractéristiques soulèvent plusieurs paradoxes. Comment distinguer deux trous adjacents ? Sont-ils réellement séparés ou constituent-ils un seul trou à la forme irrégulière ? Que se passe-t-il lorsqu’un trou est bouché ? Disparaît-il ou est-il simplement comblé ?
La Construction de la réalité sociale (1966)
The Construction of Social Reality
Sortie : 1966. Essai, Philosophie
livre de John Searle
Holzfallen a mis 8/10.
Annotation :
Ce classique de Searle n'est pas à proprement parler un livre de MA. Néanmoins, il relance véritablement l'ontologie sociale. Je ne détaille pas trop ici. A noter que l'ontologie sociale reste un sujet important pour les métaphysiciens de la MA. CF. le le livre de Pierre Livet et Frédéric Nef sur les êtres sociaux ou les travaux pas forcément très féconds de Barry Smith sur la documentalité.
Une fiche de lecture ici : https://testconso.typepad.com/files/john-searle.-la-construction-de-la-realite-sociale4.pdf
(Le livre date de 1995, il y a une faute dans la base de données)
A World of States of Affairs (1997)
A World of States of Affairs
Sortie : 1997 (Royaume-Uni). Philosophie
livre de David Armstrong
Holzfallen a mis 8/10.
Annotation :
J'ai travaillé beaucoup sur ce livre pour un mini-mémoire. Il faudrait que j'écrive dessus. Armstrong tente de concilier naturalisme et état de choses (qui dérivent normalement de l'objectivisme sémantique). Cela donne un ouvrage en tension très intéressant.
Parts (2000)
A Study in Ontology
Parts
Sortie : 2000 (Royaume-Uni). Philosophie
livre de Peter Simons
Annotation :
Une exploration systématique de la méréologie. Simons revient sur la méréologie classique de Lesniewski et Whitehead. Il s'intéresse notamment aux paradoxes de la composition matérielle (van Inwagen) et de persistance (Sider). Il va quelque peu contextualiser la métaphysique analytique très décontextualisée.
À travers son analyse, il propose une méréologie plus flexible et nuancée, qui permet d’expliquer des phénomènes tels que l’individuation des objets, la nature des frontières entre les entités et les différentes manières dont un tout peut être décomposé en sous-ensembles significatifs. Son approche le conduit à repenser certaines notions classiques comme l’identité et la continuité, en cherchant à articuler une théorie qui soit à la fois rigoureuse sur le plan logique et fidèle à notre expérience du monde.
Four-Dimensionalism: An Ontology of Persistence and Time (2001)
Four-Dimensionalism: An Ontology of Persistence and Time
Sortie : 2001 (Royaume-Uni). Philosophie
livre de Theodor Sider
Annotation :
C'est une défense approfondie du cadrisme (ou quadridimensionnalisme), une théorie selon laquelle les objets persistent dans le temps en ayant des parties temporelles, tout comme ils ont des parties spatiales. L’ouvrage s’inscrit dans le débat philosophique sur la nature de la persistance et du temps, opposant le quadridimensionnalisme au tridimensionnalisme, qui soutient que les objets existent entièrement à chaque instant de leur existence.
Sider commence par établir la distinction entre deux manières dont un objet peut persister à travers le temps : l’endurantisme, qui suppose que les objets sont totalement présents à chaque instant, et le perdurantisme, qui les conçoit comme des entités ayant différentes parties temporelles (temporal parts) réparties sur leur durée d’existence. Il s’efforce de montrer que le perdurantisme est supérieur en termes de cohérence et d’adéquation aux données de la physique moderne, notamment à la relativité restreinte, qui remet en question l’idée d’un présent absolu et favorise une vision où le temps est une dimension comparable à l’espace.
L’argument central repose sur la thèse selon laquelle l’existence temporelle fonctionne de la même manière que l’existence spatiale. De même qu’un objet étendu dans l’espace est composé de différentes parties spatiales, un objet étendu dans le temps doit être conçu comme composé de différentes parties temporelles. Cela permet de résoudre certains paradoxes liés à l’identité à travers le changement, par exemple en expliquant comment un individu peut être à la fois jeune et vieux sans contradiction, puisqu’il s’agit de deux parties temporelles distinctes du même être.
The Possibility of Metaphysics (2001)
Substance, Identity, and Time
The Possibility of Metaphysics
Sortie : 12 juin 2001 (Royaume-Uni). Philosophie
livre de Jonathan Lowe
Ways a World Might Be (2003)
Metaphysical and Anti-Metaphysical Essays
Sortie : 2003 (Royaume-Uni). Philosophie
livre de Robert C. Stalnaker
The Four-Category Ontology: A Metaphysical Foundation for Natural Science (2005)
The Four-Category Ontology: A Metaphysical Foundation for Natural Science
Sortie : 2005 (Royaume-Uni). Philosophie
livre de Jonathan Lowe
Annotation :
Lowe propose une ontologie structurée autour de quatre catégories fondamentales, qu’il considère comme étant cruciales pour comprendre la réalité et les phénomènes naturels. Ces quatre catégories sont : les objets (les individus ou les entités concrètes), les qualités (les propriétés ou caractéristiques des objets), les événements (les processus ou changements auxquels les objets peuvent participer), et les substances (les supports sous-jacents qui possèdent des qualités et qui peuvent participer à des événements).
Lowe défend l'idée que ces catégories sont essentielles pour rendre compte des différents aspects de l'univers et pour établir une connexion entre la métaphysique et les sciences naturelles. Il soutient que ces catégories, en particulier les substances et les événements, sont indispensables pour comprendre la nature des lois de la physique et les relations causales. Les substances agissent comme les porteurs de qualités, et les événements sont vus comme des changements ou interactions dans le monde qui affectent les objets et leurs qualités.
Les Êtres sociaux (2009)
Processus et virtualité
Sortie : 10 juin 2009. Essai, Philosophie
livre de Pierre Livet et Frédéric Nef
Le Ciment des choses
Petit traité de métaphysique scientifique réaliste
Sortie : 19 avril 2011 (France). Essai, Philosophie
livre de Claudine Tiercelin
Holzfallen l'a mis en envie.
L'Anti-Hume (2017)
De la logique des relations à la métaphysique des connexions
Sortie : 2017 (France). Essai, Philosophie
livre de Frédéric Nef