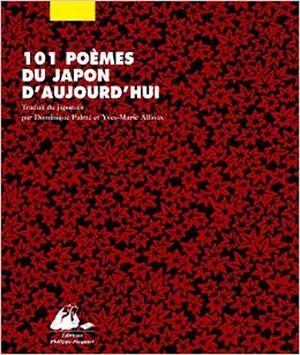Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2018/05/101-poemes-du-japon-d-aujourd-hui.html
D’AUTRES POÈMES JAPONAIS
Encore une chronique « poésie » ?! Nébal n’est plus Nébal…
Mais c’est une question de curiosité, en fait ; au-delà du constat maintenant bien assuré que la poésie japonaise classique – la plus classique – ne me laissait pas indifférent. Il s’agissait donc d’étendre le champ à des choses plus contemporaines, en contraste – pour retrouver une poésie libre, après plusieurs siècles de formalisme dans le tanka et sans doute aussi dans le haïku ; c’est bien pourquoi je vous avais parlé, il y a quelque temps de cela, de l’anthologie Haiku du XXe siècle : le poème court japonais d’aujourd’hui, compilée par Corinne Atlan et Zéno Bianu, lecture qui avait été plutôt fructueuse.
Seulement voilà : même si, vu de loin, on peut en avoir l’impression, la poésie japonaise, ce ne sont pas que des tanka et des haïkus. Il y a d’autres formes, à moins qu’il ne s’agisse du contraire de formes, et l’anthologie dont je vais vous parler aujourd’hui en témoigne : on y cherchera d’ailleurs en vain tanka et haïkus. En fait, les 101 poèmes ici reproduits sont souvent longs, voire « très » longs (à l’échelle de la poésie) ; mais ils sont aussi très libres – ce ne sont pas des chôka, format vite abandonné après le Man.yôshû, autant dire depuis une éternité.
Mais disons d’abord quelques mots de cette anthologie au plan éditorial. Cela n’a rien d’évident dans ce volume français, où l’information doit être traquée dans l’avant-propos et déduite de l’ours, mais il s’agit de la traduction d’une compilation de 101 poèmes de 55 poètes réalisée par le poète et critique Ôoka Makoto pour le compte des éditions Shinshokan en 1998 ; lesdites éditions ont semble-t-il publié plusieurs anthologies du même ordre, confiées à d’autres anthologistes, et avec cette même condition de livrer 101 poèmes ; mais, dans le cas présent, il s’agit bien de la sélection d’Ôoka Makoto (Ôoka Makoto hen), dont je crois avoir compris qu’elle a ensuite été mise en avant pour la traduction, mais là je ne suis pas sûr de moi. Deux traducteurs se sont associés pour cette version française, Yves-Marie Allioux et Dominique Palmé – mais il ne s’agit pas vraiment d’une collaboration : tous deux traduisent alternativement tel ou tel poème.
Haiku du XXe siècle, comme son nom l’indique, compilait des poèmes allant de Meiji à Shôwa sinon Heisei. 101 Poèmes du Japon d’aujourd’hui a une perspective plus resserrée et contemporaine : ces poèmes datent au plus tôt de l’après-guerre – et même en fait de l’après-après-guerre ; car, dans la poésie japonaise, l’après-guerre a constitué une période particulière, abondante et foncièrement traumatisée par les événements qui venaient de se produire ; la nouvelle poésie compilée par Ôoka Makoto (dont il fait lui-même partie, j’aurai l’occasion d’en citer un bel exemple) vise à dépasser cette douloureuse expérience, pour revenir à une plus grande liberté dans le fond aussi bien que dans la forme. Elle célèbre la fin de l’après-guerre, et se tourne résolument vers l’avenir.
La préface de Yagi Chûei est précieuse pour envisager ces questions de périodisation et d’atmosphère générale, en évoquant au passage, même brièvement, le parcours de quelques poètes majeurs (l’ouvrage est autrement quasi dénué de notes, notices, etc., ce que j’ai un peu regretté). Associée à l’avant-propos de l’anthologiste, cette introduction très riche présente quelques thèmes essentiels de la poésie japonaise contemporaine, notamment dans son rapport aux thèmes classiques, « les fleurs, les oiseaux, le vent et la lune » (kachô fûgetsu), qu’il s’agit de dépasser.
Par ailleurs, même si c’est lié, Yagi Chûei note que cette poésie de « l’après-après-guerre » n’est plus tant une « poésie qui chante » qu’une « poésie qui pense ». C’est en effet quelque chose de saisissant dans cette compilation – et, à mon sens tout du moins, d’assez périlleux, même s’il en résulte de très belles pièces : ces poèmes, relativement longs donc, ont souvent quelque chose de la communication d’une expérience sur un mode presque didactique, en dépit de la forme poétique jugée par essence hermétique (à tort, selon Ôoka Makoto – qui entendait entre autres montrer, avec cette anthologie, que la poésie contemporaine n’était pas si abstruse, et, peut-être surtout, que la poésie n’était pas l’affaire des seuls poètes affichés et reconnus comme tels). Cela oscille entre la tranche de vie et l’injonction – avec le risque non négligeable de virer parfois à la « leçon », empreinte de « sagesse »… Le genre de trucs qui m’agacent pas mal ! La plupart, heureusement, évitent cet écueil.
Pas tous, cela dit ? C’est qu’il y a peut-être un autre facteur à prendre en compte : l’âge des poètes. Rimbaud n’est peut-être pas tant un modèle qu’un symptôme : les adolescents rimaillent. Quant à le faire avec génie, c’est une autre histoire… Certains poèmes, ici, sentent l’adolescence – mais on peut très bien être à la fois jeune et sentencieux, même si souvent sur un mode hédoniste et détaché ; ces germes de poètes ne nous épargnent donc pas leurs leçons de sagesse et leçons de vie… Ceci étant, l’âge n’y change pas toujours grand-chose – et il y a peut-être quelque chose de rassurant, en même temps, à ce qu’on puisse demeurer un adolescent passé la cinquantaine… « On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans » ? Parfois, on voudrait l’être – et trente ans plus tard, alors ?
UNE SÉLECTION DANS LA SÉLECTION
Mais j’arrête d’écrire des (mes) bêtises. Comme toujours dans ce genre de chroniques, je ne peux pas pousser l’analyse plus loin – je n’en ai tout simplement pas les capacités. Mieux vaut citer quelques exemples des poèmes compilés dans cette anthologie – de ceux qui m’ont parlé, en version intégrale ou simplement au travers d’extraits. Avec la précaution habituelle : ce n’est pas ce qu’il y a de meilleur, c’est ce qui m’a plu.
À tout seigneur tout honneur ? L’anthologiste lui-même, Ôoka Makoto (1931-2017), figure dans sa propre anthologie… Mais à bon droit, en fait, car Toucher (1968) est bien un très beau poème – qui a quelque chose de la leçon que je dénigrais à l’instant, mais avec suffisamment de pertinence et d’émotion pour que la pilule passe, et même bien mieux que ça (pp. 107-108, traduction de Dominique Palmé) :
Toucher.
Toucher la sève sur les veines du bois.
Toucher les courbes lointaines de la femme.
Toucher la soif qui loge dans le sable des buildings.
Toucher la gorge d’une musique lascive.
Toucher.
Toucher, serait-ce voir ? Hé l’homme, à ton avis ?
Toucher.
Jus de citron touchant un gosier desséché.
Morne sagesse qui se fige à toucher le gosier d’un démon.
Doigt glacé touchant la zone épaisse d’une femme enfiévrée.
La fleur cette fleur en train de hurler.
Toucher.
Toucher, serait-ce savoir ? Hé l’homme, à ton avis ?
Par les nuits de jeunesse au début de l’été
Un désir à déchiqueter les étoiles.
Au bord de la fenêtre cette apparition qui s’éternise.
Journal mouillé sur une plage au loin et qu’au passage
Foulent en douceur des pieds doux.
Ces pieds, les toucher de l’intérieur de l’œil.
Toucher, serait-ce constater qu’on existe ?
Toucher les noms.
Toucher l’absurde écart entre les noms et les choses.
Toucher l’angoisse de toucher.
Et l’excitation qui naît de cette angoisse même.
Toucher l’angoisse de se dire que jamais l’excitation
Ne garantit la justesse de ce que l’on perçoit.
Toucher, serait-ce vérifier la justesse du toucher ?
Cette justesse du toucher que le toucher même
Ne peut garantir, où donc la trouver ?
Le jour où j’ai enfin appris à toucher
J’ai su que je m’éveillais à la vie.
D’ailleurs, s’éveiller, quoi de plus naturel ? Dès que je l’ai su
J’ai fait la culbute hors de la nature.
Toucher.
Inscrit dans le temps tout phénomène est pure fiction.
C’est donc le moment de toucher. De toucher toutes choses.
C’est donc le moment par ce simple geste de tâtonner en quête de justesse
Pour sentir que ce que l’on touche est pure fiction.
Que le fait de toucher l’est plus encore.
Où donc aller ?
Toucher l’angoisse de toucher.
Saisir le cœur d’un ongle acéré que l’angoisse fait trembler.
Qu’importe, il faut toucher. Partir du toucher pour tout recommencer.
Sans espoir de rebond
Ceci étant, en fait de « seigneur », j’en ai un autre : mon poème préféré, dans l’ensemble de cette compilation, est très certainement le Chant du matin dans un hôtel à l’ancre (1949), d’Ayukawa Nobuo (1920-1986) ; le voici dans son intégralité (pp. 50-52, traduction d’Yves-Marie Allioux) :
Sous cette pluie battante qui s’était mise à tomber
Tu voulais seulement t’en aller au loin
À la recherche d’un garde-fou contre la mort
Tu voulais t’éloigner de cette ville de tristesse
Et quand j’ai enlacé tes épaules mouillées
La ville dans le vent nauséabond du soir
M’a fait penser à un port
Allumant une à une les lumières des cabines
Dans la nostalgie des âmes innocentes
Une grande ombre noire s’est tapie sur le quai
Abandonner les remords détrempés
Partir au large sur l’océan
Avec toi sur moi comme un sac sur le dos
Je voulais m’en aller naviguer !
Le vague grésillement des fils électriques
Faisait dans mes oreilles ce bourdonnement qui voltige sur la mer
Dans notre aube
Un bateau d’acier rapide en filant
Aurait dû emporter nos deux destins sur les flots bleus
Mais finalement toi et moi
Ne sommes partis nulle part
À travers la fenêtre de ce misérable hôtel
J’ai craché sur la ville au point du jour
Nos paupières lourdes de fatigue
Pendaient alors sur nos yeux comme des murs gris
Elles avaient enfermé sans retour dans le vase de verre
Espoirs et rêves vains les miens comme les tiens
Et le bout de la jetée brisée
Fondait dans l’eau croupie du vase
Seul on ne sait quel manque de sommeil
Stagnait encore comme une infâme odeur d’hôpital
Mais la pluie de la veille
Indéfiniment entre nos cœurs déchirés
Et nos corps brûlants
Sur cette vallée de mélancolie vide ne cessait de tomber
Nous-mêmes notre dieu
L’aurions-nous pour toujours étranglé sur ce lit ?
Toi tu te dis que c’est moi
Moi que c’est toi qui serais responsable
Je mets alors la cravate négligée des crises de foie
Tandis que tu poses sur ton dos rond
Ton petit visage maquillé en vautour
Et quand nous nous attablons pour le petit déjeuner
Devant l’avenir mollet
De ces œufs fendillés
Tu arbores un sourire stupidement mystérieux
Moi je brandis une fourchette haineuse
Avec la tête d’un homme qui a vidé l’assiette grasse
Des adultères bourgeois
Le paysage à la fenêtre
Est prisonnier de son cadre
Ah ! Moi je veux la pluie les rues le soir
Car si la nuit ne vient pas
Comment réussirais-je à bien étreindre
L’immense panorama de cette ville d’ennui ?
Naissance entre deux grandes guerres à l’ouest et à l’est
Échec de l’amour comme de la révolution
Brusque descente aux enfers et voilà cet
Idéologue à la mine renfrognée qui se montre à la fenêtre
La ville est morte
Le vent frais du matin
Met son rasoir froid sur ma gorge qu’un collier a blessée
Et à mes yeux l’ombre humaine debout près des fossés
Apparaît comme un loup aux flancs crevés
Qui n’aura jamais plus à hurler
Si cela faisait sens de parler de « concurrence » entre de beaux poèmes, je pense que le principal rival du précédent serait la Morne Plaine (1985) de Shindô Ryôko (née en 1932) ; en voici la traduction intégrale, par Yves-Marie Allioux (pp. 130-131) :
Plus loin que les champs de sorgho plus loin que les verts pâturages
Plus loin encore que ces étendues propices aux pavots rouges qui y fleurissent à foison
La steppe d’été
Se poursuivait jusqu’aux limites extrêmes de l’horizon
Après le lever du jour
En une demi-journée à peine un soleil déclinant
Allait se fondre en une teinture de sang imprégnant terre et ciel
Puis c’était au tour de la lune d’illuminer de son pur éclat le moindre recoin de la plaine
Déjà trois jours que ce paysage restait toujours le même
Et chaque jour à l’horizon se levait un soleil qui ne tarderait plus à sombrer
Père me voilà maintenant
Qui vais à ta rencontre, vois-tu ?
Franchissant la Grande Muraille de Chine
Voici que moi qui n’ai vécu que neuf petites années
Cette enceinte fortifiée dont la construction a duré deux mille ans
Je la dépasse aujourd’hui
Les deux mille ans de la Grande Muraille
Mes neuf ans
Et les trente-six ans que tu auras vécu Père
Sont semblables aux mirages
Le maître d’un air sévère avait conclu
« … c’est pourquoi tu dois rentrer tout de suite » et à cet instant
L’enfant assis à côté de moi murmura
« Quelle chance que ce ne soit pas mon père ! »
Et à ces mots en cet instant
Je ne pus malgré moi m’empêcher d’éclater en sanglots…
À voir ainsi ces vastes étendues se poursuivre aussi interminables
À me retrouver ainsi enveloppée dans un soleil couchant aussi grand
Que notre vie
Soit encore plus minuscule qu’une graine de pavot c’est ce que je comprenais pour la première fois
Ce ciel et cette terre avaient tout absorbé
Je n’étais pas la seule à avoir pleuré
Les habitants de ce pays eux aussi pleuraient et encore davantage !
Notre vie au sein de l’éternité
Était aussi éphémère qu’une seule de nos larmes
Et que sur cette terre si belle les hommes se laissent pourtant emporter par la guerre
Qu’y avait-il de plus vain ?
Peut-être qu’un jour dans le futur ces pensées
Cette morne plaine me rendront nostalgique ?
Même après que nous aurons disparu
Chaque jour le soleil se lèvera retombera
Père ! Moi je suis en vie !
Jusqu’à ce que devenue une goutte de sang je pénètre profondément la terre
Jusqu’à ce que je me mêle aux flots de la mer
Je vais vivre je me fais fort de vivre
Allez transporte donc ma vie
Train à vapeur ! Ferghana de sueur de sang !
Auprès de mon père réduit à si peu
Oui tout près
Dans un registre qu’on pourrait peut-être qualifier de lyrique, non sans quelque chose de morbide peut-être, j’ai également été séduit par la Nuit (1950) de Nakamura Minoru (né en 1927) ; dans la traduction (intégrale) de Dominique Palmé (p. 85) :
Comme des biches en fuite est-ce ainsi qu’ont filé les jours suffocants ?
La nuit solitaire m’attendait au milieu de l’odeur des algues pourrissantes
Au milieu du désir d’un alcool métallique qui bouillonne combien de nuits ont-elles naufragé ainsi ?
Quelque chose se blottissait contre les plis des vagues semblant lancer un appel sans voix
La mer obscure secouait les cous évasés et blêmes des femmes
Et les marches discontinues couleur de cinabre…
L’eau frissonnait finement et il y avait une main bestiale et rude
Nuits naufragées, combien ont-elles cherché de tombes ?
Ont-elles oublié les innombrables yeux tombés de leurs orbites ?
La mer obscure secouait les cous évasés et blêmes des femmes
Les nuits passeront sans doute comme des empennes de flèches enflammées
Sans doute iront-elles se cacher cherchant des tombes dans les profondeurs…
Dans les plis des vagues il y avait une grande main bestiale qui enserrait ma nuit solitaire
En contraste, même si sur le mode de la « leçon de vie », je citerais bien, autrement critique, et représentatif d'une certaine poésie du quotidien, du prosaïque, Avancement chez les cadres (1979), de Nakagiri Masao (1919-1983) ; le voici, dans une traduction de Dominique Palmé (p. 41) :
« À tous les coups, ce sera vous le prochain directeur adjoint de notre succursale ! »
En regardant s’il change de tête, vous lui faites du plat,
Et l’homme concerné, la mine soudain hilare,
Remplit votre coupe de saké et dit « allez, buvons un coup ! »
« Le chef de bureau, il ne sait pas bien utiliser les gens… »
« Sa promotion de directeur, c’est râpé, à ce qu’on dit ! »
Partout au Japon, il n’y a que des entreprises,
Alors dans les bars on ne parle que d’avancement et de mutations
Bientôt on se sépare et tout le monde se retrouve seul,
Le vent nocturne du début du printemps caresse toutes les joues au passage,
À mesure que l’ivresse se dissipe la solitude s’installe,
Et on lance des coups de pied dans les paquets de cigarettes vides et dans les cailloux.
Pourtant quand on était enfant on faisait des rêves
Pourtant avant d’entrer dans l’entreprise on possédait aussi un petit idéal.
(Ce qui me fait aussitôt penser à la tragique pub de l’INSEEC : « Entrez rêveur, sortez manager. » Pauvres de nous…)
Je vais m’en tenir là pour les poèmes cités dans leur intégralité, mais d’autres ont pu me toucher, sinon sur la durée, du moins au travers d’extraits saisissants. J’en citerais bien deux exemples, et tout d’abord les deux dernières strophes de Moines (1958), de Yoshioka Minoru (1919-1990), dans une traduction de Dominique Palmé (pp. 33-34) :
[…]
8
Quatre moines
L’un a mis au monde mille bâtards dans un champ d’arbres morts
L’un a fait mourir mille bâtards dans une mer sans sel et sans lune
L’un, posant sur les plateaux d’une balance où s’entrelacent vignes et serpents
Les pieds des mille morts et les yeux des mille vivants, s’étonne de voir qu’ils pèsent le même poids
Celui qui est mort, de nouveau malade
Tousse de l’autre côté du mur de pierres
9
Quatre moines
Quittent la citadelle des cuirasses rigides
N’ayant rien moissonné de leur vie,
Dans un lieu plus élevé que le monde
Ils se pendent et ricanent de concert
Voilà pourquoi
Les os des quatre moines, aussi épais que les arbres d’hiver,
Resteront morts jusqu’au jour où la corde cassera
Et un dernier exemple, avec un extrait de S’il descend vers un monde sans précédent… (1968), de Yoshimoto Takaaki (1924-2012), dans la traduction d’Yves-Marie Allioux (p. 73) :
Entouré de mystères ce qui file
Au tréfonds de lui-même ce sont ces rêves que sans doute il ne pourra réaliser
Ses passions sans fondement auxquelles sa faim aspire
Un amour sur le point d’être effacé
Et lui qui a connu la honte de ce qui s’écrit sur la page blanche
Lui s’embarquera vers le futur
ENTRE DEUX EAUX
Le bilan est – comme toujours ? – un peu mitigé. Les poèmes que je viens de citer, en intégralité ou en extrait, m’ont touché, d’une manière ou d’une autre ; d’autres également l’ont fait, qui n’ont pas intégré cette sélection dans la sélection, parce qu’il y manquait peut-être un tout petit quelque chose, ou plus probablement parce que je craignais que l’exhaustivité ne finisse par donner un catalogue absurde. Nombreux, à côté, sont les poèmes qui m’ont laissé parfaitement froid – parce que trop leçons de vie, ou trop « surréalistes », mais sur un mode un peu automatique, régulièrement puéril à mes yeux et mes oreilles (surtout quand les allusions phalliques, notamment, étaient de la partie).
Mais j’ai apprécié cette lecture – pour la beauté de certains poèmes, la puissance de quelques autres, la pertinence enfin d’un certain nombre. Et aussi parce que cette anthologie témoigne de la variété de la poésie japonaise contemporaine. Même si, je suppose, il serait quelque peu triste de s’en tenir à ce seul intérêt « à titre de document »… Heureusement, les poèmes qui m’ont touché sont suffisamment nombreux pour que l’on aille au-delà. Mais, oui, il est intéressant d’envisager la poésie japonaise sous cet angle plus contemporain, et sa vivacité au-delà des formes canoniques des tanka et des haïkus ; ne serait-ce qu’à cet égard, 101 Poèmes du Japon d’aujourd’hui est une lecture utile – par chance, c’est aussi régulièrement une lecture touchante. Après, ce qui touche, ce qui ne touche pas, ma foi, c’est à chacun de voir…