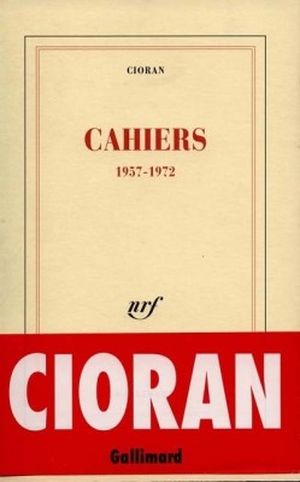J'avais, jusqu'ici, considéré Cioran, sans réellement le lire, comme une sorte de machine rhétorique creuse, campé en une posture largement affectée. En lisant ses Cahiers 1957-1972 (premier opus de ses cahiers, le second n'étant pas publié à ce jour), je suis au contraire sidéré par la délicatesse et la pugnacité de son désespoir, aussi stimulant que la négativité radicale de Thomas Bernhard, par ses phrases affûtées, largement au-delà de notes ordinaires, et par sa capacité à faire mouche dans la concision et la répétition. Bien qu’il soit difficile de dire si les Cahiers constituent une sorte de journal de l'écrivain, le « je » et l’état atmosphérique mobile qu’il désigne par convention inappropriée est nettement présent dans cette écriture de l’affect qui fait l’effet de clous enfoncés au marteau. Je n’étais guère attiré par Cioran parce que je le considérais comme un philosophe de seconde zone mais je réalise qu'il est fondamentalement un écrivain, ce qui change radicalement la donne : il s'agit bien d'un écrivain de premier plan. Je ne sais si ce « je » cioranesque est circonstance de perception ouvrant sur des états de chose ou circonstance de considérations orientées vers l’infini de la pensée, fût-ce à partir du moindre commentaire, mais il est en tout cas un état vibrant perpétuellement en souffrance et perpétuellement agité, servi par une lucidité et une saisie aperceptives réellement remarquables.
Il est par ailleurs parfaitement bipolaire et, bien qu’il ne connaisse nul repos, semble expérimenter par moments des instants de bonheur fulgurants qui le submergent avec la même violence que celle de son désespoir permanent. Il est fort possible que cet être improbable soit avant tout un personnage de fiction, mais qu’importe in fine si résiste l’ethos de sa langue et de tout l’affect qu’elle charrie jusque dans les Cahiers. Il aurait alors au moins eu la rigueur stupéfiante de vivre cette fiction jusqu’au bout, se dérobant aux moindres sollicitations divergentes et aux tentations innombrables à poser les armes, à mettre à bas le masque, à se confier, à se faire un visage qu’il pût enfin nous montrer.
Il serait néanmoins piquant que ses écrits plus célèbres ne soient en réalité qu’une généralisation abusive d’un état foncièrement singulier que ces Cahiers auraient capté avec une authenticité plus grande. Si cette idée me plait, c’est à n’en pas douter qu’elle justifierait ma découverte tardive de Cioran en même temps que l’intérêt que je porte à présent plus que jamais au journal. Il n’empêche que s’il n’y a pas, dans ses écrits canoniques, le même levier circonstancié de la subjectivité relative, à l’instar des préfaces tardives que Nietzsche apporte dans les années 1880 à ses premiers ouvrages et qui sont tellement plus intenses que les fragments qu’elles présentent, ce serait alors un journal, ou assimilé, au statut exceptionnel dans le rapport à l’œuvre qu’il accompagne. Et dire que Cioran avait considéré au moins par moments qu’il fallait détruire ces Cahiers, ce que leur conservation minutieuse et soigneuse semble avoir, entre autres choses, fort heureusement contredit.
Il y a dans ses états fiévreux d’une douleur aigüe et dans son style obsessionnel et négatif quelque chose d’une rencontre entre Artaud et Bernhard, mais je n’ai encore lu nulle part (sans avoir beaucoup lu) cette obsession autodépréciative qu’on trouverait peut-être sous des formes paranoïaques ambigües chez Rousseau (mais je ne le signale, pour mémoire, que par ouï-dire). Sa rage à se déprécier obstinément, au-delà de toute rémission, cependant mâtinée d’une lucidité adamantine, d’un orgueil assumé, et d’un idéalisme tenace (et religieux) produit un esprit paranoïaque tentaculaire remarquable se développant dans une esthétique fragmentaire.