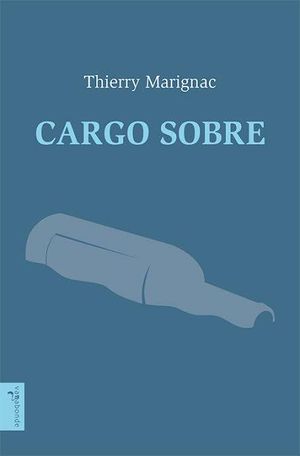S’il faut vraiment choisir un genre pour Cargo sobre, ce sera celui du journal de bord. Le livre est, comme d’habitude chez Vagabonde, d’un joli format, avec des marges harmonieuses, une typographie aussi sobre que le demande le titre, un papier d’une belle tenue, et une couverture parfaitement en accord avec le contenu.
En 2013, Thierry Marignac, pour filer la métaphore marine, est au creux de la vague. Dans ces moments-là, il faut une rupture totale avec la vie qui va mal, et le monde qui n’a rien de réconfortant. Marseille – New York en porte-conteneurs, sur un bateau où l’alcool est interdit : une rupture en forme de cure. Si l’oubli était au programme, il est vite oublié.
Car sur cette embarcation sans romantisme aucun, deux semaines de « décroche », ça n’est pas le moindre des défis. Et c’est aussi le fil conducteur d’une traversée de la mémoire. Les instants qui précèdent le départ sont déjà un départ : « Il pleuvait à verse par une de ces journées indécises, entre gris et jaune couleur pétrochimique… » Curieusement, les premiers instants sont racontés sur le mode cocasse : une façon peut-être de faire peur à la peur ? « Je concevais donc ce voyage comme une étape utile vers un apaisement salutaire. » De but en blanc, notre auteur dont la pudeur est presque une légende plonge tête la première au cœur de la douleur. Entre une histoire familiale qui aurait pu rendre enragé le plus pacifique des agneaux, une destruction progressive de tout ce qui est supposé faire une vie d’homme, Marignac se dépouille dès les premières pages de cette maudite peau, et se présente à nous totalement à vif, pour peu qu’on sache lire.
Une fois tous ces fauves lâchés sur le papier, on a l’impression d’entendre comme un grand soupir de soulagement, place à la mémoire, et aux rencontres les plus touchantes et les plus étonnantes qui ont émaillé la vie de l’auteur, pirate de la littérature, aventurier du verbe. De Kim Wozencraft, ex-flic des stups, éphémère romancière à succès devenue toxico puis abstinente et écolo, à Kathy Acker, romancière américaine et Alasdair Gray, auteur et artiste écossais, Thierry Marignac s’offre, et nous offre, une suite d’évocations de personnages rares, singuliers, inclassables. Sans oublier au passage de régler quelques comptes, histoire qu’on n’en parle plus, peut-être.
Mais ce qui reste dans l’esprit et dans le cœur, une fois atteint Port Elizabeth, près de New York, c’est, encore et toujours, le style. Une certaine façon de se regarder soi-même, sans auto-apitoiement, avec une forme de résistance à l’adversité qui transpire à travers des mots comme ceux-là, écrits au cœur d’une description particulièrement lucide de ce cargo qui le porte, lui, le fétu de paille, et des machines qui vont avec : « Le drame, digne d’une série télé pour rombières, de mes soixante-douze kilos de chair et d’os était à son tour ridiculement microscopique, prêtant à rire au regard de la circulation mécanique des choses dans son vacarme primordial, sa démesure. » Le problème du chroniqueur, là, c’est qu’il a envie de citer à peu près les trois quarts du texte, ce qui ne se fait pas… Sachez simplement qu’on regrette amèrement, finalement, que l’auteur ait atteint si vite Port Elizabeth. On l’aurait bien accompagné un peu plus loin encore…