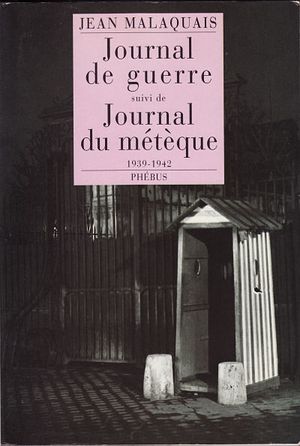Début septembre 1939, Malaquais se trouve embarqué comme simple soldat dans «la drôle de guerre» et se retrouve en assez piètre compagnie à remuer de la boue et du ciment en Lorraine en prévision de l’invasion teutonne qui se doit de passer en ces lieux.
Si ce journal, fruit de ces circonstances particulières, démarre assez lentement et quelque peu laborieusement, notre auteur va progressivement trouver le rythme correspondant à cet exercice particulier et surtout, grâce à ses talents d’observation acérés, se saisir pleinement de l’esprit de cette époque où prédominent l’absurde et la confusion.
De ce qui aurait pu n’être qu’un simple témoignage individuel, il dresse un tableau plutôt accablant d’une France vivant dans de ridicules illusions et qui n’allait pas tarder à sombrer dans les plus médiocres renoncements et ignominies de la collaboration et du pétainisme.
Pas prétentieux le soldat Malaquais qui, alors qu’il patauge pour rien dans les champs de Moselle, apprend par son éditeur début décembre que son roman « Les Javanais » a décroché le prix Renaudot, événement qui restera pratiquement sans conséquences sur sa situation.
Ce qu’il pressent du désastre à venir, à travers ce qu’il constate, le tracasse beaucoup plus ; alors même que l’état-major y va encore de ses déclarations sur «l’invincible armée française».
On sait la suite : c’est la Belgique qui subira l’assaut principal de l’armée d’Hitler et les troupes françaises contournées par le nord se rendront quasiment sans combattre dans une débandade générale. Estimant avoir poussé l’abnégation assez loin, Malaquais s’évade avec un compagnon d’une colonne de prisonniers et après un long périple rejoint avec lui Paris le 13 juillet 1940.
Débute alors la seconde partie de l’ouvrage, dite Journal du Métèque.
Si Malaquais se désigne lui-même ainsi, c’est qu’il est d’origine juif-polonais et que la généreuse république française malgré son appel « sous les drapeaux » l’a laissé dans un statut d’apatride, tout désigné pour les camps d’extermination. Aussi ne se fait-il guère d’illusion avec sa compagne d’origine russe sur cette France d’alors où il voit que « Le diable ne sait plus où donner de la tête, tant le sollicite de toutes parts quiconque pense avoir un brin d'âme à vendre. »
En ce Paris désert de l’été 40, et malgré l’incertitude de sa situation, Malaquais sait encore saisir la poésie de l’instant, « Beauté de ce Paris vide de gens, de voitures, de fracas mécanique. Tout au long du jour, où que l'on regarde, et malgré la lueur du ciel, c'est l'aube. C'est l'heure paisible où la ville s'appartient, où la pierre est à la pierre. Émerveillement d'apercevoir un cycliste au loin, une charrette à bras, présences insolites qui soulignent la précarité de l'homme. »
Ce qui ne l’empêche pas de constater, « De même que le prétendu communisme stalinien, la peste brune vise la surexploitation toujours plus féroce du travail salarié. Tout habillage idéologique - nation, patrie, race – ne fait qu’occulter cette vérité première : plus que jamais, il n’y a guerre que de rapine. »
En octobre, Malaquais rejoint le sud de la France et Marseille où il va survivre tant bien que mal, en travaillant entre autre à la Coopérative Croquefruit, aussi avec l’aide d’André Gide et de Jean Giono. Pour comprendre la situation de tous les opposants fuyant les régimes totalitaires européens, dans lesquels il faut intégrer de nombreux antistaliniens, il faut se rappeler l’infâme article 19 de la convention d’armistice signé par le gouvernement pétainiste avec les nazis, par lequel celui-ci s’est engagé à livrer sur simple demande à ceux-là tous les ressortissants étrangers désignés. Ce qui correspondait à un passeport direct pour les camps d’extermination. Marseille était donc bien alors, pour tous ces réfugiés, la principale issue pour fuir la mort, où chacun espérait un visa pour le Mexique, l’Amérique du sud ou les Etats-Unis. Sachant également que la presse national-collaborationniste, par la voix des Rebatet, Brasillach, Maurras, Céline et leurs émules, crachait à jets de fiel continus sur les « ennemis de l’intérieur », appelant à leur extermination. A quoi Malaquais répond dans ce journal : « Nationalismes … Toute borne est arbitraire, qui désunit et compartimente les peuples. Tels qui, ici ou là-bas, exaltent leur chaumière, leur clocher natifs trucideraient, la conscience tranquille, leurs analogues que le sort aura fait naître de l’autre coté du poteau frontalier. Pour moi, qui récuse la moindre allégeance politique à l’idée d’Etat, de nation, il n’y a jamais eu de patriotisme que chauvin et belliqueux. »
Ce n’est que fin septembre 1942, que Malaquais et sa femme Galy réussiront à quitter la France et après avoir traversé l’Espagne avec de faux papiers, à embarquer à Cadix sur le Cabo de Buena Esperanza. Le 12 novembre 1942, les troupes allemandes rentraient à Marseille.