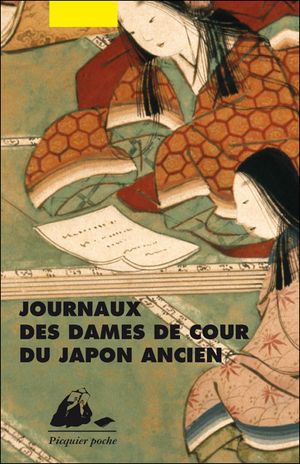Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2018/04/journaux-des-dames-de-cour-du-japon-ancien.html
LES NIKKI, LITTÉRATURE FÉMININE
À l’apogée de l’époque de Heian, vers l’an mil, tandis que le clan des Fujiwara est au sommet de sa gloire et de sa puissance, la littérature japonaise est plus qu’à son tour l’affaire de femmes – et leur condition, dans les rangs de l’aristocratie du moins (on ne sait rien de ce qu’il en était dans la paysannerie, sans surprise), était sans doute plus enviable que celle que subiraient les Japonaises dans certaines époques ultérieures, même s’il ne faut pas non plus se leurrer quant à leur liberté dans la période qui nous intéresse ; le fait que l’on ne sache presque rien de la vie de ces différentes autrices est peut-être significatif, d’ailleurs.
Mais oui : la poésie, l’essence de la littérature de ce temps, voit briller des hommes, mais aussi des femmes, jugées en matière de sensibilité et de subtilité leurs égales ; et certaines de ces dames de cour trouvent également à s’illustrer dans d’autres formats, produisant des chefs-d’œuvre qui ont été transmis jusqu’à nous en raison de leur immense valeur littéraire. Les deux titres les plus célèbres, ici, sont probablement le roman fleuve de Murasaki Shikibu qu’est Le Dit du Genji, et les Notes de chevet de Sei Shônagon, dont je vous ai parlé il y a peu.
Ce dernier ouvrage, sans y correspondre pleinement, peut évoquer un genre littéraire alors très en vogue auprès des dames de cour : le journal intime, ou nikki. Durant cette période, on en compte bien des exemples, mais les trois les plus célèbres figurent dans le présent petit ouvrage (dont on regrettera qu’il s’agisse d’une vieille traduction de l’anglais, par Marc Logé en l’espèce, traductrice historique de Lafcadio Hearn ; depuis, des traductions du japonais, et autrement plus précises, de ces divers textes ont été livrées, par René Sieffert tout particulièrement, qui ont pour certaines d’entre elles été reprises chez Verdier, tout récemment encore le Journal de Sarashina ; il faudra sans doute que j’y jette un œil…).
Le nikki est un genre réservé aux femmes – mais, étrangement, il a été initié par un homme, le fameux poète Ki no Tsurayuki. Un personnage assez fascinant : principal compilateur du Kokinshû, la première des grandes anthologies poétiques impériales, il avait livré à cette occasion une préface en japonais, fait peu ou prou inédit (le développement des kana a constitué une étape cruciale), dans laquelle il défendait la valeur de la poésie japonaise, qui égalait bien la poésie chinoise, mais aussi, sur le même registre, de la langue japonaise. Par ailleurs, et c’est ce qui nous intéresse ici, il était l’auteur d’un petit ouvrage appelé Journal de Tosa (Tosa nikki), très singulier. À l’époque, on employait le mot nikki pour désigner des « journaux » tenus par des hommes, et qui avaient un caractère « public » : les fonctionnaires y notaient les affaires du jour, avec un côté « livre de raison » en sus. Mais le Journal de Tosa, c’est tout autre chose – le récit du retour de Ki no Tsurayuki de la province de Tosa, où il avait été envoyé en tant que gouverneur, vers la capitale, Heian (la future Kyôto) ; le voyage dure une cinquantaine de jours, et l’ambiance est pesante du fait du décès de la fille de l’auteur quelque temps auparavant. Mais Ki no Tsurayuki voulait narrer tout cela en japonais : pour ce faire, il a rédigé son texte en kana – or les hommes se devaient d’écrire en caractères chinois, en kanji, lesquels étaient interdits aux femmes… Il s’est donc fait passer pour une femme, afin de pouvoir écrire ce texte comme il l’entendait : dans les premières lignes de ce journal, il se présente comme étant une servante de Ki no Tsurayuki, lequel est donc désigné à la troisième personne – ce qui a un effet marqué sur l’expression de son deuil. La servante en question concède d’abord que les journaux sont l’affaire des hommes, mais entend cependant raconter le voyage de son point de vue de femme, et avec la langue d’une femme. Maintenant, la véritable identité de l’auteur ne trompe guère – car ce journal est l’occasion, pour tous les personnages mentionnés, inclus les enfants ou les marins, de composer de très nombreux poèmes courts, des tanka, souvent d’un extrême raffinement. Je relève aussi cette ultime remarque de la servante, prétendant qu’il vaudrait mieux sans doute détruire ce qu’elle a écrit…
Reste que, de la sorte, Ki no Tsurayuki a inventé le modèle du nikki, qui serait abondamment repris par la suite – et bel et bien par des femmes, cette fois ! Cependant, ce modèle est en fait relativement informel, et les nikki ultérieurs pourront prendre des formes très diverses, ce dont témoignent les trois fameux exemples ici compilés (les Notes de chevet de Sei Shônagon étant probablement hors concours de toute façon).
JOURNAL DE SARASHINA
Envisageons-les dans l’ordre du recueil – qui n’est pas celui de leur composition, puisque le premier, le Journal de Sarashina, est en fait le plus tardif ; mais c’est aussi, en ce qui me concerne, le plus fort, et le plus beau…
On ne sait donc quasiment rien de l’autrice – pas même son nom (Sarashina désigne une région – accessoirement celle du mont Obasute, ce qui nous renvoie à La Ballade de Narayama). On connaît cependant celui de son père, Sugawara no Takasue, ce qui en fait une descendante du célèbre conseiller Sugawara no Michizane, déifié à titre posthume pour apaiser sa colère à l’encontre des Fujiwara (mais elle semble avoir épousé un Fujiwara, ils étaient partout...).
Ce journal est très différent des deux autres figurant dans ce livre. En fait de journal, il s’agit d’ailleurs plutôt de mémoires, écrites la cinquantaine passée par une femme qui se replonge dans l’ensemble de sa vie (au début du texte, elle a douze ans à peine), en ménageant de longues ellipses entre les diverses séquences. Un autre point distinctif à relever réside dans le récit que fait l’autrice de divers voyages – pour suivre son époux en province, pour faire un pèlerinage, etc. Là où les deux autres journaux de ce recueil restent essentiellement centrés sur la capitale, Heian, celui de Sarashina s’attarde sur ces déplacements, et décrit un Japon plus divers, avec une grande attention à la beauté des sites naturels, qui révèle toute la sensibilité poétique de l’autrice – qu’elle s’exprime effectivement en poèmes, ils sont forcément nombreux, ou bien en prose. Ce qui participe beaucoup à la beauté singulière de ce nikki hors-normes.
Mais il y a d’autres aspects à mettre en avant – notamment le goût de l’autrice pour les livres, et au premier chef pour Le Dit du Genji de Murasaki Shikibu, dont on lira le journal juste après. Au fil de ma lecture, ponctuée de bêtises sur les réseaux sociaux, j’en avais parlé, aha, comme d’une blogueuse littéraire dépressive du XIe siècle. Et je maintiens (bêtement) qu’il y a de ça, oui. Mais on peut, je suppose, trouver des moyens un chouia plus élégants de le signifier : l’autrice du Journal de Sarashina constitue en effet un beau cas de bovarysme, huit siècles avant notre Emma adorée. Elle lit beaucoup, les livres sont sa passion – elle se plaint originellement de ne pouvoir lire le Genji monogatari que dans le désordre, avec les chapitres qu’elle trouve, et explique que son plus grand désir serait de lire ce roman en entier et dans l’ordre (elle lit beaucoup d’autres choses aussi, bien sûr, et s'en fait ici l'écho). Mais elle en dérive un fantasme : vivre des amours aussi fortes et belles que celles du Prince Radieux !
Ce qui ne devait bien sûr pas être… La vie de l’autrice s’avère terne, triste, morne – déprimante. Elle s’ennuie à la cour (elle n’est certes pas la seule, cela revient régulièrement dans les nikki, dont les deux autres de ce recueil), elle s’ennuie en province ; son époux n’est pas un mauvais bougre, mais il n’est certainement pas le Genji… Oui, il y a comme une profonde dépression dans ces pages – qui ne les rend que plus touchantes, poignantes même ; d’autant que la sensibilité poétique de l’autrice, et notamment donc sa sensibilité à l’égard des beautés de la nature, accompagne avec grâce ce propos, pour en exprimer une beauté propre d'un autre ordre. L’autrice du Journal de Sarashina n’a certes pas vécu les amours décrites par Murasaki Shikibu dans son fameux roman, mais elle a extrait de sa vie bien morne des pages d’une impressionnante beauté.
Oui, de ces trois nikki, c’est de très loin celui que j’ai préféré – et il me faudra sans doute le relire dans une traduction plus rigoureuse…
JOURNAL DE MURASAKI SHIKIBU
Mais suit justement le Journal de Murasaki Shikibu – où l’autrice du Dit du Genji (dont on ne sait guère plus, son véritable nom inclus) se livre à l’exercice du nikki, à sa manière ; mais la structure étrange de ce journal, datant probablement de 1008-1010, ou rapportant en tout cas des événements de cette époque (mais, encore une fois, ces « journaux » sont régulièrement écrits a posteriori), a pu laisser supposer qu’il ne nous était pas parvenu dans son intégralité.
En l’état, le journal est composé de trois parties distinctes. La première, et de très loin la plus longue, rapporte avec un grand luxe de détails la naissance du fils aîné de Shôshi, l’impératrice dont Murasaki Shikibu était dame de compagnie. Le tableau très précis et coloré peut sans doute rappeler certains passages du Genji monogatari, mais, en l’espèce, cela m’a surtout évoqué certains passages similaires chez Sei Shônagon, dans ses Notes de chevet.
Sei Shônagon… La Rivale ! Or la deuxième partie de ce journal, qui arrive assez brusquement mais en constitue à mon sens le passage le plus intéressant, consiste en impressions sur la vie à la cour, et tout particulièrement sur les autres dames de compagnie – si Murasaki Shikibu ne ménage pas exactement les courtisans sans manières et qui se croient tout permis. Mais l’autrice ne mâche donc pas ses mots à l’encontre des autres dames – et tout particulièrement celles qui se piquent d'écrire, telles Sei Shônagon (au service de la précédente impératrice, qui, comme Shôshi, tenait à s’entourer des plus beaux esprits) ou Izumi Shikibu ! Peut-être s’agit-il de sa part de répondre à des torts causés par ces dames ? Mais laissons-la s’exprimer (pp. 140-141) :
La dame Izumi Shikibu correspond d’une façon charmante, mais sa conduite est en vérité inconvenante. Elle écrit avec grâce, facilité et un esprit scintillant. Il y a de la saveur dans ses plus petits mots. Les poèmes sont attrayants, mais ce ne sont que des improvisations qui tombent spontanément de ses lèvres. Chacun possède un point intéressant ; elle est également au courant de la littérature ancienne, mais elle n’est pas une artiste remplie du véritable esprit de la poésie. Je crois que même elle ne peut se permettre de porter un jugement sur les poèmes des autres !
[…]
La dame Sei Shonagon est une personne très orgueilleuse. Elle a une haute opinion de sa valeur et répand partout ses écrits chinois. Pourtant, si nous l’étudiions de près, nous trouverions qu’elle est encore imparfaite. Elle s’efforce d’être exceptionnelle, mais, naturellement, les personnes de ce genre vous offensent et finissent par s’attirer des déboires. Celle qui est trop richement douée, qui s’abandonne trop à l’émotion, alors même qu’elle devrait faire preuve de réserve, perdra, malgré elle, le contrôle d’elle-même. Comment une personne aussi vaniteuse et aussi insouciante pourra-t-elle finir ses jours dans le bonheur ?
J’avouerais que, en ce qui concerne Sei Shônagon, qu’elle eût été orgueilleuse me paraît assez crédible au regard de certains passages de ses Notes de chevet – si brillantes par ailleurs…
Alors, ça bitche dans le gynécée ? Peut-être bien… mais sans doute y avait-il de très bonnes raisons à cela. Car le faste, les couleurs, le raffinement, le protocole, n’y changent rien : Murasaki Shikibu, comme après elle sa fan l’autrice du Journal de Sarashina, s’ennuie profondément. Et cela ressort tout particulièrement de cette partie du nikki, qui a même parfois quelque chose de désespéré – que la proximité des puissants et la grâce des jeux littéraires ne parviennent pas à contrebalancer. C’est dans ces pages, tout particulièrement, que la personnalité de l’autrice s’exprime ; laissons-lui à nouveau la parole :
Je sympathise avec ceux qui, en apparence, n'ont d'autre pensée que de se divertir, mais qui, en vérité, cherchent leur subsistance dans une grande inquiétude.
On ne saurait mieux dire – et je crois que la rivale Sei Shônagon aurait pu, elle aussi, coucher ces mots sur le papier ; ils n’auraient finalement pas dépareillé dans les Notes de chevet.
Après quoi, dans une troisième partie bien plus brève et assez chaotique, Murasaki Shikibu livre des anecdotes de cour, qui reviennent à la manière et au sujet de la première partie. Cependant, je crois que c’est davantage à fleur de peau, la méticulosité des descriptions relevant cette fois bien davantage, dans la continuité de la deuxième partie peut-être, de l’acuité des portraits psychologiques – un des principaux atouts du grand-œuvre de Murasaki Shikibu qu’est Le Dit du Genji.
Il y a de très belles pages dans ce nikki – mais j’y ai bien davantage préféré le Journal de Sarashina, où la dimension intime court tout du long.
JOURNAL D’IZUMI SHIKIBU
Reste un troisième et dernier fameux nikki : celui d’Izumi Shikibu (là encore un nom de plume à défaut du vrai nom de l’autrice, inconnu), poète appréciée à la cour, et exacte contemporaine de Murasaki Shikibu – qui, on l’a vu, ne la prisait pas forcément…
Mais en est-elle bien l’autrice ? Cela a pu être contesté – de même à vrai dire que la qualification de nikki pour ce texte, qui, formellement, détonne notamment par son emploi de la troisième personne ; sans doute nous narre-t-il un moment de la vie d’Izumi Shikibu, mais sans jamais la nommer : elle est « une femme », sans autre précision. La forte unité de registre de ce « journal » tranche aussi avec les autres exemples de ce genre littéraire ; à vrai dire, on serait parfois tenté d’y voir un (court) roman plutôt qu’un journal « à proprement parler » (ce qui, nous l’avons dit, était de toute façon, parfois, une notion toute relative, ces « journaux » étant en fait souvent des « mémoires ») ; d’ailleurs, le texte a également été cité, dans de très vieux ouvrages, sous le titre peut-être plus juste d’Izumi Shikibu monogatari. Cependant, il abonde en poèmes (bien plus que les deux autres figurant dans ce recueil), qui, eux, seraient bien les œuvres d’Izumi Shikibu ; peut-être de la même manière qu’en ce qui concerne Ariwara no Narihira dans les Contes d’Ise ? Je serais bien en peine d’en dire plus, sans même parler d’exprimer une opinion dans ce débat…
Si le Journal de Sarashina couvrait quarante années de la vie de son autrice, à grands renforts d’ellipses, et si le Journal de Murasaki Shikibu, sans doute incomplet, se dispersait dans la forme comme dans le fond, le Journal d’Izumi Shikibu, quant à lui, narre une seule histoire, sur une période assez courte, entre l’été de 1003 et le printemps de 1004 (ce qui, chronologiquement, en fait le plus « ancien » de ces trois nikki, en tout cas au regard des événements qu’il rapporte ; mais il aurait été composé vers 1004, justement, ce qui en ferait donc également le plus ancien nikki de ce volume, en termes de composition cette fois).
Et il s’agit, comme de juste, d’une histoire d’amour… Izumi Shikibu avait vécu une relation marquante avec le prince Tametaka, fils de l’empereur Reizi ; mais, après la mort de cet amant en 1002, elle est courtisée par un autre prince, Atsumichi, fils du même empereur – et c’est cette relation que décrit le Journal d’Izumi Shikibu, des premières lettres à l’installation de l’autrice dans le palais d’Atsumichi, suscitant le scandale et le départ de son épouse légitime. Inconvenante, hein ?
Cette romance exprime la sève même de la galanterie de Heian – toutefois sur un mode plutôt douloureux qui, je dois l’avouer, m’a bien moins parlé que les Contes d’Ise autrement frivoles et badins… Mais les deux amants, ici, vivent essentiellement leur amour au travers d’innombrables lettres, construites autour d’innombrables poèmes – il y a en des dizaines de compilés ici, tantôt dus à Izumi Shikibu, tantôt à Atsumichi (en théorie du moins). C’est l’époque de Heian : tout est propice à la composition de poèmes, et si possible sur le pouce, des valets s’épuisant à faire l’aller-retour entre les demeures des amants pour y livrer des tanka de circonstance, exigeant réponse. Mais cet amour se veut triste – selon les usages du temps, où on ne célèbre pas tant l’être aimé que l’on déplore son absence. Autant dire qu’ « elles étaient trempées, les manches de ce bras ployé ». Par les pleurs des amants, veux-je dire.
Et je dois confesser que j’ai vite perdu le goût à ce déploiement très contraint, codifié et répétitif de verve poétique amoureuse. Encore une fois, le ton plus léger des Contes d’Ise, bien antérieurs, dans le registre de la galanterie, m’avait bien davantage séduit. Ici, la répétition des situations et des images poétiques m’a assez rapidement plongé dans un ennui qui, sans égaler celui de l’autrice du Journal de Sarashina ou de Murasaki Shikibu dans son propre nikki, m’a tout de même gâché la lecture. Tout juste si la cruauté ou la mesquinerie dont peuvent parfois faire preuve les amants a ranimé ponctuellement mon intérêt – ce que le thème classique et pourtant touchant de « l’impermanence » des choses de ce monde, et du caractère éphémère de la beauté, n’est cette fois pas parvenu à faire
Maintenant, je suppose que la traduction, ici, a pu jouer un rôle néfaste – même en relevant que j’avais déjà lu ce texte, ou partie de ce texte, dans une traduction du japonais par Ryôji Nakamura et René de Ceccatty, figurant dans leur très bonne anthologie Mille ans de littérature japonaise, pour un effet assez similaire cela dit. Cela tient au rôle central de la poésie dans ce « journal » par ailleurs très romanesque ; or Marc Logé, ou ses sources anglaises, manquent de précision et de méthode dans la traduction de ces tanka – ce qui ressort notamment, je suppose, de cette variation dans le nombre de vers, souvent deux, parfois trois, exceptionnellement quatre ou même cinq (pourtant le format « canonique » pour la traduction de ces poèmes japonais de rythme 5-7-5, 7-7, mais nous parlons ici d’une double traduction dans les années 1920, où ces règles n’étaient peut-être pas encore de mise ; par ailleurs, ces règles sont toutes relatives, puisque, dans l’anthologie citée, les traducteurs ont sauf erreur fait le choix du distique d’alexandrins… Du moins s’en sont-ils tenus à ce format). C’est sans doute là que réside la subtilité du texte – ce qui ne passe pas très bien en français, du moins sous cette forme. Mais la poésie est certes ce qu’il y a de plus difficile à traduire…
Cependant, je ne peux que songer à la critique formulée par Murasaki Shikibu, citée plus haut, et, du haut de ma pathétique ignorance, elle me paraît assez juste ; j'entends la critique poétique, pas celle portant sur « l'inconvenance » de la rivale, qui s'explique mieux après la lecture de ce récit... Mais oui : que ce soit dans l’improvisation en mode automatique, ou dans la pratique érudite de la référence à la poésie ancienne, ces poèmes, qui se veulent très subtils, m’ont souvent paru faux – ce qui tient évidemment à mon ignorance, donc, de cette histoire poétique ; au fond, je « reproche » ici à Izumi Shikibu ce que j’ai pu « reprocher » à Fujiwara no Teika et plus encore à ses admirations dans De cent poètes un poème (en relevant d’ailleurs qu’Izumi Shikibu fait partie de ces cent poètes choisis).
HONNEUR AUX DAMES
De ces trois « journaux », donc, celui d’Izumi Shikibu est de très loin celui qui m’a le moins parlé, et celui de Sarashina de très loin celui que j’ai trouvé le plus touchant ; le Journal de Murasaki Shikibu est diversement situé entre ces deux termes, plutôt du côté positif cela dit.
Cela dit, de manière générale, le voyage en vaut la peine. Ces trois textes, finalement très différents au-delà de leur étiquette commune, nous plongent dans le lointain Japon de Heian, nous immergent même dans ce monde si différent du nôtre – et probablement tout autant du Japon contemporain, à vrai dire. L’élégance de la plume, ou du pinceau, y fait des merveilles – les sentiments à vif, dans cette écriture de l’intime, de même, le plus souvent. Finalement, je suis tenté d’y retrouver l’effet que j’avais signalé en chroniquant les Notes de chevet de Sei Shônagon : ces autrices, si subtiles, nous paraissent étonnamment proches, par-delà les siècles, par-delà les kilomètres ; sans doute est-ce qu’elles brillent par leur humanité autant que par leur raffinement. La tristesse, la douleur, l’ennui sont palpables, notamment – et, finalement, c’est peut-être surtout cela que j’en retiens avant tout : avant le faste, avant le protocole.
Une belle lecture, donc – mais il me faudra peut-être y revenir au travers de traductions plus précises, plus rigoureuses ; auquel cas la relecture du Journal de Sarashina sera sans doute une priorité.