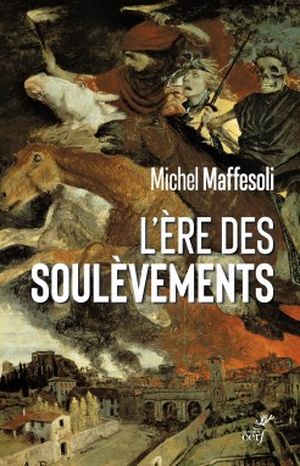Difficile de résumer en peu de mots la thèse centrale de Michel Maffesoli, au premier abord extrêmement déroutante tant elle ignore les clivages usuels pour proposer une tierce lecture de notre époque. Pour Michel Maffesoli, la modernité a symboliquement pris fin en mai 68 (un film comme Les Valseuses l'illustre très bien je trouve) : nous sommes entrés dans ce que nous appelons, faute de mieux, la post-modernité. Si la modernité s'est caractérisée essentiellement par une hypertrophie de la rationalité, la post-modernité, elle, voit le retour en force d'autres aspects de l'existence jusque là marginalisés comme l' « émotionnel » (un néologisme récent, paraît-il), le sensible, le spirituel, le festif, la sexualité, le goût pour les communions collectives et, en même temps, un rapport plus immédiat à soi, à ses goûts, ses émotions et ses sensibilités. Toutes choses qui, le rappelle Maffesoli, étaient au cœur de l'existence sociale dans les mondes anciens, et souvent encadrées par des coutumes ou des institutions (officielles ou non). En somme, en une définition abrupte, la post-modernité est ainsi « la synergie de l'archaïque et de la technologie. » Ce site en est d'ailleurs, à bien des égards, une belle illustration ! Les réactionnaires peuvent donc se rassurer. Et c'est là l'aspect déroutant de la pensée de Maffesoli : de voir, du point de vue d'un antimoderne (puisqu'il l'est bien évidemment), quelque chose de positif aux mutations en cours, que l'on est souvent porté à considérer avec mépris et inquiétude comme, précisément, signes d'un déclin de la raison. Encore, précise l'auteur, rationalisme et rationalité ne sont-elles pas la même chose (le rationalisme aboutit même souvent à des conséquences on ne peut moins sensées).
Dans cet essai paru en mai dernier (2021), Maffesoli interprète les crispations politiques et sociales en cours ou récentes, notamment autour de le gestion de la crise épidémique, à l'aune d'une polarisation entre un progressisme conservateur voulant sauver coûte que coûte un monde moderne en déshérence (c'est le camp des élites) et une post-modernité aux contours flous qui rompt de plus en plus avec les idéaux passés (le scientisme, le progressisme, les grandes utopies politiques), revendiquant ou cherchant de nouvelles façons d'exister. Il s'agit, d'après le mot de Maffesoli, jouant sur l'étymologie, de « remettre de l'humus dans l'humain », c'est-à-dire cet enracinement des sens, des impressions, des sentiments et des inspirations, au cœur du sujet humain, et dans son cœur propre, et non plus dans l'expropriation des systèmes objectivistes œuvrant à l'arraisonnement du monde. On peut dire en tout cas que les derniers épisodes de la comédie covidienne ne font qu'accréditer les intuitions de Maffesoli et lui donnent, même, un surplus de profondeur. Le contrôle de la société, des « masses », par l'ingénierie étatico-scientifique (c'est-à-dire par la Raison) n'était-il pas au centre de l'idéal moderne ?
Michel Maffesoli, d'une extrême cohérence intellectuelle, se qualifie quant à lui de libertaire, cite côte à côte Joseph de Maistre et Guy Debord, affirme « sourire à la vie » (ce qu'il répondait à un professeur de bonne vertu essayant de lui faire la morale à la télé) et fait état d'une compréhension intime de la pensée de Heidegger, dont on retrouve l'écho dans la moindre de ses analyses et, in fine, jusque dans la description qu'il fait de la réalité sociale actuelle. « Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve. » La méditation que Heidegger avait tiré de cette sentence de Hölderlin se vérifie en ce moment-même. Est-il venu, cet élan du cœur que le romantique a cherché en vain, dans la froideur de son époque, à l'aube de la modernité qui prend fin ?
Un petit essai dont on pourra éventuellement reprocher le style trop léger et les innombrables coquilles mais qui délivre une incroyable clarté sur notre époque. Plus encore : qui invite à reconsidérer son propre positionnement vis-à-vis de celle-ci.