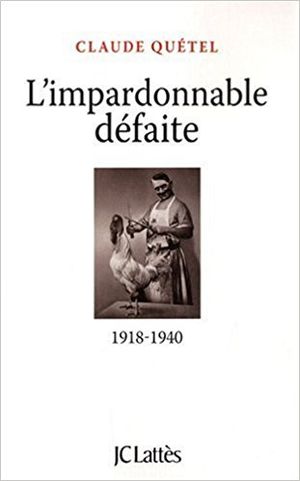En 1932, Carl Schmitt prophétisait qu'une société refusant à tout prix de faire la guerre était condamnée à perdre sa liberté. Huit ans plus tard, la théorie trouva malheureusement confirmation, comme le montre admirablement bien Claude Quétel.
L'historien privilégie le récit chronologique : partant de la fin de la Grande Guerre, il décrit progressivement les causes du drame qui se profile de plus en plus nettement, qui apparaît de plus en plus inéluctable. Pourtant, jusqu'au bout, jusqu'au 16 juin 1940, à la veille du misérable discours de Pétain, le pire paraît pouvoir être évité. Mais, jusqu'au bout aussi, les mauvaises décisions ou, plus précisément, l'absence de décisions, auront conduit la France au désastre. Qui sont les coupables ? Et qu'est-ce qui a motivé leurs choix ?
Le portrait que dresse Claude Quétel de la France des années 1920-1930 et de ses principaux acteurs politiques est proprement féroce, pour ne pas dire cruel. C'est une société qui apparaît épuisée, fatiguée, lasse... lasse d'elle-même, lasse de la vie, lasse de sa propre puissance. L'on s'est bercé d'illusions en expliquant que les Français étaient massacrés dans les tranchées pour qu'on puisse abolir la guerre à tout jamais : la « Der des der », on y a vraiment cru ! Mais la paix fut signée trop tôt, alors que l'Allemagne n'était pas encore vraiment vaincue ; son sol n'a même pas été touché. Foch aura insisté en vain pour imposer des conditions rudes à l'Allemagne, devant empêcher le retour de la guerre. Mais comprenez qu'en 1918, proposer la création d'un État-tampon, tout à fait virtuel, façon Belgique, ça faisait un peu réac !
Pourtant, la formulation de l'article du traité de Versailles imposant des réparations à l'Allemagne, plus que le principe de réparations en lui-même, devait enraciner un ressentiment tenace chez les Allemands : leur nation y est rendue responsable de la guerre, et donc jugée en tant que tel comme un criminel. Voilà qui est un peu plus moderne ! Carl Schmitt ne s'y trompait pas non plus : pour lui, le traité de Versailles entérinait une grave subversion du droit international, délimitant une guerre juste d'une guerre injuste, où l'ennemi n'est plus un simple adversaire mais un criminel à éliminer à tout prix.
La France sera vite considérée comme « militariste » par ses anciens alliés, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui auront tôt fait de l'abandonner. Que peuvent bien importer les inquiétudes d'un Foch quand on peut suivre l'irénisme naïf d'un Wilson ? Immédiatement après sa signature, le traité de Versailles, jugé trop sévère par les Anglo-saxons, sera disqualifié et son application peu rigoureuse. La république de Weimar aura su jouer du sentiment de culpabilité des Alliés et du rôle de victime attribué à l'Allemagne pour, petit à petit, réviser les termes du traité à son avantage. C'est que, dès 1918, il était clair pour les Allemands que la guerre avec la France allait reprendre, qu'elle devait reprendre ; après tout, ils n'ont pas réellement été vaincus en 1918... Aussi, le ré-armement de l'Allemagne, comme le montre Claude Quétel, a commencé bien avant l'avènement de Hitler.
Or, face à l'évidence, les Anglais et les Américains restent butés dans leur idéalisme naïf. Ce qui les inquiètent alors, ce n'est pas cette pauvre Allemagne, mais une France jugée impérialiste et belliqueuse ! Difficile alors, pour la France, d'imposer ses vues sur la scène internationale, embêtée en plus par une SDN aussi aveugle qu'inutile (ce « machin »). Mais les dirigeants français ont-ils eux-mêmes réellement pris la mesure du danger ?
L'entre-deux-guerres, c'est l'âge d'or de l'instabilité parlementaire. Les gouvernements se succèdent et les hommes politiques sont trop absorbés par la politique politicienne pour s'intéresser sérieusement aux questions internationales. De toutes façons, l'opinion publique est profondément hostile à la guerre. Pourquoi vouloir la décevoir ?
Un type comme Giono, grand écrivain paraît-il (qu'il faudrait que je lise un jour !), n'avait pas honte d'affirmer qu'il préférait « être vivant Allemand que Français mort ! » De méchants esprits auront fait remarquer, qu'enfin, même si on se laissait envahir par les Allemands pour éviter la guerre, ceux-ci finiraient bien par imposer aux Français de combattre pour leur propre compte ! Mais pourquoi écouter ces méchants esprits, de toutes façons, bien peu nombreux ?
C'est que, de gauche à droite, tout le monde, ou presque, est acquis au pacifisme. Bien sûr, les communistes, pilotés par Moscou, sont toujours à côté de la plaque ; mais l'attitude la plus honteuse demeure celle de l'extrême droite, tellement persuadée qu'une révolution bolchévique est sur le point d'éclater en France que quelques uns de ses partisans auront préféré une défaite face à Hitler pour qu'il ait ensuite les mains libres pour éradiquer le communisme à l'est. Bien sûr, cette crainte a été accentuée par la victoire du Front populaire en 1936, elle-même devant beaucoup à la peur montée de toutes pièces d'un fascisme rampant qui n'existait pas en France (il y a, effectivement, des ressemblances entre les années trente et notre époque !)
Front populaire qui arrive d'ailleurs au mauvais moment, pour mener une politique en parfaite contradiction avec le contexte du moment. À trois ans de la guerre, l'on met en place des mesures sociales néfastes pour la productivité et les finances ; pourtant, le Front populaire a bien été forcé de relancer le réarmement du pays...
Il était temps ! L'armée a une sale gueule. Il faut dire que son image, en raison du pacifisme ambiant, s'est nettement dégradée. Conséquence : 1° faire carrière dans l'armée n'intéresse plus personne, il y a donc un déficit problématique d'officiers ; 2° les réservistes n'ont pas été appelés depuis la dernière guerre ; 3° les crédits de l'armée sont réduits au minimum ; 4°il n'y a plus (ou presque plus) d'effort dans le développement de l'armement. En 1939, le retard avec l'armée allemande, qui, elle, a été de longue date préparée pour la revanche, est conséquent. Bien sûr, les chars français, dont certains sont invulnérables face aux armes allemandes (le B1 bis notamment), font beaucoup parler d'eux. Encore aurait-il fallu qu'ils soient conçus intelligemment ! Les communications, surtout, sont moyenâgeuses, aucun effort n'a été fait pour développer la radio ; là où chaque char allemand possède la sienne, les tankistes français communiquent entre eux en agitant des drapeaux... La mitrailleuse en dotation, complètement obsolète, date de la guerre précédente (cela dit, les Italiens ont réussi à faire pire avec leur Breda et son système de rechargement inutilement compliqué). Le pire reste l'aviation, dont le retard est considérable, et la défense anti-aérienne, à peu près inexistante...
Bien sûr, tout ça irait encore si la doctrine militaire n'était pas complètement dépassée ; l'armée française était alors frappée d'un terrible mal : un conservatisme obstiné et dogmatique... Naturellement, l'obsession défensive devait répondre au pacifisme ambiant : développer une armée d'attaque aurait été considérée comme une volonté évidente d'agression. Il fallait tranquilliser les esprits : caché à l'abri d'un bunker, le soldat de demain tuera sans se faire tuer.
C'est que l'effroyable guerre précédente avait fait craindre, on peut le comprendre, une nouvelle boucherie. Toute la culture d'alors baigne dans la description horrifique des cadavres empilés, des gueules cassées, des plaies béantes. C'est une certitude, il n'y a rien de glorieux dans la guerre, la guerre est juste horrible. Même le 11 novembre n'était plus la fête de la victoire mais la fête des martyrs sacrifiés au champ de bataille. Toute manifestation de patriotisme était mal perçue.
Dans les esprits, le pacifisme a eu des effets désastreux. Les Français n'étaient psychologiquement pas prêts pour la guerre. Toutes les tentatives diplomatiques, jusqu'en 1939, consistaient à éviter la guerre à tout prix, à la repousser plus loin. Pourtant, les casus belli pouvant — devant — entraîner une intervention militaire en Allemagne alors que le pays était encore sans défense ont été nombreux. Mais non, sur le plan diplomatique, toutes les dérobades, toutes les reculades, toutes les lâches concessions ont été applaudies avec force par les populations. Ironie délicieuse : nombre des personnages publics qui, par leur passivité et leur lâcheté, ont entraîné la guerre, ont été décoré du... prix Nobel pour la paix.
Jusqu'à Munich, on a reculé et laissé faire Hitler. L'illustration sur la couverture du livre est une caricature illustrant bien la situation : elle est légendée « n'ayez pas peur, il est végétarien. » Comme le démontre une autre étude publiée récemment, les gens à l'époque ne comprenaient pas ce qu'était le nazisme. Personne n'a lu Mein Kampf et on arrivait à se convaincre que, tout compte fait, Hitler devait sincèrement être un partisan de la paix. La peur de la guerre, il a très bien su en jouer le Adolf, pour aller toujours plus loin dans la provocation.
Jusqu'en 1939, toute personne osant critiquer l'attitude de laisser-faire vis-à-vis de Hitler était qualifiée de « belliciste. » Jusqu'en juin 1940, toute personne voulant opter pour une stratégie agressive ou poursuivre le combat jusqu'au bout recevait le même qualificatif. Quand Hitler a attaqué la Pologne, on écrivait encore : « ne mourrons pas pour les Poldèves ! » (pour ceux qui se demandent, ce peuple n'existe pas) La drôle de guerre, ce non-sens stratégique, répondait encore à la même logique de repousser à plus loin encore l'affrontement... On a lâchement abandonné les Polonais à leur triste sort, mais ça n'a pas ému grand monde. Pourtant, la drôle de guerre a eu un effet psychologique catastrophique sur des Français déboussolés, qui ne comprenaient pas vraiment ce qu'il se passait. Les soldats qui ont été mobilisés mais qui passaient leurs journées à ne strictement rien faire, pas même des exercices, déprimaient littéralement. Tout paraissait absurde. Les gens, d'ailleurs, n'ont vraiment pris conscience qu'ils étaient en guerre que lorsque les Allemands étaient dans leur village !
D'ailleurs, rien a été fait pour mettre en place une authentique société de guerre. La conversion à une économie de guerre a été longue et difficile. La gauche ne voulait pas faire de concession sur les conditions de travail. Un constructeur aussi important que Renault, pacifiste convaincu en bon libéral, refusait d'attribuer plus d'une usine à la production militaire ; la fabrication de chars (le fameux B1 bis) prenait un retard considérable... C'est que le traître préférait concentrer ses efforts sur la nouvelle voiture révolutionnaire de l'après-guerre. Bien sûr, pas d'union nationale, les partis continuaient leur guerre et le Parlement continuait à imposer ses vues même à l'armée. C'est tout juste si on censurait les propos défaitistes, démoralisateurs.
Passionnant, à ce titre, est le récit des quelques semaines de guerre, entre le 10 mai et le 22 juin, dans l'intimité du gouvernement. Profondément divisé, aucune décision ne parvenait à être prise, ou à être prise sérieusement. À la tête de l'armée, Gamelin restait enfermé dans le château de Vincennes, communiquait peu avec l'Air et la Marine, et encore moins avec les Britanniques. Des officiers mal formés (ou pas formés du tout) transmettaient des rapports-fleuve, pensant bien faire, qui submergeaient l'État-major d'informations inutiles ; la guerre devenait opaque... Et aucune initiative n'a été prise, pas même lorsqu'on savait qu'une importante force blindée se dirigeait à travers les Ardennes vers Sedan.
Alors que la guerre tournait sérieusement au vinaigre, l'idée d'exiler le gouvernement en Afrique du Nord et de poursuivre la guerre depuis les colonies en attendant une intervention américaine germait. Reynaud, devenu chef du gouvernement car considéré plus dur que Daladier, y était favorable, appuyé par une partie de ses pairs et, bien sûr, le général de Gaulle. Le général Weygand et le maréchal Pétain, invité au gouvernement pour tenter de rassurer les Français, avaient un tout autre avis. « Je n'abandonnerai pas la France ! — Très bien. Il y a trois départements en Algérie, c'est que ça doit être la France. — Ce n'est pas pareil ! » Reynaud, incapable de prendre une décision, laissa donc faire les deux compères et c'est presque par hasard que Pétain en est venu à faire sa fameuse déclaration, absurde, de cesser les combats... alors que l'armistice n'avait pas été signée. En fait, Pétain comme Weygand voulaient la défaite : elle aurait permis de rebâtir une France comme ils la voulaient ; la défaite était la juste punition pour la gueuse, qui avait perverti les valeurs françaises... Mais ce que n'avait pas compris Pétain, c'est que Hitler n'accorderait pas une paix comme celle de 1871. La France ne s'en tirerait pas avec quelques provinces ! Peu nombreux, en fait, étaient ceux qui avaient compris que Hitler menait une guerre d'extermination, d'anéantissement de l'ennemi.
Le bilan de cette période est affligeant. En même temps, il y a quelque chose de fascinant dans cet affreux récit du suicide d'une société... Assurément, le livre de Claude Quétel fait beaucoup réfléchir, d'autant plus que les travers de l'époque sont toujours vrais aujourd'hui. On peut y trouver une belle leçon d'humilité et de réalisme. Le récit en lui-même est captivant, le style génial. C'est agréable de voir un historien oser prendre des positions aussi tranchées. Finalement, même sur le plan du savoir, c'est loin d'être néfaste.
Voilà donc la seule chose qui attend les sociétés obstinées à se bercer d'illusions et refusant toute forme d'autorité, de réel pouvoir : des désastres.
Sur Carl Schmitt, je recommande l'excellente critique de -Piero-.