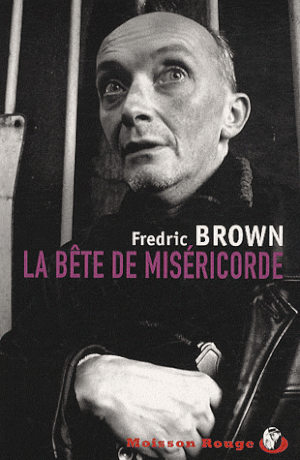Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2017/08/la-bete-de-misericorde-de-fredric-brown.html
BROWN (Fredric), La Bête de miséricorde, [The Lenient Beast], traduit [et préfacé] de l’anglais (États-Unis) par Emmanuel Pailler, Paris, Moisson rouge/Alvik – Points, coll. Roman noir, [1956, 2010] 2011, 217 p.
(Attention : à terme, ce compte rendu est bourré de SPOILERS, je vous préviendrai le moment venu...)
NOIRE GUEULE DE BOIS
Finalement, je crois que mes quelques allers-retours en train durant l’été et plus si affinités s’accommoderont bien mieux de quelques chouettes polars çà et là que de la relecture de la au mieux médiocre « Légende de Hawkmoon » (la quatrième de couverture du Dieu fou m’a beaucoup trop effrayé pour cela – non que celle du roman qui va nous intéresser aujourd’hui soit forcément bien meilleure, elle contient des erreurs étranges...). Dans ce genre que je connais fort mal, voire pas du tout, j’ai évidemment plein de choses à lire, dont quelques titres empilés au fil des ans dans ma bibliothèque de chevet et qui y ont pris la poussière depuis, c’est scandaleux.
Aujourd’hui, Fredric Brown – un maître, à n’en pas douter. Je l’avais découvert avec ses œuvres de science-fiction, d’abord les romans Martiens Go Home ! et L’Univers en folie, puis ses excellents recueils de nouvelles en Folio-SF (j’avais, il y a fort longtemps, évoqué sur ce blog Fantômes et farfafouilles, Lune de miel en enfer et Une étoile m’a dit), car, c’est notoire, l’auteur a tout particulièrement excellé dans la forme courte, et même, le cas échéant, vraiment très très courte : il figure à n’en pas douter au pinacle des auteurs de short short.
Mais Fredric Brown n’a certes pas œuvré que dans la science-fiction, ayant régulièrement livré des polars de très bonne facture. Une dimension de l’auteur que je n’ai découverte que plus tard, quand le roman déjanté Rouge gueule de bois, de Léo Henry, m’a incité à lire La Fille de nulle part, que j’avais beaucoup aimé (et qui est très lié, ai-je l’impression, à La Bête de miséricorde, dont je vais vous parler aujourd’hui), et j’ai également lu, un peu plus tard, La Nuit du Jabberwock, qui est bien un polar en dépit de son titre lewiscarrollien (pas gratuit pour autant), et qui m’avait parfaitement convaincu sur le moment, mais dont je n’avais guère conservé de souvenirs, je dois bien le reconnaître.
La Bête de miséricorde est un autre fameux titre de Fredric Brown dans le registre du roman noir. Une quatrième de couverture aguicheuse (mais en fait un brin douteuse…) m’avait incité à en faire l’acquisition, il y a fort longtemps de cela, mais ce n’est donc que maintenant que j’ai trouvé le temps de le lire. On notera pour la forme que le roman a été adapté au cinéma et « francisé » par Jean-Pierre Mocky en 2001, mais je n’ai aucune idée de ce que ça vaut (j’ai du mal avec le peu de Mocky que j’ai vus, j'avoue). Je m’en tiendrai donc ici à l’œuvre originale, publiée en anglais en 1956.
TRADUTTORE, TRADITORE
La Bête de miséricorde avait été traduit en français une première fois en 1967, par Jean-François Crochet, bizarrement (?) chez Dupuis, que nous connaissons plutôt comme éditeur de BD gravitant autour de Spirou, etc. Sous une couverture avec une accroche parfaitement racoleuse et improbable, au passage. Cette même traduction avait été reprise en 1980 chez NéO.
Mais on a appris à se méfier des traductions françaises un peu poussiéreuses dans le genre policier… Et à vrai dire au moins autant en SF, si l’on n’en parle pas ici. Il y a plusieurs « syndromes », souvent associés à la Série noire, mais en fait endémiques dans l'édition de genre alors : les coupes sèches par l’éditeur ou le traducteur lui-même, et parfois très conséquentes, les erreurs de compréhension en veux-tu en voilà, débouchant parfois sur des passages surréalistes, et autres soucis typiques du travail de traducteur quand il n’est pas exactement accompli dans les meilleures conditions, ou encore la « localisation » du style qui en rajoute dans le vieillissement (quand les policiers ricains, pardon, les inspecteurs divisionnaires ricains des années 1950 parlent tous comme des personnages d’Audiard, caves et grisbi à tous les étages), ce genre de choses.
Quand Moisson rouge a lancé le projet de rééditer La Bête de miséricorde, Emmanuel Pailler a donc compulsé parallèlement le roman original et la traduction française de 1967. Au premier abord, c’était semble-t-il bien mieux que ce que l’on pouvait craindre : pas de coupes drastiques, pas de confusions majeures, une langue fluide et propre… Sauf que, bizarrement, c’était peut-être un peu le problème : Emmanuel Pailler semble avoir rencontré une unité de ton guère à propos dans ce roman choral, et, plus généralement, une tendance à enjoliver le texte tout en aseptisant l’expression – ce qu’il suppose être le résultat des exigences d’un éditeur qui, via la BD et notamment Spirou, était habitué des contraintes particulières des publications destinées à la jeunesse. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser... Mais La Bête de miséricorde ne relève certainement pas de ces dernières : sans être ordurier, pas le moins du monde en fait, c’est un roman « dur », avec une thématique sociale marquée, qui envisage des sujets parfois rugueux (alcoolisme, racisme, violences conjugales…), avec des protagonistes adaptés et bien caractérisés – et les flics de l’Arizona en 1956 ne disaient probablement pas « Saperlipopette », même ceux d’ascendance mexicaine (aheum). Il y avait donc bien un travail de retraduction à effectuer, simplement d’un ordre différent de ce à quoi on pouvait s’attendre, afin de coller bien davantage au ton de l’original – ce qui fait partie du style de Brown, par ailleurs limpide et sans fioritures (probablement pas là où il brille le plus, mais du moins est-ce fonctionnel, et c'est bien l'essentiel).
La préface d’Emmanuel Pailler est très intéressante à cet égard – mais sa nouvelle traduction est-elle irréprochable ? C’est un terrain sur lequel je préfère ne pas m’aventurer, même si j’ai cru relever, çà et là, quelques bizarreries qui m’ont fait hausser le sourcil. Cela dit, je suppose que le ton est bien là – rugueux parfois, donc, pas édulcoré, mais connaissant des variations au fil de la succession des narrateurs : c’est un roman choral, à la première personne, chaque chapitre ayant son propre narrateur – sauf erreur, ils sont cinq à alterner ; et le rendu de leur personnalité est assez convaincant.
L’ART DU NOUVELLISTE DANS UN ROMAN
Je ne sais pas s’il serait finalement si pertinent que cela de dire que Fredric Brown était plus un nouvelliste qu’un romancier, même si on l’a souvent affirmé – je suis porté à le croire, mais, malgré un certain nombre de lectures tout de même, je ne me sens pas assez compétent pour en juger. Cependant, l’écrivain visiblement roublard a pu user dans ce roman de méthodes pouvant faire penser à son art de nouvelliste. Le premier chapitre en est à vrai dire une démonstration éloquente, presque une leçon.
Bien sûr, il y a tout d’abord ce goût de l’attaque en force. Le roman s’ouvre sur ces mots : « En fin de matinée, je trouvai un cadavre dans mon jardin. » Pas de chichis, c’est du direct… « Je », ici, c’est un certain John Medley, paisible retraité qui vit seul dans une maison tout ce qu’il y a de banal sise à Tucson, Arizona – ce quand bien même il touche de temps à autres quelques revenus issus de la spéculation immobilière. Le vieux bonhomme un peu excentrique, et grand amateur de musique classique, prévient alors la police, et deux inspecteurs se rendent sur place, Fern Cahan, un bonhomme pas très fin mais probablement bien plus que ce que l’on croit, et Frank Ramos, qui a le mauvais goût d’être tout à la fois flic, « érudit », et d’origine mexicaine – ce qui fait beaucoup trop pour un seul homme (demandez donc au capitaine Walter Pettijohn ce qu'il en pense).
Oui, c’est bien un cadavre… Pas de papiers, rien sur lui. Tué d’une balle dans la nuque. M. Medley n’a rien entendu ? Non… Même pas le bruit d’un pot d’échappement qui pétarade, ou ce qu'il aurait confondu comme tel ; mais c’est vrai qu’il écoute de la musique sur sa chaîne haute-fidélité, assez fort, et puis il y a ces avions à réaction qui volent bas – la base militaire est toute proche… Bien, ce sera tout pour le moment. Le temps d’embarquer le cadavre et de faire le tour du voisinage (relativement distant), et les deux policiers s’en vont.
Et c’est alors que John Medley confesse, au seul lecteur, à la première personne, à demi-mots et pourtant sans ambiguïté, qu’il est l’assassin – dans un ultime paragraphe, comme la chute d’une nouvelle, mais d’une manière étonnamment habile et plus qu’intrigante…
COMMENT ET POURQUOI
D’aucuns se sont plaint, semble-t-il, de ce que l’identité du coupable soit aussi rapidement dévoilée, mais ce n’est clairement pas le propos : s’il n’est pas du tout un whodunit, le roman de Fredric Brown est bien davantage un howdunit, et, peut-être surtout, un whydunit. Même avec un petit bémol, j’y reviendrai.
Ceci étant, seul le lecteur sait donc ce qu’il en est, à ce stade. Les policiers n’en ont pas idée – car Medley est un charmant petit vieux, peut-être un peu excentrique, oui, mais tout ce qu’il y a d’aimable, en tant que tel impossible à soupçonner… Pour Fern Cahan, ou pour le capitaine Walter Pettijohn, cela relève de l’évidence. Mais Frank Ramos est d’un autre avis. D’emblée, il trouve louche ce Medley – au point où sa suspicion se mue en obsession… Bah, rien d’étonnant à cela, sans doute, Ramos est un « intello » aux idées bizarres…
…
Bon, plaçons ici, à tout hasard, la balise SPOILERS – et il y en aura d’autres plus loin dans cette chronique, jusqu'à la fin, alors tenez-vous-le pour dit si jamais.
Ramos se trompe, donc, c’est obligé. D’ailleurs, voyez la victime – bientôt identifiée comme étant un certain Stiffler, qui ne s’était installé à Tucson que depuis quatre mois à peine. Un pauvre homme… En dépit de sa confession catholique, dans son Allemagne natale, les lois de Nuremberg le qualifiaient de juif, et il a passé dix longues années dans les camps de la mort – tu parles d’une enfance et d’une adolescence… Mais oui : la guerre, c’était il y a dix ans seulement. Depuis, il avait émigré au Mexique, où il s’était rapidement marié et avait eu des enfants ; les affaires ont bien tourné pendant un temps, beaucoup moins bien ensuite, alors il a nouveau émigré, aux États-Unis cette fois, à Tucson, Arizona, donc, au sein de la communauté... mexicaine, relativement importante, et trouvé sur place un emploi passablement de complaisance auprès d'un compatriote (c'est-à-dire un Allemand, cette fois) – c’est que la vie avait toujours été dure, pour le pauvre Stiffler… Et il n’en avait hélas pas fini : il y a très peu de temps, lors d’un accident de la route, il a perdu sa femme et ses enfants – lui seul a survécu, indemne, et d’autant plus rongé par le sentiment de sa responsabilité dans le drame. Depuis, lui qui n’était déjà guère liant, est devenu plus asocial encore – jusqu’à ce qu’on retrouve son cadavre dans le jardin de John Medley.
À tout prendre, voilà un homme qui avait toutes les raisons de mourir – de se suicider, disons-le. Mais ça ne peut pas être un suicide ! Une balle dans la nuque ? Avec quelques contorsions, ce n’est pas inenvisageable… Mais l’arme, alors ? On n’a pas retrouvé de pistolet à côté du cadavre… Mais il y a bien des moyens d’expliquer sa disparition, sans même se limiter aux seules inventions les plus saugrenues des auteurs de romans policiers (le revolver attaché à la patte d’un hibou que la détonation fait s’envoler, sérieux ?!). Oui, un suicide… Un suicide bizarre, mais un suicide…
Et c’est ici qu’intervient le « bémol » dont je parlais tout à l’heure concernant la qualification de whydunit. Je suppose qu’elle demeure valable, car l’appréhension du mobile dans toute sa complexité est une dimension essentielle du roman jusqu’à sa toute fin. Mais ne nous leurrons pas – ou plutôt, je vais tâcher de ne pas me leurrer : même si je suis très naïf et bon public, aussi ai-je joué le jeu de l’auteur en m’accordant au rythme soigneusement conçu de ses révélations, un lecteur moins naïf ou moins bon public dispose à ce moment-là de bien assez d’éléments pour piger le truc – depuis quelque temps, en fait. Voire depuis longtemps, voire depuis le tout début.
Mais est-ce un problème ? Non – parce que le roman, très habilement, dérive alors dans une autre direction…
UNE TRAGÉDIE EN FORME DE PIÈGE
Celle d’une tragédie en forme de piège inéluctable ! Et ce n’est plus alors, sur le mode classique de l’enquête policière, la résolution de l’énigme qui compte vraiment, absolument pas, mais bien plutôt la fatalité qui s’abat sur notre héros, Frank Ramos… L’intérêt du lecteur n’est plus entretenu via la surprise, le retournement de situation, etc., mais bien au contraire via l’expectation, l’anticipation morbide, inacceptable et pourtant inéluctable, du pire – on pourrait dire que l’on passe du policier au thriller, vu comme ça, et pourtant ça ne me paraît pas être une qualification très pertinente... « Roman noir » a suffisamment d’ambiguïtés et de connotations pour englober toutes les dimensions du roman. Le fait demeure : le lecteur qui se réjouissait de la lucidité de Ramos se met à anticiper la suite des événements… et à redouter le pire pour ce personnage auquel il s'était attaché, jusqu’à la fin, comme un horizon plus que menaçant ; tandis que la dimension de drame social s’accentue sans cesse, contribuant à bouleverser l’économie du roman sans pour autant nuire à sa cohérence – parce que c’est une belle mécanique que La Bête de miséricorde, conçue par un artisan madré.
En effet, nous savons depuis le premier chapitre que John Medley est l’assassin, mais, vers le milieu du roman au plus tard (pour qui n’aurait pas d’emblée pigé à la lecture du titre...), nous savons également pourquoi, du moins dans les grande lignes : Medley, qui tient (en privé seulement…) un discours d’essence religieuse éventuellement confus, se considère comme étant cette Bête de miséricorde – il croit que Dieu lui désigne des cibles, qui sont des individus dont la souffrance est telle qu’il vaut bien mieux pour elles mourir au plus tôt, mais qui, justement pour des raisons religieuses le cas échéant, ne prendront jamais eux-mêmes leur vie, car Dieu prohibe le suicide comme un abominable péché (et peut-être surtout pour les catholiques ? On le dit, alors que les protestants ne sont pas forcément en reste...). Les circonstances exactes du meurtre (ou de l’euthanasie, comme Medley voit les choses – à ceci près qu’il ne demande pas leur avis à ses victimes) restent encore à définir, mais le plus important est, à ce stade, acquis.
Le lecteur a sans doute un peu d’avance sur Frank Ramos – dont les soupçons dès le départ s’avéraient bien fondés, mais qui parvient d’autant moins à les asseoir solidement que tout le monde, dans son entourage, ne cesse de répéter qu’il se trompe, et que Medley est juste un gentil vieux bonhomme... La suspicion de Ramos est systématiquement dénoncée comme une obsession à deux doigts du harcèlement, au mieux – au pire, un délire d’ « intello », puisque tel est le deuxième stigmate du policier, après son ascendance mexicaine. Et c’est sans doute pourquoi, en dépit de ses soupçons, il est aveuglé un moment par des œillères – il faudra que sa femme alcoolique (qu'il ne comprend pas le moins du monde, j'y reviendrai) exprime à sa place, et comme en passant, l’idée d’un tueur agissant par compassion, pour qu’il ouvre enfin les yeux sur la nature exacte de sa proie (sinon celle de son mariage)… sans pour autant bien saisir qu’il est toujours un peu plus lui-même, eh bien, la proie de sa proie.
Cette avance dont bénéficie le lecteur est justement ce qui rend le roman de plus en plus horrible – car, quand nous en venons à comprendre sans plus l’ombre d’un doute pourquoi Medley tue, cela fait déjà un petit moment que nous voyons l’environnement de Frank Ramos se déliter, avec tous les signes d’un drame familial très proche, quand bien même banal, et qui pourrait très logiquement s’achever sur la conviction de Medley (et peut-être de Ramos lui-même, plus ou moins consciemment ?) que le policier « érudit », à l’instar de Stiffler, a atteint le stade où il souffre trop et où il vaudrait mieux pour lui mourir, ceci alors même qu’il ne saurait, pour quelque raison que ce soit, se tuer lui-même.
Et tout contribue à donner cette impression d’un piège qui se referme autour du héros du roman.
BOUTEILLE ET RESSENTIMENT
Frank Ramos est un homme qui, du fait de la teinte de sa peau, subit bien des discriminations et préjugés de la part de ses compatriotes à Tucson, Arizona, dans les années 1950 – mais ça, j’y reviendrai ensuite.
Ici, le problème essentiel concerne le couple Ramos. Frank a épousé Alice, il y a quelques années de cela. Ils ont sans doute été heureux ? En tout cas, ils ne le sont plus depuis longtemps. Alice a sombré dans l’alcoolisme, et méprise toujours un peu plus son époux. Elle a une liaison, avec un commerçant itinérant, un certain Clyde. Quand elle est lucide, elle n’attend qu’une chose : le courage de partir avec son amant loin de cette ville pourrie, et de ce mariage insupportable, la pire de ses erreurs. Mais elle n’est pas toujours lucide – elle fait quelques vagues efforts pour se contrôler, de temps en temps, mais au fond c’est en vain : elle boit, elle boit… Cercle vicieux.
Et Frank ? Frank ne se montre pas à la hauteur – c’est peu dire. Époux depuis longtemps guère attentif, et parfaitement aveugle à ce qui se passe au sein de son propre couple (tant pis pour le rusé inspecteur de police qui voit toujours juste dans ses enquêtes), il ne sait tout simplement pas gérer l’alcoolisme d’Alice. Ce qui ne le rend pas très sympathique, même si on peut toujours éprouver pour lui une certaine compassion. Car il ne semble intervenir dans l’addiction de son épouse qu’au motif d’une façade de respectabilité qu’il entend bien maintenir contre vents et marées : personne ne doit savoir ce qu’il en est – à part, bien sûr, le patron du bar le plus proche, pour lui c’est trop tard… Seuls la honte et l’embarras, à titre purement personnel, semblent motiver Frank. Il ne fait finalement rien pour comprendre la situation de sa femme, sa profonde douleur, le caractère insupportable de sa terne vie d’épouse délaissée et sans rien à faire, entre Madame Bovary et... Desperate Housewives, mais version Bergman, disons ; il ne sait rien d’elle, et de ses angoisses et de ses désirs – autant dire qu’il s’en moque. Il ne sort plus Alice depuis longtemps, il ne lui parle guère, pas même au petit-déjeuner – et il rentre tard tous les soirs : le travail… Un travail qui contribue à agacer Alice, car elle sait très bien, elle, qu’un flic latino ne pourra de toute façon jamais faire carrière – c’est déjà un miracle qu’il ait pu quitter l’uniforme… Ce manque d’ambition revient souvent dans ses récriminations ; sa frustration de ne pas pouvoir avoir d’enfants, aussi. Mais Frank ? Visiblement, il ne perçoit rien de tout cela. Et ça ne pourra pas durer éternellement.
Si nous le savons, c’est du fait de la structure chorale du roman. Outre John Medley, le coupable, trois autres des « voix » de La Bête de miséricorde sont policières : Frank Ramos, Fern Cahan, et leur capitaine Walter Pettijohn. Mais Alice endosse également ce rôle de narratrice – et c’est très significatif, car, avec elle, nous sommes on ne peut plus loin de l’enquête sur la mort de Stiffler : le roman adopte alors une dimension de drame social qui lui est au fond aussi essentielle que sa dimension proprement policière.
C’est qu’il ne s’agit pas d’une caractérisation à peu de frais, simplement censée donner de l’épaisseur au héros Frank Ramos, pour en faire autre chose qu’un simple assemblage de neurones bien connectés, avec pour extension un bras tenant un revolver. Non, nous sommes vraiment ici au cœur du roman : aussi habile soit-il dans ses procédés relevant du genre policier, il touche pourtant à quelque chose de profond et douloureux, d’un autre registre, qui saisit le lecteur aux tripes – et toujours un peu plus.
Et c’est ici, je crois, que l’on peut établir une parenté marquée avec au moins La Fille de nulle part (même si le nom de l’épouse de Frank peut, ou pas, renvoyer à La Nuit du Jabberwock ?) ; en effet, ce roman met en scène un couple alcoolique qui, du fait de la bouteille, mais en sachant qu’elle n’est peut-être (probablement...) à son tour qu’un symptôme, sombre dans la dépression et la misère, éventuellement le mépris et la haine – de soi et de l’autre. Fredric Brown, alcoolique notoire, a alors écrit des pages très fortes et très douloureuses sur son addiction, éventuellement reportée sur des personnages féminins, comme ici. La Bête de miséricorde se montre probablement moins explicite et cru que La Fille de nulle part à cet égard, mais c'est un roman au caractère dépressif marqué, dans cette dimension de drame social associé ouvertement à la thématique du suicide. C’est poignant, c’est terrible – et ça l’est sans doute d’autant plus que Brown sait jouer du ressenti de son lecteur, tout particulièrement au regard de l’image qu’il suscite de Frank Ramos, et qui casse la projection unilatérale du « héros », avec une admirable finesse.
TUCSON, ARIZONA, LES ANNÉES CINQUANTE
Mais le drame dépasse la seule cellule familiale en voie de dislocation rapide – et douloureuse. La Bête de miséricorde est aussi l’occasion de se pencher sur la société dans un trou du sud-ouest des États-Unis (même un trou très relatif, à l’échelle du pays : Tucson était déjà une ville de bonne taille, et qui compte dans les 500 000 habitants aujourd’hui...), en plein désert, et à peine une dizaine d’années après la conclusion de la Seconde Guerre mondiale – à laquelle il est plusieurs fois fait allusion, notamment, bien sûr, via le personnage tragique de Stiffler et ses dix années pire que volées dans l’enfer des camps de concentration : c’était, littéralement, hier seulement.
Le monde a déjà un peu changé, Medley est très content de sa chaîne haute-fidélité, et peste contre les avions à réaction (c'est qu'ils sont bruyants, mais ce sont tout de même de bien jolis appareils, c'est vrai), mais il y a plus que cette seule culture matérielle : des traits caractéristiques d'un endroit et d'une époque, même de manière sous-jacente.
Fredric Brown ne fait sans doute pas à proprement parler dans la chronique sociale, ici, du moins il n’alourdit jamais son roman avec une analyse vaguement didactique du contexte de son intrigue. Il en traite par petites touches discrètes, mais significatives pourtant, et surtout moralement ambiguës le plus souvent – si c’est bien le mot. Aucune thèse à marteler, simplement un regard lucide qui s’invite dans la narration pour l’accompagner avec subtilité – plutôt que pour la souligner. C’est a priori ici que la traduction originelle se montrait particulièrement infidèle, semble-t-il – car beaucoup trop « contournée », et aseptisée par la même occasion.
Les préjugés raciaux
Ainsi notamment du racisme, au sens large – avec le personnage de Frank Ramos, le « héros » du roman à maints égards, qui est donc latino. Je ne sais pas si c’était si courant, à l’époque – dans les romans policiers, j’entends, pas dans la « vraie vie » –, et je dois avouer que, tout au long de ma lecture, j’avais un peu injustement en tête l’image de Charlton Heston grimé en Mexicain dans La Soif du mal d’Orson Welles (qui sortirait sur les écrans deux ans plus tard). L’ascendance mexicaine du personnage a un impact assez profond sur lui – mais peut-être pas tant à titre personnel que dans le regard des autres, et leur comportement éventuellement maladroit (au mieux...) à son égard. Alice a sans doute raison de douter que Frank puisse jamais faire carrière, mais c’est comme si lui-même s’en moquait. Il sait par ailleurs qu’il a son « utilité » dans la police de Tucson, en tant qu’élément pouvant approcher la communauté mexicaine, assez imposante dans les quartiers populaires – ses collègues semblent baragouiner au mieux deux, trois mots d’espagnol.
Mais Frank a bien affaire à des préjugés raciaux – comme les autres Mexicains de Tucson, avec ou sans les guillemets. La plupart du temps, c’est sur un mode disons mineur, et probablement inconscient de la part de ses interlocuteurs – tout particulièrement au sein de la police municipale. Fern Cahan, son binôme, est sans aucun doute un bon bougre, pas toujours très malin peut-être (surtout en comparaison ?), mais ils s’entendent très bien. Le capitaine Walter Pettijohn aimerait bien, de temps en temps, remettre à sa place son subordonné Ramos, mais pas au point où ses préjugés l’empêcheraient d’admettre que c’est un très bon élément. Reste que Ramos « n’est pas comme eux ».
En fait, ce qu’on lui reproche, plus ou moins consciemment là encore, c’est peut-être surtout de ne pas se conformer au cliché du Mexicain que les « Caucasiens » du coin ont entretenu depuis des décennies : un Mexicain qui est aussi un bon flic, c’est difficile à admettre ; un flic mexicain qui est aussi visiblement plus intelligent et incomparablement plus cultivé que ses collègues et supérieurs plus pâlichons, c’est tout bonnement inacceptable… Alors on ricane de « l’intello », de « l’érudit », ce qui évite de ricaner directement de son bronzage.
Une précaution qui n’est pas toujours de mise quand il s’agit d’envisager d’autres « Mexicains », avec leur lot de clichés – y compris, en bonne place, leur nécessaire catholicisme, forcément « un peu bizarre ». Mais le roman se montre narquois à cet égard, d’une certaine manière : le « Mexicain » du roman, outre Ramos qui est tout à fait américain, est la victime… et cette victime est un immigré allemand ! Comme un certain nombre d'habitants de Tucson, à vrai dire. Mais qui avait déjà dû faire face à ce que les préjugés raciaux peuvent avoir de plus terrible et absurde, en étant envoyé gamin dans les camps de concentration au motif d’une grand-mère vaguement juive – son baptême n’y avait rien changé…
Et c’est en fait ici que Ramos, à l’occasion, cesse de se contenir – comme s’il avait trop longtemps vécu en « Mexicain » aux États-Unis pour s’offusquer encore des préjugés de ses compatriotes concernant les Latinos, mais pouvait par contre se sentir plus libre d'exprimer sa colère quand d’autres communautés étaient stigmatisées : en l’espèce, les Juifs, quand un personnage assez répugnant, une secrétaire pas très futée du nom de Rhoda Stern, s’étend tout naturellement sur la « solidarité interne » de « ces gens-là », euphémisme pour dénoncer la nécessaire corruption des Youpins. Là, Frank s’énerve – plus ou moins, il n’est pas du genre à se répandre en éclats de voix... Mais c’est alors la réaction de son binôme Fern Cahan qui est véritablement éclairente : « Et comment il s'est mis en rogne contre cette Rhoda Stern au chantier ! D'accord, les préjugés raciaux ça le touche, et je le comprends, mais on ne peut pas détester les préjugés au point où on arrive à avoir des préjugés contre tous ceux qui ont des préjugés. Parce que des préjugés, tout le monde en a. Certains le cachent, c'est tout. » Une manière bienvenue de témoigner de l’incompréhension fondamentale du problème par les petits Blancs (très, très) vaguement WASP du coin – même les plus sympathiques d’entre eux, dont Fern au premier chef. Qui n'aime pas les Noirs.
Les violences faites aux femmes
Mais tout ceci n’intervient donc que par petites touches, n’appelant pas d’explications détaillées. C’est également vrai d’une seconde question de société… mais plus difficile à appréhender, pour le coup. Et c’est le machisme endémique – qui semble impliquer les violences faites aux femmes comme un mode « normal » de résolution des conflits au sein du couple ! En fait, tout le monde semble convaincu que c’est parfaitement « normal »…
Et ça vaut pour Frank et Alice.
Frank, pourtant, ne bat pas sa femme. Il n’a jamais levé la main sur Alice. Mais il se demande, dans ces nuits éprouvantes où il doit attendre que sa femme s’effondre au comptoir du bar du coin pour la ramener au foyer sans trop faire de scandale en public, s’il ne devrait pas le faire. Partout autour de lui, c’est ainsi qu’on semble procéder – et un flic, comme il le dit lui-même, est quotidiennement confronté à ce genre d’affaires, qu’il trouve assurément un peu « moches », mais qui semblent « normales » à bien d’autres. Peut-être les violents ont-ils raison, alors ? Quelques baffes pourraient régler le problème, et bénéficier à Alice en la remettant en place ? Il paraît se poser sincèrement la question… et, chose terrible, c’est peut-être seulement au regard de ce critère absurde qu’il pourrait envisager d’admettre qu’au fond il ne prête pas vraiment attention à sa femme – s’il l’aimait vraiment, il la battrait, ça serait mieux pour tout le monde, n'est-ce pas…
Pas facile à digérer, ce genre de discours… et peut-être encore moins quand c’est Alice elle-même qui le tient ! À plusieurs reprises, elle semble espérer que Frank la batte un jour. Ses motivations demeurent floues, et cela peut aller de la pseudo-grivoiserie masochiste tout à fait malvenue (mais dont le genre n'est certes pas avare) au prétexte utile pour quitter son mari, avec, entre les deux, mille avatars de la femme au foyer américaine délaissée par son mari et qui est à bout. Vraiment, une dimension du roman pas facile à appréhender... Sans doute parce qu'elle ne s'exprime qu'au travers des personnages eux-mêmes, sans contrepoint « objectif ». Ce n'est pas très confortable, de s'insinuer dans une psyché de ce type...
EN FINIR
Mais tout cela se mêle habilement à l’intrigue policière pour lui conférer un fond appréciable, discret mais fort. La dimension sociale et intime de la tragédie la rend plus redoutable encore – en fait, on s’inquiète probablement davantage pour Frank Ramos du fait même de son rôle ambigu au sein de son propre couple, car l’on sait que c’est ici que tout va dégénérer…
Le roman est bien devenu un piège pour son héros – qui se déclenche enfin, provoquant une avalanche aux conséquences inévitables…
Ou pas.
Car la toute fin du roman me laisse un peu perplexe – je ne sais vraiment pas quoi en penser ; cela ne suffit bien sûr pas à amoindrir la note globale du roman, que j’ai dévoré avec anxiété et passion, comme le remarquable page-turner qu’il est à l’évidence, le fruit d’un auteur qui sait son métier, et suffisamment pour ne pas se complaire dans la bête formule. Mais cette fin…
Disons-le : une fois que j’ai pris conscience de ce piège dans lequel était tombé Frank Ramos, au point sans doute d'accentuer un peu trop ce caractère à titre personnel, la conclusion du récit ne faisait plus guère de doute à mes yeux – Frank finirait au fond du seau, largué par sa femme et confronté brutalement à son aveuglement et à son absence d’empathie ; dès lors, il lui faudrait mourir, sinon de sa main, plus probablement de celle de John Medley, sa Némésis et son sauveur. Pas un problème à mes yeux, loin de là, puisque le roman à ce stade jouait donc de l’anticipation du drame par le lecteur.
Sauf que ce n’est pas ce qui se produit.
Nous voyons, dans ces toutes dernières pages, Frank Ramos se rendre seul chez John Medley : la confrontation attendue a bien lieu. Mais elle prend une tout autre tournure que ce que j’envisageais. En effet, Ramos, sans obtenir explicitement des aveux de Medley, obtient l’assurance de ce que ses soupçons étaient fondés ; ayant parfaitement compris la psychologie du tueur (quand celle de sa propre femme lui était totalement inaccessible), il l’incite sans un mot à mettre lui-même fin à ses jours. Il s’en va – et Medley se tue en hors-champ. Ultime séquence : Walter Pettijohn rapporte à son subordonné Frank Ramos, de retour de congé maladie, le suicide de son suspect préféré… et Frank Ramos, peut-être revenu de tout, au point où il en est, fait l’innocent.
Fin.
Qu’en penser ? J’ai été décontenancé – ce qui ne signifie bien sûr pas que « ma fin » était meilleure ; Brown sait raconter une histoire, lui… Reste que j’ai trouvé cette conclusion étonnamment « positive ». Au point de m’interroger sur les motivations de l’auteur : s’agissait-il de faire en sorte que le roman se finisse « bien » malgré tout ? Le nouvelliste au travail sur un roman a-t-il succombé à l’attrait d’un ultime twist, d’une chute qui viendrait contredire les attentes du lecteur manipulé ? Ce seraient sans doute de bien mauvaises raisons – mais il pourrait y en avoir de très bonnes, ce que souligne peut-être l’ironie d’un Ramos obtenant de l’homme qui aurait dû le tuer qu'il se tue lui-même… Autant dire de jouer sur son propre terrain, et avec ses propres armes (quelques cachets, en l'espèce).
Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
AUX TRIPES
Mais, ce que je sais, c’est que j’ai vraiment apprécié La Bête de miséricorde. Peu importe mon indécision quant à la conclusion. Polar solide, divertissement efficace et palpitant, conçu avec une grande habileté (notamment, outre le déroulé de l’enquête, au travers d’une dimension chorale très bienvenue et très bien menée, avec des narrateurs qui ont tous leur âme et leur voix), il est aussi très solide au fond, au travers d’un sous-texte jamais simpliste mais le plus souvent très pertinent et parfois bouleversant.
Car, à partir du moment où le roman vire du policier à la tragédie, suivant une pente forcément fatale, il prend le lecteur aux tripes, littéralement. On dépasse alors le sourire de connivence que suscitaient l’attaque en force et la « chute » du premier chapitre – on ne sourit alors plus du tout. Il y a cette même conscience d’être manipulé par quelqu’un qui sait y faire, mais dans un tout autre registre, et pour un effet très violent.
Bilan plus que favorable, donc, pour ce roman dont l’argumentaire de l'éditeur dit qu’il « fait partie de ces petits bijoux de romans noirs des années 1950 » ; ce qu’il est bel et bien, en définitive. Et encore une occasion de plus d’apprécier le talent de Fredric Brown, auteur génial, rusé et profond, à la palette étonnamment variée.