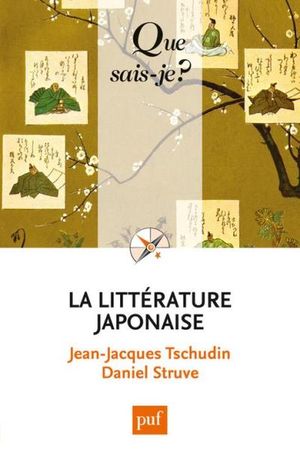Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2017/09/la-litterature-japonaise-de-jean-jacques-tschudin-et-daniel-struve.html
DEUX EN UN
Cela faisait quelque temps, n’est-ce pas ? Mais voici donc que je reviens à la lecture d’essais plus ou moins en forme de « manuels », et qui, en tant que tels, ne se prêtent sans doute pas très bien à l’exercice de la chronique bloguesque… Notez, j’en ai fait quelques-unes, que ce soit pertinent ou pas. Et, notamment, j’en ai fait quelques-unes portant sur des « Que sais-je ? », ce qui est bien le cas du petit livre dont je vais tâcher de causer aujourd’hui.
En notant, une fois de plus, que les « Que sais-je ? » peuvent prendre des formes assez diverses, en dépit de la collection éventuellement connotée qui les rassemble, et allant de la vulgarisation à l’essai plus pointu et assumant le cas échéant très franchement son caractère d’ouvrage à thèse (l’impression, par exemple, que m’avaient fait Histoire du Japon : des origines à Meiji et Le Japon contemporain, tous deux de Michel Vié). Mais, avec La Littérature japonaise, de Jean-Jacques Tschudin et Daniel Struve, j’ai l’impression, globalement, que l’on louche plutôt sur la première catégorie.
Ce qui n’a rien d’un reproche. C’est un livre très abordable, d’un style fluide, dense sans doute mais jamais au point de l’overdose – en fait, limite un peu frustrant eu égard à mes attentes : mes connaissances dans cette discipline, pour l’heure entièrement autodidactes, sont assurément des plus limitées, mais j’ai tout de même eu l’impression qu’il me fallait d’ores et déjà envisager la gamme au-dessus. Ce qui n'est probablement pas très malin de ma part. Et donc, non, ce n’est certainement pas une critique, d’autant que je n’ai certainement pas l’aplomb et l’assurance pour me la permettre – tout au plus un constat un peu ambigu, mais qui peut être tourné autrement : ce petit livre, je pense, pourra intéresser nombre de lecteurs qui, ainsi que moi-même, sont curieux à l’égard de cette matière, et cherchent à se constituer une « base » théorique, préalable indispensable à des questionnements plus spécifiques ou érudits. En tant que tel, il accomplit donc son rôle à la perfection.
Le présent « Que sais-je ? » est l’édition actuelle (et dans sa réédition la plus récente sauf erreur, actualisée en 2016) du titre de la collection consacré à la littérature japonaise – il avait été précédé par (au moins ?) un autre, également titré La Littérature japonaise, et qui était dû à Jacqueline Pigeot et Jean-Jacques Tschudin (j’en ai fait l’acquisition, et vous en causerai un de ces jours). De ces deux auteurs, le second est toujours de la partie, mais il est cette fois associé à Daniel Struve.
Cependant, il ne s’agit pas à proprement parler d’une coécriture : les deux auteurs se sont en fait répartis les tâches. Daniel Struve, maître de conférence à Paris VII, spécialiste de la littérature d’Edo et traducteur, a ainsi écrit les quatre premiers chapitres, consacrés à la littérature classique (entendre par-là antérieure à Meiji), tandis que Jean-Jacques Tschudin, qui fut professeur à Paris VII également et également traducteur, s’est chargé des trois derniers chapitres, portant sur la littérature moderne et contemporaine.
Néanmoins, les deux approches sont dans l’ensemble complémentaires, y compris formellement, et il n’y a pas une séparation brutale entre les analyses des deux périodes. Tout au plus ai-je vaguement eu l’impression d’une première partie peut-être un peu plus didactique, là où la seconde se permet éventuellement une optique un peu plus critique.
LA LITTÉRATURE CLASSIQUE
Grandes lignes
Nous commençons donc avec la littérature classique, selon un plan chronologique, distinguant quatre périodes : des origines à l’époque de Nara, l’époque de Heian (avec une vilaine coquille pour les dates, arf), le Moyen Âge et l’époque d’Edo.
À tort ou à raison, on fait souvent du Kojiki, en 712, le point de départ d’une littérature proprement japonaise, mais Daniel Struve remonte donc un peu avant, aux environs du Ve siècle, pour traiter notamment de la poésie antérieure.
La poésie est à vrai dire probablement le registre clef de cette première période, « des origines à l’époque de Nara (Ve siècle-794) », et conservera longtemps après une place de choix dans les lettres japonaises, avec des formes telles que le waka qui connaîtront des hauts et des bas tout au long de l’histoire littéraire japonaise – jusqu’à nos jours, en fait, et en dépit de bouleversements marqués. Cette place particulière ressort notamment des « anthologies impériales », à partir du Man.yôshû, ou Recueil des dix mille feuilles, qui sera régulièrement « complété » par la suite, de cette manière toute « officielle ».
Ce qui m’amène à évoquer une question complexe et qui demeure ambiguë à mes yeux après cette lecture : le rapport à la langue et à l’écriture chinoises. La matière est sans doute trop complexe pour être utilement présentée dans un ouvrage qui ne dispose tout simplement pas du temps et de la place nécessaires pour s’y attarder, mais disons du moins que cette lecture ne m’a pas vraiment éclairé sur la question. Je me perds, surtout dans les premiers siècles bien sûr, entre les ouvrages « en chinois », « en japonais », « en chinois japonisant », « en japonais largement sinisé », etc. Des questions de degrés, le cas échéant, qui me dépassent totalement – mais sans doute, pour être un peu moins perdu dans cette affaire, faudrait-il que je me penche sur l’histoire de la langue, et non de la littérature, avec ses kana « provisoires », etc. C’est une discipline à part entière.
Quoi qu’il en soit, outre la poésie si essentielle aux premiers temps de la littérature japonaise, d’autres genres, à terme, doivent progressivement être mis en avant, et notamment le « journal intime », ou nikki, dont la part autobiographique est parfois tempérée par une fiction qui ne dit pas encore son nom.
Cela m’amène, à vrai dire, à me poser une question plus globale concernant les non-fictions – car, poésie mise à part, et en prenant en compte cette ambiguïté concernant les « journaux » (ou tout autant les Notes de chevet de Sei Shônagon, etc.), la place des non-fictions dans l’histoire littéraire m’apparaît un peu problématique : bien des œuvres, dont au premier chef le Kojiki, mythologique, puis, mettons, Le Dit des Heiké, chronique historique, ou les Notes de ma cabane de moine de Kamo no Chômei, d’essence philosophique et religieuse, sont citées ici comme faisant partie intégrante des lettres japonaises, mais somme toute assez rares au-delà sont les « essais », disons, qu’ils soient d’ordre politique, philosophique ou religieux, à être mentionnés : guère de place ici pour Dôgen ou les autres auteurs bouddhistes, encore moins pour le Traité des Cinq Roues ou le Hagakure ; la même chose se constatera à vrai dire dans les chapitres consacrés à la littérature moderne et contemporaine, où les seuls essais envisagés, peu ou prou, seront ceux qui traiteront spécifiquement de matières littéraires – les philosophes et les politiques seront le cas échéant mentionnés en passant (car, et j’y reviendrai, l’idéologie a sa part, essentielle, dans l’histoire littéraire du Japon moderne et contemporain), mais pas davantage, car ils ne semblent pas perçus comme relevant à proprement parler de cette histoire. Ce qui se tient sans doute, a fortiori sur un format aussi bref que les 128 pages traditionnellement dévolues aux « Que sais-je ? », mais il me semblait devoir en faire mention.
Mais revenons à l’époque classique, où d’autres genres font leur apparition – et, non des moindres, après certaines anthologies essentiellement poétiques mais où la contextualisation en prose tendait à gagner de l’importance (sur ce blog, voyez les Contes d’Ise et Le Dit de Heichû), le roman d’abord (avec tout au sommet Le Dit du Genji de Murasaki Shikibu), le théâtre ensuite, même si les formes établies du théâtre classique japonais, nô, kabuki et jôruri/bunraku, ne seront développées que plus tard. Cependant, le plan de cette première partie du « Que sais-je ? », assez vite, consistera donc en l’alternance toujours reprise des mêmes sujets : la prose, la poésie, le théâtre, l'importance de chaque registre variant selon les époques.
Dans tous les cas, certains thèmes sous-jacents peuvent être mis en avant, mais qui ne sont finalement guère développés ici – ainsi, par exemple, de la place singulière des femmes dans la littérature classique japonaise, du moins celle de Heian (romans, recueils de poésie plus ou moins enrobés de fiction, journaux), ou encore de la culture propre aux bushi qui succède à celle de l’Antiquité nippone aux environs du XIIe siècle, mais n’est pas moins riche (à ce propos, sur ce blog, voir notamment Histoire du Japon médiéval : le monde à l’envers, de Pierre-François Souyri, ou encore les commentaires de René Sieffert à ses éditions des dits de Hôgen, de Heiji, et bien sûr et surtout des Heiké). Là encore, le propos de ce « Que sais-je ? » est bien de fournir une base à des investigations plus poussées.
Je ne saurais rentrer ici dans les détails de la complexe histoire de la littérature japonaise, avec ses ruptures et continuités, mais il y a assurément beaucoup à apprendre dans ces pages – au moins à titre de premier aperçu. La clarté de l’exposition séduit toujours ou presque, y compris quand il s’agit d’aborder les sujets qui me sont le plus hermétiques – cette satanée poésie en tête. Une bonne occasion de découvrir auteurs et titres au-delà des plus grandes célébrités de l’histoire littéraire japonaise, que sont notamment, à l’époque Genroku, Saikaku dans le roman, Chikamatsu pour le théâtre (voyez ici), et Bashô pour la poésie. En fait, la contextualisation opérée par Daniel Struve permet, ici comme ailleurs, de relativiser quelque peu le propos, en insérant ces grands noms des lettres nippones dans une histoire faite comme de juste de hauts et de bas, de révolutions et de réactions, et où bien d’autres auteurs, proches parfois, considérablement éloignés d’autres fois, méritent également qu’on s’attarde sur leurs œuvres.
C’est ainsi que l’on en arrive aux abords de Meiji, bouleversement dont la portée est sans doute considérable, mais qui, dans les lettres, a pu s’étaler quelque peu, car les auteurs d’Edo encore en place ont continué à publier après 1868, et il fallait aux jeunes auteurs de la période un peu de temps pour se remettre en cause, et remettre avec eux en cause, le cas échéant, l’histoire littéraire qui les a précédés, au prisme des séductions occidentales autant que des replis sur soi teintés de nationalisme ; mais ça, c’est l’objet de la seconde partie.
Pour l’heure, cette première partie a dressé un panorama intéressant de treize siècles d’histoire littéraire, condition nécessaire sans doute à des approfondissements plus personnels.
Quelques titres
[Ma chronique initiale contient ici pas mal de name-dropping, j'en fais l'impasse.]
LA LITTÉRATURE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Plus de détails et d’analyse ?
On passe alors aux trois chapitres dus à Jean-Jacques Tschudin, et qui portent sur la littérature japonaise moderne et contemporaine. Ces trois chapitres, à l’instar de ceux qui précèdent, se succèdent de manière purement chronologique : époque Meiji, époque Taishô et Shôwa jusqu’en 1945, et enfin de l’occupation américaine à nos jours. Sans doute ne faut-il pas, toutefois, accorder trop d’importance à ce découpage, car nombreux sont les auteurs qui chevauchent deux périodes : par exemple, Natsume Sôseki avait commencé à publier sous Meiji, mais il est ici envisagé seulement dans le chapitre sur Taishô ; de même, Dazai Osamu avait déjà publié et avait rencontré un certain succès avant guerre, mais il est étudié ici pour l’essentiel dans la brève période, sous l’occupation américaine, séparant la défaite de son suicide ; d’une certaine manière, on pourrait en dire autant de Kawabata Yasunari, mais, le concernant, ainsi que Tanizaki Jun.ichirô par exemple, l'étude doit en fait se faire sur les deux chapitres, avec des implications différentes.
Je note, mais peut-être n’est-ce qu’une impression, que l’exposé me paraît de toute façon moins didactique dans ces trois chapitres que dans les quatre dus à Daniel Struve, ce qui se traduit à la fois, peut-être, par une plus grande attention aux détails (même si ce n’est donc probablement qu’une impression de façade ?), et, ai-e le sentiment, une subjectivité critique légèrement plus affirmée.
Le point le plus important, toutefois, est probablement que cette histoire de la littérature japonaise moderne et contemporaine s’autorise davantage d’analyse, sur un mode éventuellement comparatiste – par exemple, un trait marqué de cette seconde partie porte sur les relations complexes entretenues par la littérature et l’idéologie (de manière générale) ; et, dans les développements les plus récents, ce « Que sais-je ? » s’autorise de même quelques réflexions, par exemple, sur le renouveau marqué de la place des femmes dans la littérature japonaise contemporaine, ou encore sur l’expression littéraire des minorités, notamment coréenne.
Grandes lignes (bis)
La rupture de Meiji est violente, mais ne doit sans doute pas être exagérée pour autant : les auteurs de la fin de la période d’Edo continuent à publier au cœur même des bouleversements, sans que leur art en ait forcément beaucoup été affecté. Il faudra qu’une nouvelle génération prenne le relais, mais celle-ci doit d’abord se former.
L’ouverture sur le monde constitue probablement le plus grand des chocs, d’emblée : les jeunes auteurs japonais sont amenés à découvrir, et à marche forcée, la littérature occidentale, dont les principes sont parfois fort éloignés des canons de la littérature japonaise d’alors et de ses sources essentiellement chinoises – la fermeture n’était pas totale, avec la « science hollandaise », mais le rapport, quantitativement et sans doute aussi qualitativement, est tout autre.
Les mouvements littéraires sont assez tôt importés, tels le romantisme ou le naturalisme, même si, dans le contexte nippon, ces dénominations tendent souvent à prendre un tout autre sens, parfois bien éloigné de celui que nous connaissons. Mais, dans tous les cas, cela amène les écrivains à questionner leur art, au fil de longs débats passionnés : si les « essais », de manière générale, ne sont qu’exceptionnellement cités dans cet ouvrage, plusieurs cependant viennent contredire ce sentiment, mais c’est que leur propos est essentiellement littéraire. Le naturalisme est ainsi assez vite un courant dominant, mais, de la théorie à la pratique, il y a un pas parfois considérable, et les meilleurs théoriciens ne sont pas forcément les mieux placés pour exprimer artistiquement leurs convictions dans des romans qui seraient à la fois des démonstrations, et, garantie de leur véritable intérêt littéraire, bien plus que cela encore (il y en a, heureusement). Or les questionnements littéraires peuvent prendre des formes éventuellement inattendues (pour un béotien comme moi), et j’ai été intéressé, notamment, par ce long et complexe débat sur la place du langage parlé en littérature...
Mais un débat autrement crucial se poursuit tout au long de la période, auquel la plupart des grands auteurs prennent part, d’une manière ou d’une autre : sans vraie surprise cette fois, il résulte en une tension entre le Japon et l’Occident, et entre tradition et modernité. Les auteurs les plus avant-gardistes (pour un temps du moins), et qui se passionnent pour la littérature étrangère (qu’elle soit anglaise, allemande, française, russe, etc. – ce qui pouvait déboucher sur une forme d’affectation, par ailleurs), ne sont pas forcément les derniers à regretter la disparition supposée d’un monde authentiquement japonais, même si leur rapport à cet oubli varie énormément, de Natsume Sôseki à Kawabata Yasunari en passant par Akutagawa Ryûnosuke ou Tanizaki Jun.ichirô.
L’anomie en est une conséquence fréquente, et à vrai dire souvent traitée par ces mêmes auteurs – dont les variations sur le « naturalisme » prennent régulièrement la forme d’une quasi-autofiction, où la subjectivité de l’écrivain se muant en narrateur apparaît comme étant le seul gage d’une vérité d’un ordre supérieur, et en tant que telle authentiquement artistique. Une anomie, par ailleurs, dont les conséquences peuvent s’avérer fatales – voyez, d’une certaine manière, La Mort volontaire au Japon, de Maurice Pinguet, dans son saisissant chapitre sur les écrivains de Taishô (sans même parler de son ouverture et de sa fermeture avec le cas Mishima, mais nous parlons alors de la période ultérieure).
Ceci étant, ces auteurs, comme tout le monde, évoluent ; aperçus à divers moments de leur vie, et pas seulement de leur carrière littéraire, ils peuvent présenter des images somme toute très différentes. Certains meurent jeunes (Akutagawa Ryûnosuke, dont le suicide s’est avéré très retentissant, mais peut-être aussi Dazai Osamu un peu plus tard), sans totalement se prémunir de ce changement d’image. D’autres, qui vivent plus longtemps, abandonnent assez souvent leurs audaces avant-gardistes de jeunes auteurs, plus ou moins « chiens fous », pour se sublimer à terme dans une écriture à la fois plus personnelle et plus apaisée (ainsi de Kawabata Yasunari ou Tanizaki Jun.ichirô – ce dernier, par exemple, conserve sans doute un certain goût pour la provocation, mais sa réflexion, d’abord du fait du grand tremblement de terre du Kantô, ensuite via sa redécouverte de la littérature de Heian, si peu du goût des autorités militaires, en ont fait à terme un auteur nouveau – ou du moins n’est-il plus exactement alors l’auteur du Tatouage).
Noter que j’ai jusqu’alors essentiellement parlé de fictions – qu’il s’agisse de romans ou de nouvelles. Mais la poésie et le théâtre ont toujours leur mot à dire durant cette période, qui digèrent chacun à sa manière les influences occidentales, quitte le cas échéant à revenir pourtant sur des formes japonaises classiques.
Littérature et idéologie
Un point qui m’a particulièrement intéressé, mais que je suppose ne pas être spécifique au Japon, même si la modernisation à marche forcée sous Meiji y a probablement eu sa part, c’est l’intrication permanente entre la littérature et l’idéologie.
C’est ici que les essayistes « non littéraires » (politiques, philosophes, etc.) jouent un rôle important, notamment via leurs traductions des intellectuels européens, ceux des Lumières (comme Rousseau par Nakae Chômin) ou d’autres plus tardifs – notamment les penseurs socialistes, d’abord sauf erreur dans une optique où la pensée chrétienne pèse d’un certain poids, ensuite de plus en plus dans une perspective marxiste, surtout à partir de la révolution russe de 1917 (mais la tentative de 1905, dans le contexte de la guerre russo-japonaise, lui avait sans doute pavé le terrain à cet égard). Ces idéologies « extérieures » imprègnent la pensée comme l’art de bon nombre d’écrivains, dont les romans, etc., ont un caractère marqué d’œuvres engagées, parfois même de démonstrations « scientifiques » : avant que le roman social ou prolétarien ne s’affiche comme un courant légitime sinon majoritaire, le romantisme ou peut-être plus encore le naturalisme « japonisés » n’étaient finalement pas plus innocents à cet égard. La vie intellectuelle, à l’époque, passe souvent par des revues littéraires volontiers avant-gardistes, où la pensée politique et la création littéraire s’associent, même si parfois de manière confuse (entendre par-là qu’un même « groupe », autour d’une revue donnée, peut être constitué d’auteurs à la pensée en fait toute différente). L’ouverture de Taishô aux principes libéraux et démocratiques était particulièrement favorable à ce bouillonnement idéologique – même s’il s’agissait somme toute d’une période fort brève, entre les avatars les plus stricts de Meiji (en matière de liberté d’expression tout particulièrement, avec surtout le procès et l’exécution des « anarchistes » autour de Kôtoku Shûsui, qui a considérablement affecté les intellectuels du temps) et la tournure militariste de Shôwa dans les années 1930.
Certains, parmi ces auteurs d’alors, embrassaient donc la modernité et les idéologies occidentales, mais d’autres, pas moins nombreux, avaient sans doute une approche plus pondérée. D’autres, enfin, en contrepoint, en tiraient argument pour opérer un repli sur soi qui, à terme, s’accommoderait de l’ultra-nationalisme des premières années de Shôwa jusqu’à la défaite – à moins qu’il ne l’ait suscité, ou du moins y ait eu sa part. Les « études nationales » n’impliquaient pas nécessairement cette conclusion, certes, mais l’exaltation du kokutai pouvait ainsi s’exprimer en dehors du seul champ strictement politique.
Dans tous les cas, le risque était grand d’un carcan nuisant à l’expression libre et à la création pleinement artistique, mais les meilleurs auteurs ont su s’en émanciper – à moins bien sûr qu’ils n’aient choisi, délibérément, de ne pas s’inscrire dans ce débat, ce qui n’avait rien d’évident. Mais je suppose que les abstentions aussi peuvent s’avérer marquées idéologiquement : ne pas écrire pendant la guerre n’était pas un acte neutre (le cas le plus marquant, car explicite, ai-je l’impression, est celui de Nagai Kafû) ; y consacrer son temps à l’exhumation d’un autre Japon, pré-guerrier, non plus (ainsi de Tanizaki Jun.ichirô « modernisant » Le Dit du Genji).
C’est que l’idéologie en littérature devient plus problématique encore quand elle implique la répression sur un mode totalitaire. Il semblerait que la littérature nippone n’ai pas été aussi systématiquement « aux ordres » qu’en Allemagne nazie ou dans l’URSS stalinienne, mais la marge de manœuvre des auteurs demeurait limitée – l’immédiat avant-guerre a pu produire des œuvres importantes, mais elles sont très rares, voire inexistantes, entre 1937 et 1945.
Il y a un cas particulier à noter, et qui concerne ceux qui s’étaient jusqu’alors affichés comme ralliés à une idéologie jugée hostile par le régime en place – le communisme en premier lieu. Certains croupissent en prison, à l’instar des principales figures du parti, mais pas tous – et nombre de ces écrivains, plus ou moins contraints et forcés, rédigent alors des œuvres en forme de « confessions » (tenkô), largement diffusées : il s’agit pour eux de revenir sur leur passé pour expliquer mais aussi critiquer leurs engagements de jeunesse, en louant bien au contraire le nouveau régime en place, qui leur a permis « d’ouvrir les yeux » sur leurs errements idéologiques. C’en est au point où ces tenkô constituent peu ou prou un genre littéraire à part entière !
Je ne vais pas m’étendre davantage sur le sujet ici (c’est passionnant, mais je ne suis clairement pas compétent), mais, si les développements qui précèdent valent surtout pour l’avant-guerre, la question a pu se poser ensuite également, même si dans des termes sans doute bien différents : un Mishima Yukio en témoigne, je suppose – mais peut-être aussi un Ôe Kenzaburô (je n’en suis pas bien sûr, hein : peut-être).
Développements plus récents
Le dernier chapitre, touffu, mais peut-être aussi un peu plus chaotique, traite de la littérature japonaise depuis 1945 jusqu’à nos jours. Les grandes figures n’y manquent pas, incluant Kawabata Yasunari, Tanizaki Jun.ichirô ou Dazai Osamu, qui avaient déjà entamé (voire bien plus que ça surtout dans le cas de Tanizaki) leur carrière avant-guerre, mais aussi des auteurs d’une autre génération, comme surtout Mishima Yukio ou Abe Kôbô, puis Ôe Kenzaburô, et bien d’autres encore (j’aurais envie de citer, par exemple, Nosaka Akiyuki, ou Endô Shûsaku...), jusqu’à la star actuelle Murakami Haruki, en passant par, que sais-je, Murakami Ryû, Ogawa Yôko, ou même Abe Kazushige…
C'est l’occasion de quelques développements sur les évolutions plus récentes de la littérature japonaise, de divers ordres. Une question m’intéresse tout particulièrement, sans surprise, mais, sans vraie surprise non plus, n’est finalement guère traitée ici – elle l’est toutefois, je ne suppose que je n’ai pas à m’en plaindre : il s’agit de la place de la littérature populaire, et notamment de la littérature de genre – qui en vient à dépasser progressivement celle de la littérature populaire, pour être honnête. Avant-guerre, elle n’est qu’à peine évoquée – on y mentionne bien des récits historiques et éventuellement feuilletonnesques comme La Pierre et le sabre, de Yoshikawa Eiji, mais le policier et le fantastique, sans même parler de la science-fiction pour l’heure, ne sont guère envisagés qu’au travers de quelques lignes consacrées à Edogawa Ranpo. Les contes d'un Akutagawa Ryûnosuke, par ailleurs, ne sont tout simplement pas envisagés dans cette optique. Pour m’en tenir à ma SFFF adorée, je note que la situation après-guerre est probablement différente – ceci, alors même que le genre en tant que tel n’est finalement pas représenté dans ce petit livre (pas même via Tsutsui Yasutaka, par exemple – ou Suzuki Kôji, peut-être) ; par contre, Jean-Jacques Tschudin relève que divers auteurs non associés au genre en tant que tels ont cependant beaucoup écrit dans ces domaines – on s’attarde plus particulièrement sur le cas d’Abe Kôbô, d’ailleurs, le plus flagrant sans doute, et le plus varié ; mais, plus récemment, Ogawa Yôko ou Murakami Haruki peuvent également être envisagés dans cette perspective. Je suppose que le cas d'Akutagawa n'était pas si différent, pourtant, mais ça se discute.
Sans que cela relève forcément du genre, mais avec des connotations populaires qui ne coulaient pas forcément de source, l’auteur relève que l’édition nippone produit régulièrement, et même de plus en plus, des best-sellers – on pense bien sûr d’emblée à Murakami Haruki, mais, pour citer des auteurs que j’ai pratiqués, c’est très probablement le cas aussi d’Ogawa Yôko. Surtout, ces succès instantanés tendent à s’exporter bien plus vite qu’auparavant, que ce soit dans d’autres médias (Jean-Jacques Tschudin mentionne par exemple l’adaptation à succès de La Formule préférée du professeur, d’Ogawa Yôko), ou par-delà les frontières du Japon : les traductions (en anglais, en français, etc.) sont aujourd’hui bien plus rapides et diverses qu’elles ne l’ont longtemps été – on revient une fois de plus à Murakami Haruki, bien sûr, pour qui c'est peu ou prou immédiat, mais l’auteur cite d’autres cas bien moins médiatiques, comme celui d’Abe Kazushige.
Mais « la sociologie de l’édition nippone », disons, mérite sans doute qu’on s’y arrête également. Jean-Jacques Tschudin relève ainsi que la place des femmes, dans la littérature japonaise contemporaine, est sans commune mesure avec ce que l’on avait connu depuis Meiji (évidemment, le cas antique est bien différent, mais la comparaison ne fait sans doute guère de sens… Évidemment aussi, il y avait des exceptions notables sous Meiji et Taishô) ; les auteures d’aujourd’hui (dont Ogawa Yôko bien sûr, mais il y en a bien d’autres) sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus publiées aussi, et vendent souvent beaucoup. L’image comme les thèmes de la littérature japonaise moderne et contemporaine ont pu dès lors évoluer dans des directions qui auraient paru parfaitement inattendues il y a quelques décennies à peine – dans une société qui demeure sans doute passablement machiste.
Autre question éventuellement liée, celle de la place des minorités dans les lettres japonaises : la communauté coréenne, notamment, longtemps « cachée » (nous parlons surtout des Coréens qui s’étaient installés ou avaient été installés de force au Japon avant 1945, et de leurs descendants), semble se révéler un peu partout dans les médias, et dans les lettres comme ailleurs – avec une part de questionnement identitaire, sans doute ; là encore, le paysage littéraire japonais ne peut qu’en être affecté.
Il y aurait beaucoup d’autres choses à dire, et avec plus d’assurance tant qu’à faire – du moins ai-je essayé de donner un aperçu de ce qui m’avait le plus intéressé dans cette seconde partie du « Que sais-je ? ».
Quelques titres (bis)
[Nouvelle séquence de name-dropping abandonnée ici.]
PASSIONNANT
Bilan plus que satisfaisant pour ce « Que sais-je ? », donc. D’une lecture agréable et d’un abord plutôt aisé, il constitue une excellente introduction à la littérature japonaise aussi bien classique que moderne et contemporaine. Chaudement recommandé à quiconque, à l’instar de votre serviteur, découvre cette matière passionnante.
Il y a sans doute bien plus à en dire, et, au sortir de ce petit livre, j’ai d’ores et déjà envie d’en lire davantage sur le sujet, avec des ouvrages pouvant s’émanciper des contraintes de la collection. Mais sans doute est-ce en vérité un réflexe malvenu : il me faudra y revenir en temps utile, mais, d’ici-là, j’ai plein de livres à lire – ceux dont parle cet essai. Il y en a beaucoup, et plus qu’alléchants. Au travail !