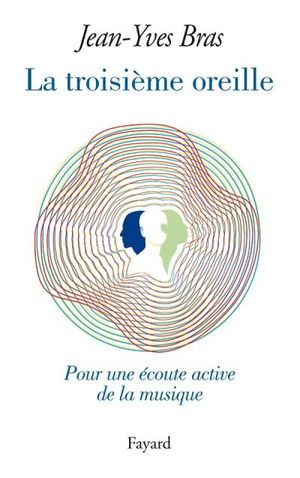Contrairement à ce que le titre et l’épaisseur de ce bouquin suggèrent, le but de cet ouvrage n’est pas tant de vous donner une méthode magique pour une renforcer votre qualité d’écoute, mais plutôt d’étudier le phénomène d’écoute musicale et d’en dresser un portrait historique.
En effet, les conseils donnés, bien que pertinents, se contentent d’enfoncer des portes ouvertes (se mettre au calme, privilégier les places permettant une meilleure acoustique lors d’un concert, essayer de repérer l’époque, le style, les instruments…). Pire encore, en se focalisant uniquement sur la musique dite « classique » (abus de langage volontaire de ma part) et tout au plus au jazz ou à la musique sérielle au détriment des genres plus actuels (grosso modo à partir des années 1970), l’auteur se drape d’un certain snobisme qui pourra rebuter les passionnés de musique actuelle dont je fais partie.
L’approche choisie est volontairement très théorique et historique. Point de dissertation sur le plaisir procuré par l’écoute d’une fugue de Beethoven, point d’envolée lyrique sur la glorieuse perfection des préludes de Chopin. De la rationalité, voilà tout ce que vous trouverez. Et ce n’est pas une mauvaise chose, tant l’analyse froide voire rigide de l’historien se révèle précieuse pour trouver les clés de l’écoute de certaines œuvres.
Le point fort de ce livre réside dans l’originalité de son thème : l’écoute musicale. Au lieu de se concentrer uniquement sur le compositeur comme la plupart des ouvrages musicaux, l’auteur explore la relation mystique, presque sacrée, qui anime la trinité compositeur-interprète-auditeur. Et cette approche se révèle rafraîchissante et passionnante ! Le rôle de l’auditeur, si souvent mis en retrait dans l’histoire de la musique, retrouve ici un éclairage bienvenu. Qu’elle soit utilisée à des fins religieuses, éducatives, voire même dictatoriales, la musique a toujours eu une fonction dépassant le simple cadre récréatif selon les âges et les pays. En témoignent les deux citations suivantes, qui je l’espère titilleront votre curiosité et vous convaincront de lire cet ouvrage :
« Quand il m’arrive d’être davantage ému par le chant que par le
contenu des paroles chantées, je m’accuse d’un grave péché, et alors
je préférerais ne pas entendre le chantre »
Saint Augustin (354-430)
« Un art qui ne peut pas compter sur l’accord le plus immédiat et le
plus intime de la masse, un art qui a besoin du plébiscite et des
suffrages de petites cliques, est intolérable. Un tel art s’efforce de
semer le trouble, alors qu’il devrait, dans la joie, renforcer
l’instinct très sûr et la santé d’un peuple. L’artiste ne peut pas se
tenir à distance de son peuple. » Adolf Hitler, 18 juillet 1937 à
l’inauguration de la Maison de l’art allemand à Munich
Il faut également saluer le choix d’écriture de l’auteur, qui a privilégié un format d’interview avec une certaine Mme. Croche, personnage fictif nommé en référence à M. Croche, nom de plume choisi par Debussy pour écrire ses critiques musicales. Les relances de Mme. Croche donnent de la souplesse au récit et rend l’enchaînement des idées plus dynamique et plus « léger » qu’un bloc de texte uni. Le travail de vulgarisation est également bien réussi, car même la partie théorique ne demande pas de prérequis particulier et est facilement compréhensible de la plupart. De nombreux ouvrages, plus pointus et précis, sont recommandés au fil de la lecture pour ceux qui souhaitent approfondir un sujet en particulier.
En définitive, ce livre s’adresse non pas à ceux qui veulent découvrir de meilleures techniques d’écoute (qui risquent d’être fortement déçus), mais à tous les curieux qui souhaitent explorer un pan jusqu’ici peu raconté de l’histoire musicale et de sa sociologie. La lecture y est agréable, et le sujet est aussi spécifique que passionnant.