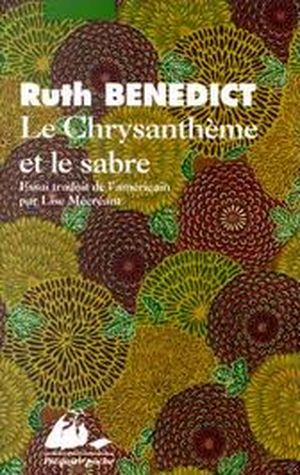Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2016/09/le-chrysantheme-et-le-sabre-de-ruth-benedict.html
Le Chrysanthème et le Sabre, publié originellement en 1946, dans le contexte que l’on sait, est probablement le plus célèbre ouvrage d’anthropologie consacré aux Japonais ; son influence a été considérable (en fait, cela s’applique aux travaux « japonais » de l’auteure avant même la parution de l’ouvrage – on a dit que, si le régime impérial avait été conservé après la capitulation, c’était en partie du fait de son action et de son analyse), et on en a tôt fait un classique aux États-Unis – mais aussi au Japon, où il a été très rapidement traduit, et abondamment discuté. Bizarrement, il aura pourtant fallu attendre 40 ans pour en avoir une traduction française… ce qui est assez fâcheux pour un ouvrage « de circonstance », caractère que son statut postérieur de « classique » ne saurait lui enlever.
CIRCONSTANCES DE LA RÉDACTION ET DIFFICULTÉS MÉTHODOLOGIQUES
Décrire l’Ennemi : une anthropologie à distance
Car cet essai a été élaboré dans un contexte particulier. L’anthropologue américaine Ruth Benedict, disciple de Franz Boas et figure du mouvement culturaliste ou du relativisme culturel, s’était vue demander par l’armée américaine une étude permettant de comprendre les Japonais en pleine guerre du Pacifique, avec aussi dans l’idée de préparer le terrain de l’après-guerre. En cela, on peut la comparer à Edwin O. Reischauer, qui a conçu la première version de son Histoire du Japon et des Japonais dans des conditions similaires. Mais cette entreprise hardie posait pour l’anthropologue des difficultés bien particulières, et propres à sa discipline. On n’en était plus, alors, à l’anthropologie « de bureau » ou « de bibliothèque » ; on ne concevait plus qu’un anthropologue digne de ce nom puisse parler de manière pertinente d’une société dans laquelle il n’avait pas lui-même vécu. Or Ruth Benedict n’avait jamais mis les pieds au Japon, et était bien sûr dans l’impossibilité de s’y rendre pour étude en plein conflit… Par ailleurs, elle ne connaissait pas la langue japonaise.
Les Japonais interrogés
Pour construire son essai, elle a donc dû se soumettre à des biais méthodologiques éventuellement fâcheux : les Japonais qu’elle a pu interroger étaient, soit des immigrés aux États-Unis avant la guerre (de ceux qui étaient donc parqués dans des camps…), soit des prisonniers de guerre – et il est difficile de dire quelle situation est la plus biaisée des deux… On a beaucoup critiqué cette approche – on a pu dire, par exemple, que le modèle « totalisant » construit par Ruth Benedict (c’était son ambition et celle de son courant méthodologique, même dans ces conditions) ne renvoyait pas à un « Japonais idéal », mais à un « soldat japonais idéal », ce qui change radicalement la donne… Quant aux immigrés japonais, la guerre les a amenés à couper radicalement des ponts avec le Japon, mais sans doute le fait de vivre loin de l’archipel, éventuellement jusqu’à l’extranéité, les a-t-il considérablement changés par rapport à cet hypothétique « Japonais idéal » que souhaite décrire l’auteure…
Les témoignages écrits et la langue japonaise
Pour pallier à ces difficultés, mais en en soulevant en fait d’autres, Ruth Benedict a également fait appel à des sources littéraires ou plus globalement écrites – le problème étant donc qu’elle ne lisait pas le japonais : dès lors, il lui fallait avoir recours à des traductions parfois anciennes et sans doute plus ou moins précises, ou des rendus récents mais de seconde main, éventuellement via les Japonais immigrés ou prisonniers mentionnés plus haut, ce qui en rajoutait dans les biais…
En fait, c’est d’autant plus fâcheux que le cœur de l’ouvrage interroge des notions d’une extrême complexité renvoyant à l’obligation et à la dette ; or l’anthropologue fait ici usage de termes « spécifiques » qu’aucune traduction en anglais (ou en français, d’ailleurs) ne saurait rendre avec suffisamment de précision…
L’ambition culturaliste/relativiste
Pour autant, si elle doit composer avec ces difficultés, Ruth Benedict n’est pas une anthropologue de second ordre, et elle procède avec le plus grand sérieux – laissant toujours le champ ouvert à la contestation (qui ne manquera pas, mais ultérieurement). Si l’ambition « totalisante » peut s’avérer problématique, au regard de ses schémas éventuellement trop rigides, l’approche culturelle porte ses fruits – même si de manière un brin étrange parfois.
L’anthropologie d’alors ne pouvait bien sûr se permettre des jugements de valeur induisant une hiérarchie des modèles culturels. Ceux-ci doivent être envisagés le plus objectivement possible, et dans une relation d’égalité sinon d’identité. On ne saurait bien sûr se contenter d’un lapidaire « les Japonais sont bizarres » (voire « dingues »), réflexe qui laisse encore des traces aujourd’hui… Et peut-être d’autant plus en pleine guerre, où le réflexe est forcément de déshumaniser l’Ennemi, sous les traits d’un archétype essentiellement maléfique ou du moins barbare ! Danger considérable, que l’étude de Ruth Benedict doit justement circonvenir.
Il s’agit donc de définir un modèle japonais cohérent, et qui, pour être différent, n’en a pas moins sa logique propre et sa valeur intrinsèque. L’approche culturaliste a cependant quelque chose d’ambigu à cet égard, en appuyant sur les différences – et peut-être trop ? C’est un trait saillant du livre de Ruth Benedict, qui, pour « scientifique » qu’il soit en dépit de ses biais méthodologiques, n’en a pas moins parfois quelque chose de « spectaculaire » : on a l’impression, à lire Le Chrysanthème et le Sabre, que les Japonais font systématiquement tout à l’inverse des Américains… Cette perception un peu faussée doit donc être prise en compte, et, à son tour, relativisée le cas échéant.
La douteuse pérennité du modèle
Enfin, cette ambition « totalisante » dans un cadre circonstancié amène à un relativisme circonstancié : cet ouvrage a maintenant 70 ans, et, s’il reste pertinent à bien des égards, même en étant très justement critiqué notamment, mais pas seulement, par des chercheurs japonais, il n’en reste pas moins qu’il constitue un cliché à un instant T, d’une société déjà portée à l’évolution rapide, et qui, dans le contexte précis de l’immédiat après-guerre, ne pouvait qu’évoluer davantage et éventuellement plus vite encore…
LES JAPONAIS DANS LA GUERRE
Ruth Benedict débute donc son étude, et sur commande de l’Office of War Information, en pleine guerre du Pacifique. Pour expliquer « l’Ennemi », l’anthropologue se penche donc en premier lieu sur les motivations des belligérants. Or, dans l’optique évoquée juste un peu plus haut, mettant l’accent sur les différences, Ruth Benedict les envisage comme fondamentalement opposées, au point où elles sont incompréhensibles de part et d’autre – ce qui, au-delà du seul combat, peut avoir des conséquences paradoxales, ou, plus exactement dans l’approche de l’ouvrage, qui paraissent paradoxales aux Américains, mais qui ont leur cohérence propre selon le modèle japonais.
La supériorité de l’esprit japonais
Mais des traits saillants peuvent d’ores et déjà être ainsi mis en avant. On a beaucoup glosé sur la supériorité de « l’esprit » japonais sur le matérialisme américain, par exemple – et c’est effectivement un trait qui ressort souvent, tant des interrogatoires de prisonniers de guerre (rares – j’y reviendrai) que des sources écrites (tout particulièrement dans la presse ?).
Du point de vue occidental, au regard de l’évolution du conflit à cette époque (nous sommes nettement plus proches d’Iwo Jima et Okinawa, sinon Hiroshima et Nagasaki, que de l’expansion irrépressible du Japon, avec Midway pour faire la balance), on serait tenté d’y voir un déni de réalité – mais les choses sont évidemment plus complexes que cela.
Tout est prévu
Pourtant, ce déni a d’autres implications, peut-être plus sensibles cette fois sur le sol même du Japon, et non seulement chez ses soldats : l’idée que tout est « prévu » ; à chaque revers militaire, le commandement militaire japonais assure la population qu’il ne s’agissait pas vraiment d’un revers, dans la mesure où l’avancée alliée avait été « prévue », l’idée étant donc que les mesures pour y répondre ont été établies de longue date, et que leur efficacité à terme ne saurait faire de doute : dès lors, nulle raison de s’inquiéter des victoires alliées (temporaires) et pas davantage des bombardements américains…
Le respect dû à l’empereur
Dans un autre registre – mais peut-être plus essentiel encore aux yeux de l’anthropologue, au regard de l’anecdote mentionnée d’emblée quant au maintien de la dynastie impériale ? –, Ruth Benedict note bien sûr qu’on ne saurait, au Japon, critiquer l’empereur.
Mais cela tient du réflexe, héritage sans doute d’une longue histoire, et n’est en rien hypocrite, comme on pourrait le croire. Ruth Benedict note d’ailleurs, chose étonnante, que même dans le Japon militariste et totalitaire en plein conflit, un certain espace de liberté d’expression subsiste – sans doute inenvisageable dans les autres pays de l’Axe, et de même en URSS. En fait, les militaires au pouvoir sont du coup parfois critiqués – mais pas l’empereur : il est dans une autre sphère. Et, parmi les Japonais interrogés, tant ceux qui soutiennent l’effort militariste que ceux qui le conspuent une fois défaits, semblent dans l’incapacité d’établir une relation quelle qu’elle soit entre cette politique et l’empereur.
Le principe hiérarchique fondamental y a sans doute sa part – ainsi que la notion de « dette » ou de « responsabilité » : j’y reviendrai ultérieurement, c’est là le cœur de l’ouvrage.
Mais c’est aussi une manière d’expliquer le comportement étonnant des Japonais (aux yeux des Américains) après Hiroshima et Nagasaki. Nombre de prophètes de mauvais augure prédisaient une guerre longue avant de mater le Japon, et une occupation difficile, en proie à l’hostilité irrépressible des Japonais. Mais c’est le contraire qui s’est produit : une fois que l’empereur a annoncé la capitulation, même en disant que c’était une chose « impossible » qu’il fallait faire néanmoins (là encore, il faut sans doute renvoyer aux développements ultérieurs sur « l’obligation » et la « dette »), les Japonais ont aussitôt déposé les armes… et même accueilli avec déférence, respect voire enthousiasme les troupes d’occupation, leur facilitant la vie sur place à tous points de vue !
Mourir pour l’empereur : l’impossibilité de la reddition
Pourtant, auparavant, une conséquence notable de cette conception de l’empereur devait être soulignée, dépassant peut-être même le conditionnement totalitaire : les soldats, quelles que soient leurs idées sur la question de la guerre (car ils pouvaient éventuellement se permettre d’en avoir, même s’il leur fallait composer avec de nombreux biais, bien sûr), étaient tout disposés à « mourir pour l’empereur ».
C’est là un trait essentiel du comportement des soldats japonais durant la guerre du Pacifique – au point où il est devenu un cliché, j’imagine. Côté fictions, je vous renvoie par exemple à Mourir pour la patrie de Yoshimura Akira, ou côté essais à Morts pour l'empereur de Takahashi Testuya.
Mais ce trait fait sens tout particulièrement au regard de la question des prisonniers de guerre. Pour le soldat japonais « idéal », la reddition est inenvisageable – mieux vaut mourir, dans une charge suicidaire par exemple, plutôt que de se rendre, car il ne saurait y avoir pire honte (cela rejoint les notions essentielles de « dette » et de « responsabilité », tant au regard de la dette envers l’empereur que de la nécessité de laver son nom, voir plus loin ; il faut ici rajouter la fameuse distinction, quand bien même controversée par la suite, mais qui me paraît tout à fait intéressante, opposant « culture de la culpabilité » et « culture de la honte », j'y reviendrai également).
Dès lors, les soldats japonais sont dans l’incapacité de comprendre les soldats alliés qui se rendent : ils devraient avoir honte ! Et pourtant ça n’est visiblement pas le cas… La tentation, dès lors, est grande de les déshumaniser encore un peu plus. En résultent des traitements particulièrement sévères… mais avec des aspects parfois étonnants : ceux qui violent ouvertement les règles sont impitoyablement châtiés – mais ceux qui dissimulent, agissent en douce, sont bien mieux tolérés, même quand ils sont pris… Ceci provient d’un questionnement moral essentiellement différent, là encore avec les notions de « dette » et de « responsabilité » ainsi que de « culture de la honte ».
Mais ce rapport aux prisonniers de guerre peut avoir des conséquences bien autrement étonnantes : sans doute la supériorité de « l’esprit » nippon y joue-t-elle un rôle, mais on a souvent relevé que les conditions médicales des prisonniers de guerre, autrement maltraités comme tant de livres ou de films en témoignent, étaient en fait régulièrement meilleures que celles des soldats japonais qui les gardaient…
LE PRINCIPE HIÉRARCHIQUE : CHACUN À SA PLACE
La hiérarchie contre l’égalité
La société japonaise, depuis longtemps, est caractérisée par un très fort principe hiérarchique, résumé dans un mot d’ordre lapidaire : « Chacun à sa place. » C’est là la structuration essentielle du monde nippon. Et c’est une chose tout particulièrement incompréhensible pour les Américains, qui mettent en avant, instinctivement, la notion d’égalité (au-delà bien sûr des disparités de fortune...).
Ruth Benedict évoque ainsi le voyage d’Alexis de Tocqueville, qui allait déboucher sur la publication de sa fameuse analyse De la démocratie en Amérique – le jeune noble, après le chaos révolutionnaire, était naturellement porté à priser le modèle antérieur d’essence inégalitaire, mais a vu ainsi qu’un modèle différent, fondamentalement égalitaire, était possible et parfaitement viable. Cela reste une description essentielle de la mentalité américaine. Ici, le rapport au Japon est pour le coup inverse – mais sans voyage sur place, donc…
Un principe général, de la famille aux relations internationales
Ce principe est susceptible de bien des applications, dans tous les domaines. Il peut être réduit à la seule dimension familiale (notons au passage que le culte des ancêtres ne doit pas leurrer à cet égard, la famille japonaise honorée est considérablement restreinte par rapport au clan chinois englobant des dizaines de milliers de personne), mais aussi bien étendu à la scène internationale : en fait, c’est là un trait essentiel de l’effort colonial puis militaire du Japon en Asie continentale et dans le Pacifique, et une raison profonde de l’alliance au sein de l’Axe avec l’Allemagne et l’Italie.
Le chef responsable et non despote
Pour autant, ce principe admis, il ne faut pas se méprendre sur la conception de l’autorité au Japon – plus diffuse qu’on pourrait le croire. Ainsi, le chef de famille japonais n’est pas le chef de famille prussien : il n’a rien d’un autocrate, et son pouvoir n’a rien d’arbitraire – il s’inscrit dans les traditions, mais celles-ci, justement, ménagent une part importante à la consultation. Plutôt qu’un « chef » à proprement parler, le père de famille – mais tout autant le fils aîné – est avant tout un responsable.
Le système de castes des Tokugawa
Le principe hiérarchique au Japon, le « chacun à sa place » fondamental, a sans doute trouvé son expression la plus radicale dans le système de castes élaboré sous le shôgunat Tokugawa (période d’Edo) : les samouraïs, nobles combattants, y ont en fait une place à part et non seulement supérieure ; le système hiérarchise par contre, dans l’ordre, les paysans, puis les artisans, puis les commerçants ; quant aux parias (du fait de leur occupation, mais le statut est hérité), ils sont hors système. Ce système avait ses implications, nombreuses et plus ou moins faciles à appréhender ; on y voyait toutefois un garant essentiel du maintien de la paix, d’autant qu’il s’accompagnait de mesure visant à affaiblir le pouvoir des daimyos.
Mais ce système de castes n’était pas aussi rigide qu’on pourrait le croire au premier abord – à l’instar de la « fermeture » du Japon à laquelle on le relie, comme autant d’éléments caractéristiques de l’ère Edo. La « fermeture » n’a pas empêché l’économie monétaire de se développer, et a ainsi favorisé la mobilité sociale (au niveau de la génération sinon de l’individu). D’où, en fait, des intérêts liés entre les samouraïs pauvres et les marchands en quête de noblesse – élément crucial du mouvement de Meiji.
LES IMPLICATIONS DE MEIJI
Ce lien, voire cette alliance, permet de comprendre que le mouvement de Meiji n’a rien de révolutionnaire : il n’y a pas alors de lutte ouverte entre aristocrates et bourgeois, comme en France. Qualifier exactement le mouvement est délicat, mais, à la base, il tient donc plus de la « restauration » que de la « révolution » : on affiche en tout cas une volonté de retour en arrière – en ce sens, nous sommes donc aux antipodes de la révolution.
Mais Meiji est un mouvement paradoxal – et il entraîne des évolutions extrêmement rapides, et souvent inattendues. L’alliance d’intérêts des samouraïs pauvres et des riches marchands a favorisé l’émergence d’une nouvelle classe de dirigeants : « leurs excellences », dont on s’accorde à dire qu’elles savent ce qu’elles font… Mais l’absence de caractère révolutionnaire se constate à ce que le principe hiérarchique demeure, au-delà de la rigidité supposée des castes : « chacun à sa place » est un mot d’ordre qui a toujours pleinement son actualité sous Meiji.
Le nouveau système est d’ailleurs susceptible de variantes à cet égard. Ainsi, la démocratie a d’abord une place extrêmement limitée dans le système central, mais bien plus importante à l’échelon local… et, aussi stupéfiant que cela puisse paraître, dans l’armée ! D’autant que celle-ci est globalement constituée au niveau local.
Pour autant, c’est un des passages où Ruth Benedict n’appuie pas systématiquement sur les différences inconciliables ; elle note en effet que ce système n’est pas nécessairement si original que cela : il peut évoquer, par exemple, les royaumes de Hollande ou de Belgique de l’époque (même si les modèles anglais, surtout, et éventuellement américain, ont pu intriguer les Japonais d’alors).
Il faut enfin relever le rôle du shintô d’État qui s’affirme alors. Pour Ruth Benedict, il ne fallait pas alors le considérer comme une religion – et, dès lors, il ne posait aucun problème au regard de la liberté des cultes : finalement, il pouvait davantage être comparé à une pratique patriotique plutôt que religieuse stricto sensu, comme le salut au drapeau américain… Mais c’est une question assez subtile, dont traite Takahashi Tetsuya dans Morts pour l’empereur, et je vous y renvoie donc.
LE CŒUR DU MODÈLE CULTUREL JAPONAIS : LES NOTIONS D’ « OBLIGATION » ET DE « DETTE »
Un lexique subtil : on, gimu, chu, ko, nimmu, giri…
Mais nous en arrivons au cœur de l’ouvrage, qui consacre plusieurs chapitres relativement complexes à ce qui, selon Ruth Benedict, constitue l’essence même du modèle culturel japonais : la, ou plutôt les, notions de « dette » et d’ « obligation. Car plusieurs notions sont en fait en jeu, désignées sous des termes précis par les Japonais, usant d’un lexique subtil et riche de nuances intraduisibles en anglais (et probablement tout autant en français).
En partant de la notion de on, renvoyant à toutes les « obligations » contractées passivement, elle-même susceptible de variantes (le on général se subdivise éventuellement en plusieurs on spécifiques, renvoyant le cas échéant à l’empereur et à la patrie qui lui est liée, ou encore à la famille et aux ancêtres, etc.), on en arrive à plusieurs formes de « responsabilités », dont le règlement des « dettes » diffère, notamment entre gimu « infini » et donc impossible à jamais pleinement rembourser (le gimu renvoie ainsi au chu pour l’empereur et la patrie qui lui est associée, au ko pour la famille et les ancêtres, au nimmu pour le travail…), et giri, « dette » de quelque autre ordre que ce soit susceptible quant à elle d’être « remboursée » (pas forcément en numéraire, même si on tend à le présenter sous la forme d’une équation mathématique), mais se subdivisant à son tour en deux catégories, le « giri envers le monde » (par exemple devoir envers le suzerain ou la belle-famille), et le « giri envers son nom » (lequel décide du comportement irréprochable en société au regard de la honte éventuelle, mais aussi de toutes les occasions de « laver son nom », ce qui, dans une éthique radicalement différente de celles que nous connaissons en Occident, légitime éventuellement la violence, par exemple en cas de vengeance, et quitte à recourir à des comportements que nous aurions tendance à juger fourbes et guère honorables – mais dans l’optique japonaise, ces comportements, en tant qu’ils visent à « laver le nom », sont justement parfaitement honorables, et j'y reviendrai).
Une opposition spectaculaire
Ce système complexe aboutit à des comportements ou réactions franchement surprenantes pour un Occidental – c’est sans doute ici, dans ce cœur de l’ouvrage donc, que Ruth Benedict appuie le plus sur les différences entre modèles culturels, au risque de la systématisation « spectaculaire ».
Un exemple éloquent en est fourni, trouvé dans un magazine, dans une sorte de rubrique du « courrier du cœur », censément tenue par un psychiatre – qui répond à un vieil homme l’interrogeant sur le comportement à adopter (en l’espèce, le vieil homme, après avoir consacré bien des années après la mort de sa femme à élever ses enfants, souhaiterait, sur ses vieux jours, s’installer avec une jeune femme, et s’interrogeait sur la réaction des enfants) en lui prescrivant point par point un comportement parfaitement antithétique à celui que nous attendrions et apprécierions aux États-Unis et en Europe ! Et d'autant plus de la part d'un psychiatre...
Imposer le on
Mais c’est que le on a des implications terribles. Le on est reçu passivement, par principe ; en tant que tel, il peut être imposé, en fin de compte ; aussi un service rendu n’a-t-il pas du tout les mêmes implications qu’en Occident, où des notions de charité et de générosité viennent d’une certaine manière appuyer la gratuité du geste accompli.
Or le on pose toujours la question du « remboursement » ; aussi, imposer un on, bien loin de figurer un acte altruiste, est un comportement invasif, pouvant éventuellement passer pour une insulte ! Cela explique en partie les formules « de politesse » japonaises qui consistent en autant d’excuses, et franchissent régulièrement la limite de l’autodénigrement ; cela explique aussi un certain nombre d’institutions ou rites sociaux venant pondérer le poids global de l’obligation afin d’éviter autant que possible les réactions extrêmes (violentes, notamment – contre soi ou contre les autres). Ceci est vrai dans le cadre du gimu, impossible à rembourser, mais aussi, et de manière plus fourbe à certains égards, dans le cas du giri, « envers le monde » ou « envers son propre nom » : le giri, après tout, est par essence remboursable, mais « contre son gré », et, littéralement, désigne « la chose la plus dure à supporter »…
Aussi est-il, dans la société japonaise d’alors (je ne saurais dire ce qu’il en est aujourd’hui), d’une importance cruciale de ne pas s’imposer ou même s’immiscer ; les conséquences, éventuellement redoutables, sont presque impossibles à envisager pour un Occidental qui s’égarerait dans ce système… Je ne doute pas que ces chapitres ont joué un rôle essentiel dans le cadre de l’occupation américaine.
Pour mémoire, Ruth Benedict déploie notamment cette analyse en se fondant sur le roman Botchan, un des plus célèbres de Natsume Sôseki.
Une casuistique complexe
Les implications du on, et de toutes les notions liées, subalternes ou dérivées, sont innombrables. Mais ce lexique subtil autorise en sus une casuistique complexe – et qu’un non-Japonais pourrait trouver spécieuse.
Ainsi, le rapport d’obligation à l’empereur n’était pas le même que celui à l’égard du shôgun : aussi, si les complots contre l’empereur étaient jugés impossibles de manière générale, la trahison du shôgun n’avait pas les mêmes implications, et pouvait quant à elle être envisagée.
Le point a été évoqué plus haut, mais le rapport à l’empereur, dans cette perspective, a joué un rôle essentiel dans la capitulation du Japon en 1945, et plus encore dans le comportement – jugé « incompréhensible » par les Américains – du peuple japonais dans son ensemble : quand l’empereur s’est prononcé, la défaite est aussitôt devenue un fait acquis et incontestable, et le on envers l’empereur impliquait dès lors de faire bon accueil aux ennemis d’hier et de leur ménager une occupation paisible et volontaire, voire enthousiaste.
On comprend d’autant mieux que Ruth Benedict ait pu plaider la cause du maintien de l’institution impériale devant les autorités américaines… Et, à l’en croire, c’est dans ce modèle culturel de l’ « obligation » et de la « dette » que réside le « secret » de la capitulation japonaise et de l’occupation paisible qui a suivi (laquelle en était encore à ses débuts quand Le Chrysanthème et le Sabre a été publié, mais les années ultérieures ne feraient que confirmer ce premier contact), bien plus que dans l’ascendance divine supposée de l’empereur, souvent mise en avant.
Cette casuistique, ces subtilités diverses, se rencontrent bien sûr à d’autres niveaux de l’ « obligation » ; il y aurait tant de cas à citer… Je ne peux sans doute me le permettre dans ce compte rendu déjà trop long. Mais, à titre d’exemple, voyez le « culte des ancêtres », comme autre trait japonais souvent mis en avant : en fait, ce respect, s’inscrivant dans les schémas du on, etc., ne porte véritablement, ou concrètement, que sur les ancêtres immédiats – la famille est une unité relativement restreinte, les clans immenses à la chinoise n’ont guère leur place ici. Par contre, ce respect a des conséquences appréciables dans un vaste système réciproque d’ « obligations », par exemple en ce que le respect dû aux parents « se paye » par l’attention à l’éducation des enfants, etc. J'aurai là encore l'occasion d'y revenir.
LA VERTU ET LES CONFLITS D’OBLIGATIONS
Le héros japonais, écartelé entre les obligations contradictoires
Ce complexe système d’ « obligations » génère inévitablement des tensions, de l’ordre du conflit d’intérêts ou même de l’opposition radicales de deux « remboursements » incompatibles. Les loyautés partagées sont particulièrement redoutables dans ce cadre, et le « Japonais idéal » de Ruth Benedict est forcément, à un moment ou à un autre, déchiré entre deux « obligations » s’excluant mutuellement.
Cependant, dès lors qu’une au moins de ces « obligations » est « remboursée », le comportement y aboutissant est jugé honorable à sa manière. C’est là un trait culturel majeur, qui a par exemple son importance dans le traitement des récits, notamment littéraires ou cinématographiques : le happy end n’est guère recherché – voire supposé impossible ; par contre, les héros qui intéressent les Japonais sont déchirés entre des obligations incompatibles. La manière dont ils payent, éventuellement au prix du sacrifice, fournit la substance du drame.
Le gimu étant impossible à rembourser, le giri a ici un rôle particulier – mais, au fond, c’est l’entrelacement de toutes ces notions qui fait sens en rendant la vie impossible, au point éventuellement de justifier un sacrifice ultime.
Une illustration : les 47 rônins
Le thème classique des 47 rônins permet de mettre en lumière cette particularité : à tout prendre, ce « mythe » (mais attention, il est fondé historiquement) des 47 rônins est à maints égards incompréhensible pour un Occidental, qui plus est baigné de culture chrétienne ; au Japon, pourtant, cette histoire de loyauté poussée jusqu’au sacrifice, mais dans une optique de vengeance, et passant par de nombreuses ruses que nous jugerions intuitivement guère honorables, représente le sommet ultime de l’héroïsme… Je vous renvoie, tant que j’y suis, à la belle nouvelle d’Akutagawa Ryûnosuke « Un jour, Ôishi Kuranosuke », dans La Vie d’un idiot et autres nouvelles (ledit Ôishi Kuranosuke est le personnage central de la conspiration).
On trouverait cependant bon nombre d’exemples moins « héroïques », mais également jugés honorables selon les critères japonais – car leur société est peut-être moins attachée à la pureté des moyens, dès lors qu’il s’agit de parvenir à la fin honorable : les moyens, eux, n’ont pas nécessairement à être honorables.
CULTURE DE LA CULPABILITÉ ET CULTURE DE LA HONTE
C’est là un autre point crucial de l’essai de Ruth Benedict – et qui a été âprement discuté… L’idée est cependant tout à fait intéressante, si sa systématisation est effectivement contestable. L’anthropologue, dans son élaboration d’un schéma général japonais par essence antagoniste au schéma général américain, avance qu’un trait culturel fondamental explique la distinction et les incompréhensions qu’elle suscite. En effet, à l’en croire, les États-Unis (en l’espèce – mais les causes étant essentiellement religieuses, dans les monothéismes bibliques, on peut étendre la qualification bien au-delà) seraient une « culture de la culpabilité », là où le Japon serait une « culture de la honte ».
La culture de la culpabilité
Or culpabilité et honte ne vont pas forcément de pair. La notion essentielle de la « culture de la culpabilité » est celle de péché ; dans une optique chrétienne, elle résulte d’une codification ancienne du « bien » et du « mal », permettant de qualifier objectivement les comportements : certains sont par essence fautifs et, en tant que tels, appellent à l’introspection ; la faute est caractérisée autant par le fait accompli que par son intégration intime, génératrice de remords.
Mais c’est bien ce tourment interne qui compte, outre la commission objective de l’acte : la honte ressentie par le coupable, dans cette perspective, n’est qu’un épiphénomène – au mieux : l’attachement excessif à la honte, perçue comme rapport social aux autres, ne manque pas, bien souvent, d’être taxé d’égocentrisme ou de narcissisme, avec le sentiment de superficialité mesquine que nous tendons à y accoler.
La culture de la honte
La mentalité japonaise serait tout autre. L’opposition codifiée entre bien et mal n’y est pas aussi prégnante – en fait, on tend plus à considérer qu’ils font tous deux partie du monde tel qu’il est, sans que cela appelle à un jugement quel qu’il soit, ou encore moins à un affrontement eschatologique. L’essentiel est bien plutôt le rapport de l’individu au système d’obligations qui le baigne. Dès lors, la faute en tant que fait objectif se voit relativiser son importance – et, surtout, l’intériorisation de la faute n’a guère de sens. Ce qui en a, c’est le rapport de l’individu à la société qui l’entoure : c’est ce qui en fait une « culture de la honte ».
La honte fait ici figure de châtiment suprême, non la conviction de la culpabilité ; et elle appelle à entreprendre tout ce qui est possible pour la faire disparaître – en « lavant son nom ». Mais, dans cette perspective, l’honneur au seul sens social est de la partie : les moyens pour « laver son nom », dès lors, ne peuvent pas être objectivement qualifiés d’ « honorables », ou plus exactement n’ont pas à l’être. Autant pour le bushido, construction anachronique, ou plus exactement son fantasme occidental ? En tout cas, c’est ainsi la honte qui, aussi étrange que cela puisse nous paraître, est là-bas à l’origine de la vertu.
Envisagé sous cet angle, on comprend mieux la permanence du thème des 47 rônins avec tout ce qu’il peut avoir d’étonnant pour des Occidentaux. Mais, là encore, nul besoin de recourir immédiatement à cet exemple « mythique » : au quotidien, la honte serait de toute façon de bien plus de poids que la culpabilité.
Un éclairage utile
Je ne suis pas certain de bien appréhender ces notions – et peut-être mon résumé est-il contestable dans cette optique. Le sujet m’a intéressé, toutefois – si j’ai bien conscience de ce que sa systématisation a de hardi et sans doute d’inacceptable : en conjuguant ce thème avec celui plus global des « obligations » et des « dettes », j’ai l’impression de mieux saisir certains comportements japonais tels qu’ils s’expriment au cinéma ou en littérature – mais aussi au-delà : j’ai l’impression, à lire ces développements, de mieux comprendre par exemple les scènes de « micro-trottoir » dans l’excellente novella de Ken Liu L’Homme qui mit fin à l’histoire. Je retiens par exemple ce bref témoignage d’un quidam déclarant que les anciens membres de l’Unité 731 avouant leurs exactions avaient déshonoré leur pays, non par ce qu’ils avaient fait, mais par ce qu’ils avaient dit… La question peut éventuellement être prolongée dans les stratégies adoptées par la droite pour rendre sa gloire au sanctuaire du Yasukuni, ainsi que les évoque Takahashi Tetsuya dans Morts pour l’empereur…
LE CERCLE DES ÉMOTIONS HUMAINES ET LES PLAISIRS
Il ne faudrait sans doute pas pour autant développer à l'excès cette image, à nos yeux éventuellement névrotique (le rapport entre la psychologie/psychanalyse et l’anthropologie pourrait être ici une autre piste fructueuse) : le Japonais, même le « Japonais idéal » de Ruth Benedict, est bien plus que cela, et dispose dans sa vie d’occasions détachées le cas échant des systèmes du on et de la honte toujours à craindre.
C’est tout particulièrement le cas en ce qui concerne les loisirs, et même plus précisément les plaisirs. Nous sommes ici aux antipodes du modèle chrétien – et plus encore du sous-modèle protestant, notamment américain via le puritanisme. Le christianisme, disons, tend à réfréner le plaisir, à lui trouver forcément quelque chose d’immoral : cela imprègne la conception des sept péchés capitaux, mais va bien au-delà, et joue un certain rôle au quotidien. L’intention prime ici à nouveau – et on ne saurait, dans cette perspective, considérer le plaisir comme une fin en soi ; c’est même pire que cela : il est par essence suspect… et appelle donc à cette introspection de la faute envisagée à l’instant.
La conception japonaise est tout autre – même si l’on aurait tort de vouloir y déceler une opposition d’ordre symétrique. Sans doute le plaisir n’est-il pas, dans le Japon de Ruth Benedict, une fin en soi. Mais il occupe une autre sphère des comportements humains, où il a sa place et s’apprécie en tant que tel. Certes, un commandement moral demeure, qui impose de ne pas attacher trop d’importance à ce « cercle des émotions humaines », jugé d’essence secondaire. Toutefois, dès lors que cet écartement de la sphère principale des activités humaines est bien compris, le plaisir en soi n’a absolument rien de répréhensible : bien au contraire ! Sans être donc une fin en soi, le plaisir est apprécié pour ce qu’il est. Il n’y a aucun mal à aimer manger, même beaucoup, ou boire, éventuellement jusqu’à l’ivresse, ou dormir, ou faire l’amour (dans le cadre conjugal ou pas, cela n’a aucune importance, dès l'instant que les obligations au sein du mariage, au regard du système évoqué plus haut, sont respectées ; l’érotisme est autrement valorisé ; notons d’ailleurs que cela vaut aussi traditionnellement pour l’homosexualité ou « l’auto-érotisme »)… Tout cela fait partie de l’humain, et, dès lors, pourquoi le réprimer ?
Pour autant, l’espace mental japonais ne relève pas de « la quête du bonheur ». Mais le réconfort de la chair n’a rien d’obscène : il est appréciable, et l’art y trouve nombre de sujets à sublimer, sans pour autant reléguer aux orties sa dimension matérielle, pleinement assumée. Un trait japonais, qui, pour le coup, me séduit…
LA DISCIPLINE DE SOI
Ces considérations amènent à des développements concernant la perception japonaise de la discipline de soi. Sans doute ici le risque est-il grand de sombrer dans les clichés d’un zen mal compris… Mais j’en retiens d’autres aspects plus intéressants – et tout particulièrement, en rapport direct avec ce qui précède, le questionnement de l’efficacité : au Japon, contrairement à ce que nous connaissons, on ne considère pas le sommeil comme une « nécessité pour se montrer efficace le lendemain » ; cette optique performative n’a pas lieu d’être : on apprécie le sommeil en soi, sans le rattacher nécessairement (en le rabaissant au passage) à une finalité d’ordre éthique. Pour autant, la discipline de soi permet bien plus sereinement de parvenir à des résultats appréciables, si l’esprit de compétition a des connotations toutes différentes.
L’autodiscipline à la japonaise passe par un certain nombre de méthodes utiles, qui entretiennent une relation complexe avec les « émotions humaines » et les plaisirs envisagés à l’instant. La privation est en fait envisageable, voire approuvée, mais comme un mode de détachement ; et c’est bien sûr un nouveau témoignage de la supériorité de l’esprit sur le corps – mais avec donc cette nuance inédite quand j’avais envisagé cette question tout à l’heure, voulant que le corps ait après tout lui aussi sa place.
L’ÉDUCATION DES ENFANTS
Une culture n’a rien d’inné, bien sûr : elle s’apprend, comme le reste. C’est sans doute pourquoi Ruth Benedict consacre en définitive un long chapitre (le plus long, même, de l’essai ; reste ensuite un bref chapitre sur les Japonais depuis la capitulation, toute récente, mais cela tient de la conclusion) à la question de l’éducation des enfants. Sujet traité de long en large, et je ne me sens pas de rentrer dans les détails ici – d’autant que leur caractère d’opposition « spectaculaire » me paraît une fois de plus un peu trop forcé ; mais c’est peut-être surtout que j’ai tendance à croire (sans pouvoir me fonder sur rien de précis, certes) que c’est là un domaine où les mentalités japonaises ont tout particulièrement évolué depuis 1946.
Quelques points à relever, cela dit – notamment, bien sûr, la perpétuation de la famille conçue comme une « obligation » pleinement inscrite dans les systèmes du on, et permettant à chaque génération de s’insérer dans ledit système au niveau familial ; par exemple quand l’enfant « paye » ses parents en ayant lui-même des enfants, leur éducation étant une contrepartie de celle qu’il a reçue.
Mentionnons aussi le caractère très vite ultra-différencié de l’éducation des garçons et des filles – qui consiste déjà à les placer dans le monde. On tolère dès lors des choses que nous jugerions inacceptables – tout particulièrement la violence chez le petit garçon, sous la forme d’insultes ou même de coups portés contre sa mère. Laquelle est par ailleurs en conflit permanent avec la belle-mère (non, ce n’est pas une blague), situation difficile dont elle se remboursera en devenant elle-même belle-mère…
Par ailleurs, l’enfance peut être perçu comme un grand moment de liberté – ce que sera aussi la vieillesse. C’est entre les deux que le Japonais se retrouve tributaire du principe hiérarchique et du système impitoyable du on…
CONCLUSION
Au-delà de ses biais méthodologiques éminemment contestables, au-delà de ses partis-pris théoriques qui ne le sont pas moins (notamment concernant la systématisation d’un modèle général du « Japonais idéal »), au-delà enfin de l’évolution de la société japonaise depuis 1946, Le Chrysanthème et le Sabre reste une lecture tout à fait passionnante. On aurait sans doute tort de balayer cet ouvrage, qui fut en outre d’une grande importance historique au moment de l’occupation du Japon par les forces américaines, mais aussi par la suite en diffusant une représentation commune du Japon et des Japonais, comme nul et non avenu en raison des progrès de la science.
En fait, à certains égards, on peut d’autant plus saluer le travail de l’anthropologue qu’il a été accompli dans ces circonstances guère propices – et son essai fait preuve d’une hauteur de vue appréciable, en développant le modèle d’une société certes différente mais pas moins cohérente et n’appelant en rien la bêtise des jugements de valeurs de « ceux qui sont nés quelque part », alors même que le conflit du Pacifique était propice à la déshumanisation de l’Ennemi.
On peut dès lors voir Le Chrysanthème et le Sabre comme une porte ouverte à d’autres analyses – que Ruth Benedict elle-même appelait de ses vœux. Que cet ouvrage ait été abondamment critiqué depuis ne fait que renforcer son statut de « classique », dont la lecture est sans doute nécessaire encore aujourd’hui à qui s’intéresse à l’anthropologie du peuple japonais. Le plus fort étant qu’en un certain nombre de points il reste tout à fait pertinent…
Un bel ouvrage, donc – malgré tout. Et une lecture aussi passionnante qu’instructive, au carrefour de l’anthropologie culturelle et de la sociologie des représentations. À lire !