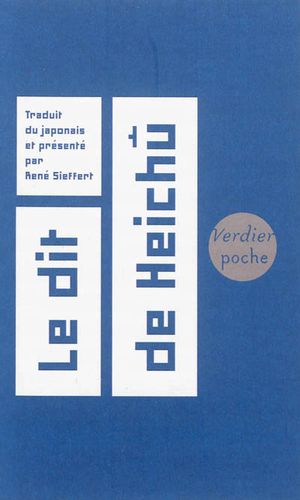Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2016/07/le-dit-de-heichu.html
Où je poursuis mon excursion aux sources de la littérature japonaise, avec ce bref texte qu’est Le Dit de Heichû, qui m’a rappelé la manière des Contes d’Ise (antérieurs d’un siècle environ), peut-être davantage qu’il n’annonce les grands monogatari à venir, a priori, tels que Le Dit du Genji ou encore Le Dit des Heiké, que je lirai prochainement (parmi d’autres) – je réserve mon jugement d’ici-là. Le présent texte a cependant son importance dans l’histoire de la littérature classique japonaise – René Sieffert, qui l’introduit et le traduit (avec élégance, mais parfois au prix d’un relatif hermétisme, pour ce qui est des poèmes), y voit « le ʺchaînon manquantʺ de l’histoire de la genèse du récit romanesque » ; à tout prendre, cependant, nous sommes bien encore dans le genre uta monogatari, ou « conte-poème », à la structure assez proche des Contes d’Ise : des chapitres/nouvelles/contes très brefs le plus souvent, où la poésie occupe une place centrale, si elle est enrobée de prose ; cependant, elle l’est de plus en plus au fil des chapitres, qui prennent progressivement de l’ampleur – ce qui confère en effet davantage une forme romanesque au propos, même si le liant, d’un chapitre à l’autre, est somme toute limité ; mais les aventures galantes – puisque c’est bien de cela qu’il s’agit – de ce Heichû répondant au Narihira des Contes d’Ise, tout aussi « historique », et tout aussi porté à la démonstration de son talent poétique, du moins quand ces dames sont en cause, ont peut-être davantage un caractère « suivi » ? C’est à débattre – mais sans doute pour ce faire faudrait-il disposer de tout autres compétences que l’ignare de moi en matière d’histoire de la littérature japonaise…
Le texte a une autre particularité notable, si elle est largement le fruit du hasard : c’est qu’il a longtemps été perdu. Des indices épars laissaient supposer l’existence d’une œuvre littéraire consacrée spécifiquement aux amours de Taira no Sadafumi, dit Heichû (à noter que le nom « officiel » n’apparait pas une seule fois dans Le Dit de Heichû, et même le surnom Heichû très rarement – deux fois seulement, sauf erreur), un galant du Xe siècle, issu de la famille impériale, néanmoins plutôt discret voire médiocre pour ce qui est de sa carrière politico-militaire. Il avait cependant une certaine réputation de libertin et de poète – plusieurs de ses œuvres figuraient dans des anthologies de poésie classiques, qui constituaient autant d’indices concernant l’existence du Dit de Heichû, lequel avait été rédigé par un(e) anonyme (on a parfois supposé que Taira no Sadafumi lui-même en était l’auteur, mais cela paraît peu probable), et en faisait un « héros d’amour » ; cependant, si René Sieffert cite, en guise de références occidentales, aussi bien Tristan que Don Juan, nous sommes quand même bien plus proches de ce dernier – tombeur invétéré, emporté par ses pulsions, il n’a absolument rien d’héroïque, et encore moins de loyal ; c’est en même temps, peut-être, ce qui le rend sympathique, à certains égards : il a quelque chose d’un archétype courtois, oui, mais pas du genre chevaleresque, accomplissant des quêtes pour sa dame (unique) ; il est bien plutôt pleinement intégré dans le jeu des galanteries poétiques, et l’expression de « jeu » n’a rien d’innocent. En fait, j’ai, le concernant, un peu le même sentiment que pour Narihira dans les Contes d’Ise – j’apprécie que ces hommes, tout nobles et bardés d’attributions militaires qu’ils étaient, aient brillé avant tout, au regard de l’histoire réputée sanglante de leur pays, dans le registre poétique et l’expression de leur sensibilité (aussi feinte soit-elle le cas échéant…), et non aux armes sur le champ d’horreur ; ça nous fait des vacances…
Mais ce qui rend Heichû le plus sympathique, c’est peut-être autre chose, pourtant… Les textes épars qui l’évoquaient et dont on avait gardé la trace (par exemple les Contes de Yamato ou le Konjaku monogatari, dont on trouve des extraits en annexe de ce petit volume) en dressaient en effet un portrait guère flatteur… Notre libertin, en fait, s’il accumulait les succès auprès de ces dames, avait ceci d’humain qu’il se ramassait au moins aussi souvent : les anecdotes ne manquaient pas, où telle jolie femme l’envoyait balader (« J’ai vu ! »), ou encore où tel stratagème galant était percé à jour, et dévoilé, condamnant le malotru au ridicule… Et c’est une dimension, d’ailleurs, qui ressort aussi de ce Dit de Heichû – tout particulièrement dans les premiers « chapitres », très brefs, qu’on qualifierait familièrement aujourd’hui de collection de râteaux… Cela peut cependant aller plus loin : l’extrait cité du Konjaku monogatari, même dans une circonstance aussi grave a priori que le récit de la mort de Heichû, parfume (si j’ose dire) l’anecdote tragique d’une déconcertante scatologie sans doute très révélatrice… Sans aller jusqu’à voir en lui un lointain précurseur d’Enjirô Adakiya, le Galantin de Santô Kyôden – car Heichû, lui, sait très bien ce qu’il fait et n’a sans doute rien d’un personnage romantique, ou en tout cas bien moins qu’il le prétend –, le fait est qu’il a souvent quelque chose de ridicule autant que rusé, et, le texte du Dit de Heichû ayant longtemps été perdu, c’est en fait cette image éventuellement biaisée et largement comique qui a perduré, au point d’avoir toujours son importance dans les lettres japonaises bien des siècles plus tard – Akutagawa a écrit à son sujet, Tanizaki également.
Mais il existait bien un Dit de Heichû – et on a fini par le retrouver, en 1931 seulement, soit pas loin de dix siècles après sa rédaction… Ce récit assez court, pour relever encore du genre uta monogatari, n’en avait pas moins quelque chose de visionnaire, à certains égards, et son auteur anonyme, après pas loin de dix siècles d’oubli, a retrouvé un rang non négligeable dans l’histoire de la littérature classique japonaise. Si René Sieffert, dans sa préface, admet volontiers que ledit auteur, homme ou femme, n’a pas le talent de Dame Murasaki Shikibu, il n’en loue pas moins la finesse des portraits (de femmes, tout particulièrement) qui émaillent l’œuvre, et célèbre donc son caractère de « chaînon manquant » vers le développement du genre romanesque au Japon.
Nous avons donc 39 « chapitres », d’un liant tout de même limité, et pouvant régulièrement tenir en une seule page – toutefois, les « contes » se font globalement de plus en plus longs au fur et à mesure que l’on avance dans l’œuvre, et la prose y prend davantage d’importance, constituant un récit à proprement parlé, non uniquement destiné à contextualiser et mettre en valeur les poèmes, comme c’est le cas au début – ou dans une œuvre antérieure telle que les Contes d’Ise. Les poèmes (des tanka, je suppose ; en tout cas, leur rendu en français comprend systématiquement cinq vers) ont tout de même une importance essentielle – parce que la séduction, dans le cadre aristocratique et courtois de ce Xe siècle japonais aux allures d’ « âge d’or », consiste pour une bonne part dans un jeu littéraire, une correspondance de tous les instants, où les amoureux faussement transis échangent plusieurs missives par jour, via des intermédiaires au rôle parfois essentiel, et tel poème suscite tel autre, qui à son tour entraîne une réponse, etc. La plupart des chapitres comportent ainsi plusieurs poèmes, dus alternativement à Heichû lui-même (très rarement nommé, donc – les chapitres préfèrent largement l’anonymat et l’allusion, et commencent très souvent par « Cet homme encore… », ou une formule du même ordre) et à ces (innombrables) dames qu’il entend séduire. Les plus piquants, donc, sont sans doute ceux où ses amours le remettent assez cruellement à sa place – encore que le séducteur invétéré mérite souvent d’être ainsi rabroué. Sa ruse un peu trop visible, son élégance un peu trop affectée, sa réputation bien trop notoire et guère flatteuse sinon exécrable, n’en font pas quelqu’un d’aussi respectable que le Narihira des Contes d’Ise – peut-être d’ailleurs son art poétique est-il aussi moins subtil (mais je serais bien incapable d’en juger – je relève cependant que la galanterie est peu ou prou le thème unique des poèmes de Heichû, là où Narihira, occasionnellement, pouvait se livrer à la poésie en des occasions tout autres, j’y reviendrai) ? Mais, comme avancé plus haut, c’est en même temps ce qui en fait quelqu’un d’humain…
Pour autant, je n’ai pas autant apprécié Le Dit de Heichû que les Contes d’Ise. Ces derniers m’avaient charmé par leur élégance, mais aussi quelque chose d’autre, de moins aisé à définir – sous les poèmes, j’y devinais davantage tout un monde, et le galant Narihira, pour briller dans les joutes amoureuses, me faisait aussi l’effet (peut-être parfaitement erroné…) d’un authentique artiste, jusque dans ses forgeries, et tout autant d’un sage, jusque dans sa légèreté – le libertin n’était pas que libertin, et, même dans ses entreprises de séduction, il me paraissait développer tout autant une vision du monde, apaisée, enjouée parfois, digne et rassurante à sa manière ; le champ de ses contes et poèmes dépassant la seule galanterie, c’est sans doute beaucoup plus vrai quand c’est le « général » puis le « vieillard » qui est ainsi mis en scène… Certes, j’ai de manière habituelle bien plus de goût pour les personnages moins « parfaits » – des « antihéros » si l’on y tient –, et, sous cet angle, Heichû devrait bien davantage me parler que Narihira ; ce n’est pourtant pas le cas. Mais peut-être, justement, du fait de la répétition des thèmes ? Le Dit de Heichû est entièrement consacré à la séduction ; si les poèmes jouent bien sûr de métaphores éventuellement classiques, de codes voire de clichés renvoyant notamment à la nature – fleuves de larmes inclus, ils reviennent souvent –, ils n’en ont pas moins un objectif affiché de galanterie qui se répète sans cesse… Ils ne sont pas sans charme, mais le contexte les fait sonner encore plus faux que ceux de Narihira – ce qui, en soit, est souvent amusant ! Et les reparties des plus habiles des proies de Heichû, pas du genre à se laisser faire, n’en sont que plus salées… Mais toutes n’ont pas cette sagesse et cette habileté : nombreuses sont celles qui succombent et, autant le tableau des échecs de Heichû avait quelque chose de cruellement réjouissant, autant la litanie interminable de ses conquêtes a-t-elle quelque chose de lassant.
Peut-être l’édition y a-t-elle sa part ? Je ne critique bien entendu pas la traduction – qui est élégante, et les poèmes sont très joliment retranscrits, très sonores (s’ils ne sont pas forcément aisés à appréhender – l’absence de ponctuation, les inversions et élisions nombreuses sinon systématiques, font que l’on y achoppe parfois, ou du moins cela a été mon cas ; le rendu est beau, mais il se mérite). C’est peut-être davantage le contexte qui m’a manqué ici – la préface éclaire bien des choses, mais le texte en lui-même est largement purgé de notes parasites. C’est une approche parfaitement justifiée – mais j’ai peut-être un peu regretté les notes de G. Renondeau et Bernard Frank dans les Contes d’Ise, expliquant telle référence locale ici, ou s’attardant sur les difficultés de la traduction là, notamment quand, assez souvent, les poèmes étaient émaillés de jeux de mots impossibles à rendre en français… Autant que le texte en lui-même, c’était là un véhicule de choix pour parcourir tout un monde, avec ses nombreuses singularités culturelles. Le Dit de Heichû, dans cette édition qui a fait le choix bien légitime de la littérature « pure » sur la philologie ou la civilisation, m’a donc fait l’effet d’une œuvre plus abstraite, peut-être…
Cela reste un bel ouvrage – et, sans nul doute, une pièce du plus grand intérêt dans le registre de l’histoire de la littérature japonaise. Mais je ne peux pas prétendre avoir été emballé plus que ça… Il me faudra peut-être y revenir, toutefois – mon appréciation de l’œuvre pourrait bien bénéficier de lectures futures, dont, non des moindres et autrement amples, Le Dit du Genji et Le Dit des Heiké. On verra…