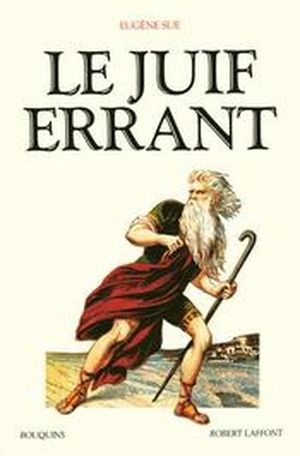Le Juif errant, c’est ma première incursion dans le monde d’Eugène Sue. Relativement long (1600 pages dans l’édition que je suis en train de lire), l’oeuvre réunis tous les ingrédients du roman-feuilleton typique, dont il fut un des plus grands succès.
Du coup, je me suis dit que, pour rendre compte d’un roman-feuilleton, pourquoi ne pas faire une critique-feuilleton ? Le roman étant divisé en seize parties, pourquoi ne pas écrire au moins un paragraphe (et parfois plus si cela s’y prête, bien entendu) pour chaque partie, au fil de la lecture ?
La note que j’ai donnée là est, bien entendu, provisoire et susceptible de changer selon ma progression dans l’oeuvre ; seulement, il est obligatoire de mettre une note pour publier une critique, donc voilà…
Episode 1
Première partie : l’auberge du Faucon blanc
Le premier épisode de ma critique sera forcément un peu plus long : il s’agit d’un premier contact avec un auteur, avec un style, donc il y a des choses à dire.
Cette première partie se déroule en octobre 1831 dans une petite ville d’Allemagne proche de Leipzig. Un ancien soldat de la Grande Armée arrive en ville, accompagnant deux jeunes filles, des jumelles d’une quinzaine d’années. Pour une raison inconnue, cet homme est attendu en ville par un personnage étrange et inquiétant, Morok, un montreur d’animaux sauvages qui se fait passer pour un prophète.
Comme d'autres romans tout au long du XIXème siècle, Le Juif errant se situe dans un contexte post-napoléonien, où les héros de l'épopée impériale sont pourchassés. Sue, comme d'autres (Alexandre Dumas dans Le Comte de Monte-Cristo, Hugo dans Les Misérables, montre comment, même longtemps après Waterloo, la France et l'Europe restent marquées et divisées par l'aventure bonapartiste.
Ce qui est intéressant, dès ce début, c’est le côté mystérieux de la situation. D’un côté, Morok semble avoir reçu une mission particulière pour empêcher le vieux grognard (qui répond au surnom de Dagobert) et les deux filles de poursuivre leur voyage. Mission de la part de qui ? Pour quelle raison ? Nous n’en saurons pas plus pour l’instant (même si le nom d’un certain monsieur Rodin est prononcé).
De l’autre côté, ces deux jeunes filles, orphelines de mère et dont le père, ancien général bonapartiste (le général Simon), est en exil on ne sait où, sont en possession d’un mystérieux médaillons qui les enjoint de se rendre à Paris, à une adresse précise (en l’occurrence « Rue Saint-François, n°3 ») le 13 février 1832.
C’est à ce rendez-vous précis que les jumelles essaient de se rendre, et c’est la réussite de ce voyage que Morok a pour mission de contrarier.
Cette ambiance de mystère est encore renforcée par la présence de personnages énigmatiques. Ainsi, les deux jumelles rêvent, chaque nuit, d’un étrange jeune homme blond aux yeux blonds qui dit s’appeler Gabriel. Leur père, lors d’un combat, a été sauvé par un homme qui a pris un boulet de canon à sa place et en a survécu de façon inexplicable. En bref, cette première partie baigne dans une ambiance d’énigmes qui instaure un aspect surnaturel et favorise l’attention du lecteur. C’est sans aucun doute l’aspect le plus réussi de ce début de roman.
Sur le plan de l’écriture, c’est ici l’efficacité qui prime. Nous avons quelques descriptions des personnages et pas mal de dialogues : la lecture est rapide, les chapitres sont assez courts (dix pages maximum) et se terminent souvent sur une petite phrase d’accroche qui donne envie de lire la suite (donc d’acheter le numéro suivant du journal : c’était le but).
Cependant, il faut admettre que cette écriture est aussi, souvent pour le moins naïve, voire même nunuche à certains moments. Les personnages, dans cette première partie, se divisent en bons et méchants monolithiques. Ainsi, Dagobert est l’exemple du personnage un peu brute, frustre, mais profondément bon, dévoué et fidèle. Morok, au contraire, est l’être noir, brutal, presque animal et sauvage. Aucune subtilité dans la description des personnages.
Ce défaut majeur culmine avec la description des deux jumelles, personnages nunuches par excellence. Elle sont pures et innocentes, donc forcément vêtues de blanc, et surtout leurs lignes de dialogues sont d’une nullité (et souvent d’une inutilité) sans nom. Les traits seraient forcés même si ces personnages avaient été parodiques (ce qui, apparemment, n’est pas le cas).
Cependant, ce défaut n’est pas suffisant pour me faire interrompre la lecture. On sent venir de loin le complot d’une organisation secrète (je mise sur les Jésuites, puisqu’on a, à un moment, le sigle L.C.D.J. : La Compagnie De Jésus?), mais aussi les retrouvailles émouvantes avec le père disparu, etc.
[article à retrouver sur LeMagDuCiné]
Episode 2
Cet épisode, qui regroupe les parties 2 à 7 du roman, pourrait s’intituler Le Complot et nous fait arriver environ au quart du roman.
Si la première partie du roman pouvait se définir comme un drame plutôt intimiste, l’action se limitant à quatre personnages dans une auberge, la suite va donner au roman d’Eugène Sue une dimension humaine et géographique totalement différente. Le nombre de personnages va augmenter considérablement, et l’action va se répandre dans différents pays (même si la France, et surtout Paris, va rester le lieu central).
La deuxième partie du roman va apporter des réponses à certaines questions. En effet, comme on le soupçonnait, l’action du roman va tourner autour d’un complot organisé par les Jésuites dans le but de s’accaparer une forte somme d’argent et d’augmenter son pouvoir. Les Jésuites sont décrits dans le roman comme une organisation secrète cherchant à utiliser la religion et les sentiments religieux de certaines personnes dans le but d’acquérir du pouvoir, manipuler les gens et transformer les puissants en des marionnettes (dans un prochain épisode de cette critique-feuilleton, on parlera plus précisément de la vision de la religion développée par Eugène Sue dans ce roman). Une organisation qui agit dans l’ombre, par le renseignement, le chantage et l’extorsion, par la peur et la manipulation, tout en se donnant l’aspect d’une morale irréprochable. Comme exemple des procédés employés, la Compagnie fait pression sur un couple de vieux régisseurs d’un château appartenant à une famille noble : soit le régisseur espionne la propriétaire du château et fait son rapport à intervalles réguliers, soit il perdra son travail et se retrouvera sans moyens de survie. Au fil des chapitres, nous découvrons que les Jésuites ont à leur botte toute une série de personnages, pas forcément religieux, qui vont espionner ou faire pression, des voisins, des patrons, des médecins, etc.
Bien avant Hitchcock, Eugène Sue avait compris que le personnage du méchant est le plus important d’une telle œuvre. Alors, à la tête de son complot, il a placé l’abbé-marquis d’Aigrigny. Personnage abject manipulant tout le monde dans l’ombre, on le voit, lors de sa première apparition, préférer s’occuper de son complot et du bien-être de l’organisation, que d’aller voir sa mère mourante qui le supplie de venir à son chevet. Lui et son « secrétaire », le très ambitieux M. Rodin, apparaissent toujours là où il y a une victime à manipuler ou un personnage à convaincre.
Et ce complot, quel est-il précisément ?
La première partie du roman nous présentait des jumelles possédant un étrange médaillon. Sur ce bijou figure une inscription fixant un rendez-vous au 13 février 1832 à une certaine adresse parisienne.
La deuxième partie du roman, très brève, nous explique ce qui arrive avec plus de précision, tout en ouvrant l’action du Juif errant pour y englober de nombreux personnages dans des lieux très divers.
Ce médaillon est distribué aux descendants d’une même famille, une famille dont les ancêtres protestants avaient dû fuir la France peu avant la révocation de l’Édit de Nantes. Les descendants sont donc priés de se retrouver ce fameux 13 février à l’adresse citée, et, d’après ce que l’on comprend, ceux qui seront présents recevront une forte somme d’argent.
L’objectif du complot jésuite fomenté par le perfide abbé-marquis d’Aigrigny (avec son secrétaire particulier M. Rodin) consiste à empêcher les membres de cette famille, dispersés de par le monde, à se trouver à l’adresse convenue au moment voulu. Ils souhaitent qu’un seul descendant puisse y arriver, un prêtre nommé Gabriel, dont ils contrôlent totalement les faits et gestes, et espèrent ainsi pouvoir toucher seuls l’intégralité du trésor familial.
Le roman va alors se dérouler dans différents pays. Chaque partie va alors poursuivre un double objectif : présenter un nouveau personnage et faire avancer l’action. Dans la partie deux, nous découvrons les deux méchants principaux et le complot, alors que la partie trois nous entraîne sur l’île de Java à la rencontre d’un prince indien, etc.
Si Eugène Sue diversifie les décors et les personnages, jamais il ne perd de vue l’unité du roman. Certes, les contraintes du roman-feuilleton vont l’inciter à multiplier les incidents et les événements, à faire se croiser les trajectoires individuelles, à faire voyager son lecteur, à parcourir toutes les couches sociales de la France des années 1830, mais Le Juif errant conserve une unicité d’action remarquable. Tout ce qui arrive est directement lié à ce complot initial, que ce soit pour le poursuivre ou pour le contrecarrer.
Car si une organisation de l’ombre cherche à emprisonner les personnages pour les empêcher d’être au rendez-vous, il semblerait qu’une force opposée fait tout pour favoriser la tenue cette rencontre. Là aussi, Eugène Sue sait entretenir une part de mystère : comment Dagobert et les deux jumelles ont-ils été libérés de la prison de Leipzig ? Comment plusieurs personnages se sont-ils retrouvés dans le même bateau en partance pour la France ? Et tout cela alors qu’un seul personnage semble au courant de l’enjeu de cette affaire (sans pour autant soupçonner l’existence du complot).
Le Juif errant se transforme alors en un immense roman d’aventures : poursuite d’une secte d’assassins à Java, prêtre missionnaire crucifié en Amérique, naufrage et tentative de sauvetage des naufragés, l’action est permanente.
[article à retrouver sur LeMagDuCiné]
Troisième épisode
Cet épisode, qui s’étend jusqu’à la partie 11, qui correspond à la moitié du roman, pourrait s’intituler 13 février. En effet, c’est là que l’on atteint cette date fatidique si importante depuis le début du roman, et que l’on apprend la teneur de ce mystérieux héritage et tous les enjeux qui lui sont liés.
Cette date structure vraiment le roman depuis ses premières pages. Chaque partie commence par un rappel chronologique, se situant donc par rapport à ce fameux 13 février en un compte à rebours qui entretient le suspense. Le rendez-vous fixé en cette date détermine les mouvements des personnages : c’est pour être à Paris le 13 février que Dagobert et les jumelles quittent la Sibérie, que Djalma part d’Asie et Gabriel d’Amérique. C’est l’approche de cette date qui pousse l’abbé d’Aigrigny à mener son complot visant à emprisonner les différents héritiers. Symboliquement, la partie consacrée à ce rendez-vous est fixée au milieu du roman, coupant l’oeuvre en un avant et un après-13 février.
Bien entendu, nous ne dévoilerons rien ici de ce qui se déroule dans cette longue partie, mais le résultat est à la hauteur des attentes. Cette partie est pleine de suspense et de rebondissements, riche en émotions.
« Il n’y a pas d’ennemi plus implacable qu’un mauvais prêtre »
En plus d’être un grand roman d’aventures et de suspense, Le Juif errant est un roman que l’on pourrait qualifier d’engagé. A bien des moments Eugène Sue se réserve le droit d’écrire des paragraphes où il expose clairement ses idées en matière de politique ou de religion.
La religion constitue, bien entendu, une part essentielle du roman, puisque les « méchants » appartiennent à la Compagnie de Jésus. Sur ce sujet, Sue fait une distinction importante entre des églises constituées qui enferment les gens dans un dogme strict, et la spiritualité personnelle et sincère des personnages.
Les jésuites représentent ce que Sue semble détester dans une religion : ils divisent les personnes selon leurs croyances, misent sur la culpabilité des fidèles pour les manipuler, attisent les haines et les intolérances. Ces religieux agissent non pas dans le but de développer la spiritualité, mais pour obtenir un pouvoir financier et une influence politique.
Face à cela, Sue met en scène des personnages qui ne sont pas des croyants fidèles ; certains mêmes, comme Dagobert, ont combattu contre des prêtres, et sont prêts à recommencer ; d’autres sont des croyants, sans pratiquer dans le cadre d’une religion précise. Quasiment tous sont considérés comme des incroyants, voire des mécréants, par les religieux traditionnels. Et pourtant, leur comportement est clairement empreint d’une charité qui en fait des figures christiques. Agricol (fils de Dagobert), la Mayeux, et même la très libérée Adrienne de Cardoville sont sans cesse guidés par leur rejet de l’injustice sociale et l’amour de leur prochain.
Et lorsque certains de ces personnages sont bel et bien pratiquants dans une église (c’est le cas de Françoise, la femme de Dagobert, et de leur fils adoptif Gabriel), ils en viennent à prendre conscience de la manipulation dont ils font l’objet et cherchent à s’en libérer.
"Le travail auquel le pauvre est obligé de demander son pain devient
souvent un long suicide"
L’aspect politique et social occupe une grande place également, une place de plus en plus importante au fil du roman. Par ses descriptions, mais aussi par ses propos directement politiques, Eugène Sue prend la défense des plus faibles, des plus misérables, dans une société française décrite comme injuste.
Ces considérations se font toujours au détour d’un chapitre, au fil de l’action. Ainsi, la présentation des personnages de Françoise et de la Mayeux permet à Sue de faire la description de la vie difficile des ouvrières parisiennes, et de réclamer plus de justice sociale à leur égard.
L’internement forcé d’un personnage est l’occasion de faire tout un topo sur la situation de la médecine psychiatrique.
Sue se scandalise aussi de la situation des plus misérables et appelle vivement à résoudre ce que l’on n’appelait pas encore les « fractures sociales ».
L’auteur va même jusqu’à tenir un discours que l’on qualifierait de nos jours d’« anticolonialiste », affirmant que la colonisation ne peut qu’inciter les peuples colonisés à employer la violence pour retrouver leurs libertés.
Avec une incroyable modernité, l’auteur se lance même dans des discours sur la nécessaire indépendance des femmes par rapport aux hommes, à travers les actions d’Adrienne de Cardoville. La jeune femme, aussi belle que riche, est guidée par le souci de sa liberté : liberté de faire ses propres choix sans avoir à demander l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur, liberté de disposer de ses biens, mais aussi de son corps comme elle le souhaite, liberté de vivre seule même si cela offusque les tenants d’une société traditionaliste, etc.
Presque 180 ans après la publication du roman, les thèmes abordés par Eugène Sue résonne toujours dans l’actualité politique et sociale.
[article à retrouver sur LeMagDuCiné]
Quatrième épisode
Attention, cet épisode contiendra des révélations (divulgâchages) sur les épisodes précédents.
Nous voilà donc après le 13 février, date donnée comme le terminus potentiel de l’action, et dont la description constitue un des sommets du roman. Mais voilà : la somme faramineuse de l’héritage est dévoilée, le complot est connu, et la date fatidique est repoussée de plusieurs mois, jusque début juin. Nous sommes alors pile à la moitié du roman. Comment faire rebondir l’action pour occuper les 800 pages restantes ?
Le procédé est finalement simple : on fait la même chose, mais un peu différemment. L’idée principale consiste à changer le méchant. L’abbé d’Aigrigny est écarté pour incompétence et remplacé par celui qui était alors son « secrétaire », le très ambitieux et très sombre M. Rodin. Et puisque le complot visant les héritiers de la famille Rennepont est dévoilé, il va s’agir désormais de les écarter de la succession sans en avoir l’air ; mieux : de les mener dans un tel état psychologique et moral qu’ils n’y songeront même plus, ou n’en voudront plus.
Partant de ce principe, Rodin va se faire accepter comme l’ami de ses victimes : il libère Adrienne de sa chambre à l’hospice, il libère les jumelles de leur couvent, il dénonce publiquement les méfaits de l’abbé d’Aigrigny, etc. En bref, il devient l’homme providentiel, celui qui va gagner la confiance des protagonistes, etc. Ce qui ne l’empêchera pas d’agir dans l’ombre : il place des hommes et des femmes à sa botte auprès des victimes, il déclenche des incidents (voire des incendies), mais tout en ayant l’air de déplorer tout cela et en se proposant pour aider les personnages et leur donner de bons conseils. En bref, le bon Samaritain par excellence.
Une seule personne se doutera de tout ce qui se manigance, et l’un des intérêts de cette seconde moitié de roman consiste à savoir ce qui va lui arriver.
Plus que jamais, Rodin est présenté comme celui qui dévoie la religion à des fins personnelles. Ses ambitieux ne sont pas cachées : il veut devenir pape, rien de moins. Le tout pour imposer une vision rigoriste et inhumaine du christianisme, mais aussi employer la fortune de cet héritage afin de s’assurer la domination sur le pouvoir séculier en France (n’hésitant pas à prévoir de renverser ce pouvoir qu’il juge immoral). Tout au long de cette seconde moitié du roman, Rodin va développer toute une philosophie, attribuée par Sue à l’ensemble de la Compagnie de Jésus, qui rejette la liberté individuelle au nom d’une soumission à l’ordre moral et ecclésiastique. Les « méchants » jésuites veulent transformer leurs adeptes en « cadavres », en marionnettes ne pouvant qu’accepter docilement et mécaniquement d’être dominés corps et âme.
Face à cela, Eugène Sue fait développer, par plusieurs de ses personnages, une philosophie de l’humanisme, de la bonté, de la charité. Ce qui est intéressant, une fois de plus, c’est que cette philosophie de la générosité, la liberté et la tolérance est acceptée aussi bien par des laïcs que par des religieux, par des athées et par des fidèles pratiquants. On trouve deux exemples de ces utopies au fil du roman.
D’abord, un des héritiers présomptifs, François Hardy, dirige un atelier qu’il transforme en lieu de vie pour ses ouvriers. Au milieu de ce XIXème siècle où les conditions de vie et de travail des ouvriers étaient aussi pénibles, M. Hardy bâtit autour de son atelier tout un lieu où les ouvriers et leurs familles vivent en communauté. Habitation, cantine commune, école pour les enfants, lieu de partage du travail, tout y est fait pour le bien-être qui, finalement, est indispensable à la production d’un travail de qualité. Sue, dans un de ses commentaires qui ponctuent l’oeuvre, précise :
« Entreprendre une chose belle, utile et grande ; douer un nombre considérable de créatures humaines d’un bien-être idéal, si on le compare au sort affreux, presque homicide, auquel elles sont presque toujours condamnées ; les instruire, les relever à leurs propres yeux ; leur faire préférer aux grossiers plaisirs du cabaret, ou plutôt à ces étourdissements funestes que ces malheureux y cherchent fatalement pour échapper à la conscience de leur déplorable destinée ; leur faire préférer à cela les plaisirs de l’intelligence, le délassement des arts ; moraliser, en un mot, l’homme par le bonheur ; enfin, grâce à une généreuse initiative, à un exemple d’une pratique facile, prendre place parmi les bienfaiteurs de l’humanité, et faire en même temps, pour ainsi dire forcément une excellente affaire… ceci paraît fabuleux. » (Partie 14, chapitre 2)
Un autre exemple de ces projets désirés par Sue et dont le but est de faire le bien de l’humanité, se trouve dans le testament de l’ancêtre des protagonistes, celui qui est à l’origine de l’héritage. Cet homme voulait que cette somme considérable soit employée à fonder une organisation de charité qui ferait le bien autour d’elle. Le but est de contrecarrer l’influence néfaste des jésuites, qui cherchent à détruire la liberté et la volonté des gens ; pour cela, M. de Rennepont veut une association qui favorise le bien-être, la liberté, l’éducation, en un mot l’émancipation des individus :
« Si une association perverse, fondée sur la dégradation humaine, sur la crainte, sur le despotisme, et poursuivie de la malédiction des peuples, a traversé les siècles et souvent dominé le monde par la terreur… que serait-ce d’une association qui, procédant de la fraternité, de l’amour évangélique, aurait pour but d’affranchir l’homme et la femme de tout dégradant servage ; de convier au bonheur d’ici-bas ceux qui n’ont connu de la vie que des douleurs et la misère ; de glorifier et d’enrichir le travail nourricier ; d’éclairer ceux que l’ignorance déprave, de favoriser la libre expansion de toutes les passions que Dieu, dans sa sagesse infinie, dans son inépuisable bonté, a départies à l’homme comme autant de leviers puissants ; de sanctifier tout ce qui vient de Dieu… l’amour comme la maternité, la force comme l’intelligence, la beauté comme le génie ; de rendre enfin les hommes véritablement religieux et profondément reconnaissants envers le Créateur, en leur donnant l’intelligence des splendeurs de la nature et de leur part méritée des trésors dont il nous comble ? »
Honnêtement, il est difficile de relancer l’action et l’intérêt des lecteurs après le sommet de tension dramatique, de suspense et de retournements de situation qu’a constitué la partie précédente. L’action se traîne un peu, d’autant plus que l’on a du mal à voir où veut en venir réellement Rodin. De plus, on n’échappe pas à un sentiment de répétition : la première moitié était consacrée à un complot qui a grandi et a abouti à ce 13 février ; et maintenant, on a l’impression de se retrouver dans une situation identique, avec une date butoir repoussée au 1er juin et un maître du jeu plus pervers, plus retors. Il faut un certain nombre de pages pour que l’intérêt revienne.
[article à retrouver sur LeMagDuCiné]