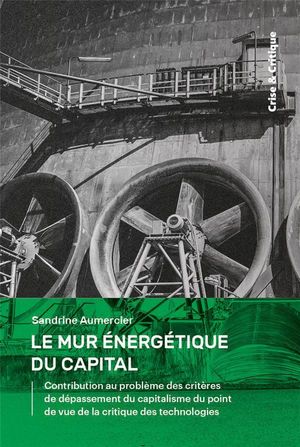Sandrine Aumercier se montre avec cet ouvrage comme prenant part à la pointe avancée de la critique du capitalisme et de ses différents avatars. Loin de proposer une critique séparée du type que l’on rencontre le plus souvent dans l’écologisme, son approche est globale, reprenant pour la prolonger en l’époque présente le meilleur de la pensée critique développée par Marx en son temps. Aucune tendance dogmatique en ce livre qui tout au contraire tend à dévoiler tout un ensemble d’illusions complaisantes sur ce que pourrait être le dépassement effectif du libéralisme marchand. Au centre de ces illusions, celle consistant à croire que l’on pourrait reprendre et détourner au profit d’une société émancipée une grande part des technologies issues du capitalisme et des catégories de son mode de production. « Il ne s’agit pas d’élaborer un examen abstrait et presque nostalgique de ce qui « vaudrait la peine » d’être conservé, mais de considérer les limites intrinsèques que pose l’instauration d’un autre rapport social. »
Autrement dit, les productions marchandes de tous ordres du capitalisme sont bien les fruits de son mode de fonctionnement : destructions massives des ressources naturelles, extractivisme mondialisé, déforestation aveugle avec expulsion brutale des populations locales, maintien d’un travail abstrait toujours plus aliénant et inégalités croissantes, externalisation du productivisme industriel vers des pays à régimes totalitaires (néo-colonialisme), centralisation étatique avec contrôle bureaucratique des populations dans les zones dites avancées. Bref, rien qui puisse laisser envisager sérieusement une forme sociale organisationnelle émancipée où chacun trouverait librement sa place.
« Il ne suffit pas de couper le robinet de la valorisation de la valeur pour que le génie rentre dans la bouteille et que nous bénéficions tout à coup des meilleurs résultats scientifiques, tout en écartant les pires. » Il nous faut plutôt « examiner les conditions de possibilités techniques définies par une organisation sociale déterminée. »
Cela oblige donc « à remettre en question certaines évidences propagées chez les écologistes – plus soucieux de définir des seuils ou d’introduire des régulations que de viser les catégories de ce mode de production. »
Il convient donc si l’on veut effectivement se défaire du capitalisme de comprendre « que cette libération ne dépend pas des services et des machines disponibles à une époque donnée mais de ce qu’une société libérée est capable d’atteindre sans menacer sa liberté. »
Par exemple, « une société libérée n’irait pas spolier ailleurs les ressources qu’elle ne trouve pas chez elle. »
« Le système fabrique donc ses moralistes de service, qui d’ailleurs n’obtiennent rien de leurs exigences. »
Il ne s’agit pas de promouvoir une « austérité morale – du genre de la simplicité volontaire - car l’austérité qui s’annonce découle en fait du champ de ruine laissé par la modernité elle-même, qui a sapé méthodiquement des milliards de temps de vie, l’accès libre aux biens communaux, l’abondance des ressources terrestres accumulées depuis des millions d’années et jusqu’au sens d’un vivre-ensemble qui ne serait pas déterminé par la marchandise. »
« L’émancipation ne sera certainement pas atteinte sans un vaste conflit social, mais c’est de manière très pragmatique qu’elle peut dès maintenant être opposée aux tenants de la valeur-travail et de la fuite en avant technologique : qu’ils aillent eux-mêmes creuser dans les mines ou enfouir les déchets nucléaires dans leur propre cave ... » Etc.
Un livre extrêmement dérangeant donc, non seulement pour les souteneurs du capital mais aussi pour tous ceux qui s’imaginent et prétendent encore pouvoir tout changer sans changer grand-chose à leurs petits avantages et conforts particuliers.