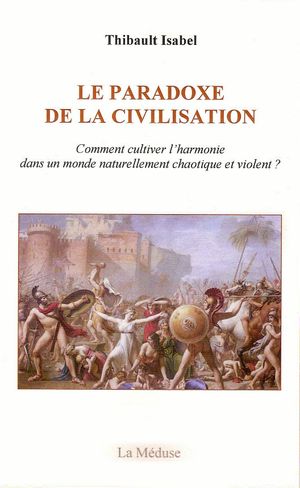Thibault Isabel est un penseur perplexe et hésitant. Il perçoit avec netteté et franchise tout ce que le monde comporte d'injustice, de violence, de cruauté. Pourtant, contrairement à la plupart de nos contemporains, il ne se contente pas de ce sentiment misérabiliste pour bâtir, par opposition, des idéaux mièvres et irréalistes, qu'on serait tenu de faire advenir dans l'optique d'un progrès permanent de l'espèce humaine. Plutôt que de postuler la médiocrité de l'existence pour chercher dans les songes une idylle qui lui serait opposée, il prend le parti de prendre le réel pour ce qu'il est, et de comprendre pourquoi il est. Le monde n'est pas mauvais en soi ; qui ne voit que le mal ne voit qu'une partie de la réalité. Or, pour Thibault Isabel, que l'on sait irrigué par l'enseignement taoïste, la vérité est multiplication des perspectives ; puisque nous sommes tous borgnes, nous ne pouvons, n'en déplaise à Descartes, nous contenter de notre seule subjectivité pour appréhender la vérité de l'Être...
C'est avec ce regard porté sur le monde que Thibault Isabel entame son enquête sur la civilisation, dans une démarche très fortement influencée par Jacob Burckhardt et Friedrich Nietzsche. Celle-ci se réalise à travers douze essais, qui permettent d'éclairer progressivement la notion de civilisation telle que l'entend Isabel, d'en cerner les mécanismes et les limites. Le sommaire du livre est sans doute nécessaire pour en comprendre la portée et la démarche.
Introduction
Première Partie – Le lien social dans ses rapports avec le désir d’agression
Essai I. – Naturalité et culturalité de la violence
Essai II. – Violence et civilisation
Deuxième Partie – La moralisation du comportement en Chine ancienne
Essai III. – Guerre, justice et pouvoir dans la Chine archaïque et classique
Essai IV. – Le devoir confucéen de vendetta
Essai V. – La civilisation progressive des mœurs dans la pensée de Maître Xun
Troisième Partie – Hommes et femmes, piliers de la civilisation
Essai VI. – La guerre des sexes, entre paternalisme et maternage
Essai VII. – Domination masculine et résistance du féminin: les sphères publique et privée à travers les âges
Quatrième Partie – L’héroïsme tragique: un horizon pour surmonter l’absurde
Essai VIII. – Jacob Burckhardt, penseur de la civilisation
Essai IX. – Le sport, de l’Antiquité à nos jours : métamorphoses et permanence de l’homme agonal
Cinquième Partie – La politique comme mode d’articulation de l’Un et du Multiple
Essai X. – La dialectique de l’individuel et du collectif dans l’œuvre de Proudhon
Essai XI. – Militarisme et patriotisme chez les socialistes français du XIXe siècle:la promotion d'un internationalisme vitaliste et enraciné
Essai XII. – Georges Sorel et la morale révolutionnaire: une étude des réflexions sur la violence (1908)
On est tout de suite saisi par la richesse et la variété des thématiques abordées. C'est que, Thibault Isabel, contrairement à nombre de penseurs et de philosophes, ne bâtit pas son discours sur du vent, sur du « peut-être » ou sur du « pourquoi pas » ; toute sa réflexion s'appuie sur des études scientifiques, touchant par ailleurs à plusieurs disciplines : anthropologie, psychologie, histoire, sociologie, histoire des idées ou éthologie. Or, ce que l'on constate, et qui est insupportable aux oreilles chastes de nos pauvres occidentaux mièvres et sensibles, c'est que l'homme ne peut pas être tout et n'importe quoi : il s'inscrit dans une naturalité contraignante, dont il ne peut se défaire totalement.
Kant entendait promouvoir une paix universelle et perpétuelle ; nous l'avons suivi dans ses songes. Mais le problème n'est même pas d'abord de savoir si la réalisation complète d'un tel rêve est possible. Le problème est de savoir si un tel rêve est seulement souhaitable, et s'il s'accorde avec la nature — celle du monde et la nôtre. On s'attache parfois à des ambitions immenses qui accouchent d'une souris (...). En d'autres circonstances, cependant, on se laisse plutôt attirer par le chant des sirènes (...). Il est en somme deux sortes d'utopies : les unes gagnent à être recherchées et réalisées partiellement, même si elles ne peuvent s'incarner en intégralité, tandis que les autres nous égarent. Le mythe de l'extinction de la violence a peut-être été la sirène du monde occidental...
Voilà le point de départ. L'homme est un animal, une bête née dans la nature. Mais la nature n'est pas l'idylle joyeuse et tranquille que l'on se plaît bien souvent à se représenter (sans, d'ailleurs, jamais y avoir mis les pieds) ; elle est violente, cruelle et hostile (bien qu'également riche et généreuse). Comme tous les animaux, l'homme est naturellement violent : l'ordre social poursuit précisément le but de réguler les tensions entre être humains.
Cette idée célèbre a été énoncée par la plupart des théoriciens de l'État (...). Pourtant, leur thèse appelle un profond paradoxe.
Il n'est probablement pas exagéré de dire, en effet, que c'est par la violence que l'ordre social peut s'établir, et non en s'affranchissant d'elle. Le processus de civilisation ne s'amorce pas (...) quand un groupe d'hommes et de femmes lassés de voir les individus s'entredéchirer, au sein de leur communauté chaotique et sauvage (...), décident de renoncer à tout acte violent pour instaurer une ère de paix. (...) Il semble plus crédible d'estimer que, dans la majeure partie des cas, la civilisation se développe lorsque les désirs de puissance individuels et communautaires aboutissent à la suprématie d'un homme ou d'un clan, et que l'instance supérieure ainsi établie instaure un ordre fondé en autorité sur son prestige et son pouvoir, contraignant tous les sujets à une régulation durable de leur comportement. (...) Cette ascension impose de ce fait à l'ensemble de la société un cadre raffermi, qui oblige les personnes soumises à ronger leur frein, et, grâce à cette discipline normalisée, se forge une meilleure capacité d'autocontrôle, une plus grande rigueur dans l'esprit et dans la conduite, qui, ensuite, peut éventuellement réinstaurer l'ordre sur des bases assumées et choisies : on passe ainsi de la tyrannie à une véritable assemblée politique de citoyens. (...)
On dira en cela qu'une société est barbare à mesure que ses membres recourent entre à une violence non canalisée, et qu'elle se civilise à mesure que la violence est circonscrite à l'intérieur de limites préétablies, assumées par tous.
Il ne s'agit cependant pas d'un processus linéaire, partant des peuples primitifs barbares au civilisations modernes, qui auraient atteint quelque aboutissement. D'ailleurs, pour Isabel, les primitifs peuvent s'avérer plus civilisés que nous ; ayant vécu la plus grande partie de ma vie au contact de tels peuples, je ne peux que tomber d'accord. À bien des égards, nos asociaux métropolitains s'avèrent être de véritables sauvages...
Pour appuyer sa thèse, Isabel invoque l'éthologie afin d'établir une comparaison avec le monde animal. Voilà un sain réflexe qui devrait se généraliser lorsque l'on questionne l'homme ! Isabel en conclut essentiellement que des mécanismes similaires s'opèrent chez les animaux sociaux, desquels nous ne différons, dans notre qualité d'êtres civilisateurs, vraisemblablement plus en efficacité qu'en nature.
Ce constat a bien des allures pessimistes. Pourtant, pour Isabel, ce serait ne voir là qu'une facette des choses.
Quel paradoxe de constater que la pacification sociale repose en son fond sur la violence ! L'homme aspire à la paix pour se préserver de ses semblables, violents comme lui, et c'est encore par la violence que cette paix se réalise ; (...) l'homme ne peut pas ne pas être violent : il lui est simplement permis de l'être d'une façon plus ou moins élevée, et le sentiment le plus noble qu'il puisse éprouver est la « volonté d'harmonie », qui témoigne du besoin d'organiser et de raisonner la lutte entre pairs. Ce n'est pas la violence qui est mauvaise ou barbare, car il est tout à fait possible de l'humaniser. La barbarie et la bestialité résident dans l'absence de structuration. La « paix », pour sa part, n'est qu'une forme civilisée de violence. (...) Ici-bas, rien ne se produit sans conflit.
Ce raisonnement aboutit à cette conséquence excessivement lucide, que nous aurions tout intérêt à méditer : « vouloir une paix d'un autre genre livrerait le monde à la sauvagerie ; malgré les professions de foi et les paroles sentimentales, la déstructuration gronderait, car rien ne viendrait réellement encadrer le flux bouillonnant de l'existence. »
Isabel poursuit son raisonnement en reprenant à son compte la thèse de Norbert Elias, le fameux historien des mœurs qui analyse, dans le développement progressif des règles de politesse à partir du Moyen Âge, une rigidification des comportements à mesure que l'État accroît son monopole de la violence : les individus ne pouvant plus répondre à l'insulte par eux-mêmes se disciplinent petit à petit. Mais, revers de la médaille, ils deviennent dans le même temps de plus en plus sensibles aux menaces physiques ; nous allons aujourd'hui toujours plus loin dans cette démarche, ce qui peut poser problème : en découle la peur excessive pour la mort (dont le végétarisme ou le véganisme sont des avatars assez jusqu’au-boutistes), pour le corps, pour la saleté, et tout leur cortège d'angoisses inutiles.
Mais Isabel rappelle l'importance de Freud dans le développement des thèses d'Elias. Pour Freud, l'enfant se construit en tant qu'adulte en passant d'un état où il est incapable de contrôler ses pulsions à un état où, grâce à l'action du Père qui l'arrache à la Mère, l'enfant intègre des normes sociales qui lui permette de dépasser son égoïsme spontané et d'orienter ses pulsions vers ce qui est autorisé par la société, de façon à l'intégrer harmonieusement à celle-ci. C'est ce en quoi consiste le processus de civilisation. Mais la civilisation est menacée par deux excès qui correspondent aux deux états susmentionnés, l'un étant associé à l'univers symbolique de la Mère, et l'autre à celui du Père.
D'abord, le narcissisme, qui se caractérise par une incapacité à contrôler ses pulsions ; il se manifeste soit par une résurgence incontrôlée de l'égoïsme et de la violence, soit au contraire par l'impossibilité de faire face à celle-ci, ce qui forme un comportement qui tend à l'abandon dans le mièvre, dans les idéaux rassurants mais utopiques, avec tout cet excès de douceur et de sensibilité, de compassion misérabiliste... L'autre excès, la névrose, donne des individus coincés, excessivement rigides, soumis aisément à des angoisses démesurées et infondées, qui sont incapables de faire quoi que ce soit en-dehors de normes strictes pour déterminer les contours de leurs actes.
Avec le développement du capitalisme, on a développé un type anthropologique névrotique, afin de permettre la mise en place de l'appareil productif et le dressage d'un troupeau de prolétaires dociles. Depuis les années 1960, en partie parce qu'il fallait stimuler la consommation dans un contexte de sur-production, nous refluons dans le narcissisme, dans l'absence de répression des affects... ce qui n'est pas sans poser problème pour les patrons ! La tendance, tout du moins, est parfaitement bien illustrée par les injonctions contraires du don de soi dans le cadre de l'entreprise, et le culte jamais inégalé de l'hédonisme, du mièvre, de la douceur, d'une bienveillance envahissante et excessive, qui donne notamment lieu à ce très curieux comportement qui consiste à se couver littéralement les uns les autres entre amis... A contrario, la violence fait une irruption brutale dans nos sociétés depuis une trentaine d'années (quand bien même n'a-t-elle rien à voir avec ce qui était la norme il y a plusieurs siècles ; précisément n'y sommes-nous plus habitués), et l'on observe sans mal des comportements de violence gratuite, chez les CRS par exemple, ou parfois chez les « jeunes de cité » qui, au-delà du contexte social qui est le leur, admettent sans trop de problèmes chercher l'embrouille simplement pour s'amuser, mais aussi chez les élites dans le cadre du « crime en col blanc ».
Outre l'État, les religions monothéistes et les grandes métaphysiques ont joué un rôle important dans l'intériorisation massive des comportements civilisés, en ce qu'elles condamnent radicalement la violence et entendent la supprimer. La démarche s'articule sur un refus du monde tel qu'il est, une détestation pour la nature, une volonté de la mettre au pas — ou bien de fuir dans l'au-delà, dans l'absolu, grâce à des pratiques ascétiques. Mais voilà bien le problème : ce dualisme donne lieu à une négation de notre naturalité et du monde dans lequel nous vivons de façon contrainte. Un tel raisonnement, fondé sur des opposés inconciliables, où l'un est absolument meilleur que l'autre, ne peut qu'instaurer un ordre social instable, qui oscille dangereusement d'un excès à un autre.
Partant de ce constat, Thibault Isabel propose une autre lecture du monde, fondée sur l'harmonisation des contraires opposés. L'homme narcissique vit dans une crainte permanente du manque (symboliquement, des soins apportés par la Mère), d'une façon qui l'empêche d'accepter la dureté et le tragique de la vie. À l'inverse, l'homme névrotique, qui vit constamment dans la menace du Père qu'il n'a pas su surmonter, est incapable de s'accomplir, en ce qu'il se sent coupable dès qu'il peut jouir de la vie — comme s'il jouissait de la Mère interdite. Fort heureusement, entre ces deux excès se détermine une troisième voie, une « voie de la maturité ». L'adulte ayant parfaitement intégré la menace du Père n'oriente plus ses pulsions vers ce qu'il ne peut avoir : au contraire, il les met au service d'un processus civilisateur de création.
L'homme créateur se met donc en quête de ce qui, dans l'existence, mérite d'être exploré. Son désir n'est pas éteint, et les motifs de violence, d'agression, ne sauraient non plus lui manquer ; pour qui veut agir sur les choses, le combat contre l'adversité est une épreuve nécessaire. Mais la violence de l'homme civilisé n'est pas comme celle du barbare ; elle est ciblée, assujettie à des objectifs précis et raisonnables. Dans ce processus, on assiste à une sublimation du Ça. Cette sublimation ne doit pas être entendue au sens de Freud, comme détournement de l'affectif initial vers une expression purement imaginaire ; elle désigne plutôt un raffinement des pulsions, qui se trouvent intégrées dans une vision organisée du monde. La sublimation est spiritualisation de l'énergie vitale brute, lorsque le Surmoi structure, mais prend garde à ne pas réprimer.
On voit que le refus de céder aux irénismes modernes ne conduit pas, chez Thibault Isabel, à l'abandon de tout idéal. Au contraire, il y a dans cette acceptation du monde tel qu'il est, des contraintes et des limites naturelles (si chères aux écologistes — aux vrais écologistes tout du moins), la possibilité pour lui de perfectionner réellement l'homme, de le faire grandir, de le rendre mature. Isabel n'abandonne pas toute idée de progrès, mais redéfinit ce dernier d'une manière radicalement différente. L'homme est capable d'un accomplissement permettant de dépasser sa barbarie spontanée, dans un processus qui structure le monde, lui donne un sens et y insuffle une harmonie. Mais cet accomplissement est perpétuellement remis en question, en ce sens où il repose sur un équilibre précaire qui requiert des efforts importants pour être maintenus. Il ne s'agit pas, en fait, de se fondre dans un ordre naturel fixe : au contraire, Isabel, comme Héraclite ou Lao-tseu, ne conçoit le monde qu'en perpétuel mouvement ; c'est ce mouvement-même qui donne lieu à la violence fondamentale de la vie, que l'on ne peut qu'accepter. Ce n'est, en définitive, pas au monde de se plier à nos exigences arbitraires du bien, comme nous le voulons pieusement aujourd'hui, mais plutôt à nous d'être capables de voir dans le monde tel qu'il est quelque chose de bon.
Bien sûr, il n'aura échappé aux connaisseurs l'influence considérable de Nietzsche dans tout cela, dont Isabel reprend en fait nombre des raisonnements (notamment ceux exposés dans La généalogie de la morale) ; mais il y apporte un siècle de connaissances, une certaine clarté et un peu (plus) de nuances. En poursuivant les analyses de Nietzsche, Isabel parvient à résoudre un certain nombre de contradictions qu'il n'avait pas su démêler clairement.
Je n'ai résumé ici que les raisonnements de la première partie ; les suivantes approfondissent la réflexion en abordant divers thèmes et en précisant certains aspects.
Dans la deuxième partie, Isabel établit un parallèle entre l'histoire de la Chine antique et l'histoire occidentale depuis le Moyen Âge pour ce qui concerne la répression des mœurs. Ce regard par-delà l'Occident est simplement brillant dans le principe : l'étude des autres civilisations ne peut qu'être sain, en ce qu'elle nous permet de relativiser nos propres aspirations émanant de notre culture. C'est d'autant plus vrai que l'idéologie du progrès qui anime notre époque tend à un ethnocentrisme incroyable, dans la mesure où le jugement que nous portons sur le progrès émane directement de nos propres valeurs, de notre propre expérience historique... mais nous l'imaginons universelle. A contrario, cette excursion dans le monde chinois permet d'appuyer la théorie de Thibault Isabel, bien que la civilisation chinoise ait pris une direction à bien des égards radicalement différente de la nôtre (c'est la seule grande civilisation à ne pas avoir adopté massivement une perception dualiste du monde). C'est aussi l'occasion de découvrir la pensée de Maître Xun (IIIe siècle av. J-C), philosophe passionnant très inspirant dans les perspectives développées par Isabel, mais qui a été mis de côté par la tradition chinoise qui le jugeait pessimiste (parce qu'il ne croyait pas l'homme être bon par nature, mais plutôt le devenant grâce à la culture).
La troisième partie, sur les relations entre les hommes et les femmes, est également passionnante. Je ne résiste pas à l'envie d'en dire quelques mots (en espérant rester clair ; je ne garantis rien) — après tout, on ne se lasse jamais se faire traiter de « réac » par de bonnes âmes indignées. Il faut bien dire que Thibault Isabel, concernant cet aspect, en reste sur un constat relativement pessimiste. Pour essayer d'être bref, Isabel, à la suite, entre autres, de Lacan, détermine un ordre symbolique structurant la psyché autour d'un pôle féminin et d'un pôle masculin qui se confondent avec ceux de la Mère et du Père. Ce n'est pas tant pour des causes biologiques (qui ne sont pas cela dit exclues) que se définissent d'une façon toujours semblable le masculin et le féminin, mais plutôt parce que l'enfant y associe très tôt l'image qu'il perçoit de la mère et du père. Au début de sa vie, l'enfant dépend entièrement de sa mère, qui par l'allaitement, lui apporte une jouissance infinie, ainsi que des soins permanents et dévoués. Plus tard, le père sépare l'enfant de la mère afin de structurer ses désirs (cf. plus haut) : le père opère ici une symbolisation du monde, qui passe par l'acceptation des normes sociales, d'une culture.
Dans ce processus, le Père joue un rôle crucial, en ce qu'il permet à l'enfant de devenir adulte, de devenir mature ; sans cet effort de symbolisation, le sujet sombre dans l'abandonnisme, qui se confond finalement assez bien dans le narcissisme décrit plus haut. Mais, pourtant, sans l'apport de la mère, le sujet risquerait une hyper-symbolisation, laquelle reprend les caractères de la névrose. On comprend bien la complémentarité nécessaire des archétypes masculins et féminins dans le développement des personnes et d'une société... Mais, dans la mesure où c'est bien parce que c'est l'autorité du père qui permet l'acceptation de la dureté de la vie, chose bien évidemment nécessaire pour tout être humain, le masculin se voit valorisé au détriment du féminin... parce qu'il vaut mieux, pour une société, valoriser ce que représente le masculin !
Isabel ne renonce cela dit pas à l'idéal de relations harmonieuses entre hommes et femmes, et, d'ailleurs, le processus de civilisation permet lui-même de donner aux femmes une meilleure condition en réfrénant les pulsions masculines. Mais il reste bien dubitatif quant aux effets du féminisme, vis-à-vis duquel il est plutôt critique. Dans les tendances modernes, il voit une réaction à la dureté des relations sociales imposées par la concurrence capitaliste et le salariat, où l'employé est déconnecté d'un univers social quotidien qu'il est en mesure de maîtriser (coupé de son foyer et, de ce fait, du domaine du féminin) ; pour faire très bref, on a sur-investi le féminin, à partir de la fin du XIXe siècle, dans l'espoir de contrebalancer l'excessive violence des rapports sociaux capitalistes, ce qui a donné lieu au modèle de la femme au foyer. Mais ce faisant, l'on a séparé radicalement les hommes des femmes, d'une façon finalement peu satisfaisante (les femmes étant simplement mises de côté, destinées à s'ennuyer toute la journée dans leur résidence pavillonnaire), avant de vouloir les confondre dans l'indifférenciation, dans l'espoir que le salariat des femmes réglerait le problème. Mais l'indifférenciation des sexes ne permet pas plus que leur séparation radicale l'harmonisation des archétypes féminin et masculin.
Si la condition féminine s'est jusqu'à un certain point améliorée, aujourd'hui, ce n'est pas en soi parce que les femmes ont pu accéder en masse au travail rémunérateur, comme la gent masculine, mais parce que le regard porté sur elles est certainement plus respectueux qu'en d'autres temps, qu'on leur concède dans tous les domaines une véritable responsabilité morale et civique et qu'elles ont le droit de participer à des activités actuellement considérées comme estimables. Le reste tient purement et simplement aux fantaisies de l'époque.
En somme, tout n'est pas si négatif. Mais nous ne prenons pas la bonne voie. Il est temps de réfléchir sérieusement à harmoniser le monde féminin et le monde masculin, plutôt que de vouloir frénétiquement imposer l'un plutôt que l'autre, ou effacer l'un et l'autre dans un idéal d'indifférenciation sensé effacer les tensions.
Les autres essais reviennent sur la pensée de Burckhardt concernant le processus de civilisation, ainsi que sur le rôle du sport dans la manifestation d'un idéal de perfectionnement humain dans la lutte (ce qui donne lieu à un véritable éloge du football !) Enfin, il procède à quelques incursions dans la pensée socialiste, notamment celle de Proudhon, chez qui il voit des fondements au développement d'une théorie politique permettant de concilier l'accomplissement de l'individu au sein d'une collectivité dont il fait partie, alors que les régimes modernes n'ont fait que privilégier l'un au détriment de l'autre. Une société, en somme, permettant aux hommes de devenir matures et responsables, de se perfectionner.
C'est, comme la longueur de cette critique en atteste, un livre riche et particulièrement fourni, qui aborde un nombre considérable de thèmes, avec une pertinence et une lucidité tout simplement brillantes. Un livre passionnant et original qui rénove un effort de pensée qui a tendance à effrayer aujourd'hui : une pensée de la civilisation, une pensée du perfectionnement de l'homme.