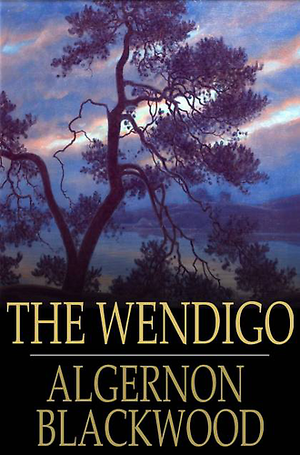Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2019/11/le-wendigo-d-algernon-blackwood.html
Je sais, cette grogne est récurrente, mais, décidément, cela me sidère que l’œuvre d’Algernon Blackwood soit devenue peu ou prou indisponible en français – avec la seule exception de l’excellent recueil de nouvelles L’Homme que les arbres aimaient chez L’Arbre Vengeur. Le reste ? Zobi ! Les recueils publiés dans les années 1960-1970 en « Présence du futur » ont disparu, de même que le John Silence de Rivages/Noir.
Vous me direz que le recueil de L’Arbre Vengeur, précisément, emprunte à tout cela, et c’est tout à fait exact : à vrai dire, j’y avais déjà lu des deux des cinq nouvelles figurant dans le présent recueil titré Le Wendigo (cinq nouvelles, oui, car, pour quelque raison, « Complice par omission » ne figure pas dans la table des matières, mais bien dans le recueil, entre « La Danse de mort » et « Passage pour un autre monde »). En l’espèce, ces nouvelles étaient, eh bien, « Celui que les arbres aimaient… », et « Passage pour un autre monde ». Je les avais adorées à l’époque, surtout la première, et je les adore toujours aujourd’hui, peut-être davantage encore en fait.
Mais si « Complice par omission » et « La Danse de mort », récits bien plus courts, impressionnent bien moins, sans déplaire, le présent recueil est encore tiré vers le haut par sa longue nouvelle titre – car « Le Wendigo » est à bon droit un des plus fameux contes macabres d’Algernon Blackwood, souvent considéré (par des gens comme H.P. Lovecraft himself) comme faisant partie du sommet de sa production littéraire, avec « Les Saules ». D’ailleurs, la postérité pseudo-lovecraftienne de ce superbe récit est encore renforcée par les emprunts et références des compères et disciples du gentleman de Providence, Clark Ashton Smith pour le meilleur… et, oui, August Derleth pour le pire, dont les médiocrités, au mieux, consacrées à son Ithaqua, puisaient largement mais sans adresse dans « Le Wendigo » de Blackwood.
Mais la parenté avec Lovecraft va au-delà, de manière moins ouverte mais autrement séduisante – et c’est la propension d’Algernon Blackwood à imprégner ses textes de ce que l’on qualifierait d’ « horreur cosmique », ou du moins d’un sentiment proche, mais en mettant en scène une nature sauvage aussi belle qu’inquiétante, attirante et terrifiante, majestueuse et menaçante. Même sans faire appel au cosmos, à l’infinité dans le temps comme dans l’espace, Blackwood situe des hommes insignifiants dans un cadre sauvage immémorial et loin de tout, et qui les ramène toujours à leur insignifiance, aussi l’effet produit sur le lecteur est-il peu ou prou le même, ai-je l’impression.
Des cinq nouvelles de ce recueil, seule « La Danse de mort » ne joue absolument pas de ce thème. Mais s’il demeure relativement discret dans « Complice par omission » et, un peu moins, dans « Passage pour un autre monde », il est au premier plan dans « Le Wendigo » aussi bien que dans « Celui que les arbres aimaient… », deux longs récits qui constituent à eux seuls plus des deux tiers de ce volume. Ce qui suscite d’ailleurs des échos rappelant d’autres recueils : « Les Saules », bien sûr, joue à fond de ce thème, mais aussi « Le Camp du chien », liste absolument pas du tout exhaustive.
On a pu dire qu’il y avait quelque chose de panthéiste dans la conception blackwoodienne de la nature, et c’est très possible. Au passage (pour un autre monde…), le tempérament mystique de Blackwood le distinguait pour le coup de Lovecraft, assurément : il ne s’agit évidemment pas d’assimiler les deux.
Mais il est une autre chose, pour le coup, qui m’a frappé à la lecture de ce recueil, et c’est son étonnante modernité. Elle peut paraître paradoxale, tout spécialement quand on compare à Lovecraft – ne serait-ce que parce que Blackwood lui est antérieur, s’il lui survivra quelques années : les nouvelles de ce recueil datent pour l’essentiel des années 1900-1910, la seule véritable exception étant la bien plus tardive « Passage pour un autre monde » (1946). Mais, en dépit d’un cadre social parfois emblématique d’une sorte d’aristocratie encore victorienne (malmené cependant par des personnages points de vue souvent issus de milieux autrement populaires – et qui ne le cachent en rien, bien au contraire), et de quelques tics d’écriture bien de l’époque, la manière qu’a Blackwood de narrer ses horreurs, plus encore que celle de son illustre contemporain Arthur Machen, annonce les meilleurs auteurs actuels, dans le registre psychologique surtout (en cela, il est forcément proche de son autre contemporain Henry James, je suppose), mais aussi parfois de manière étonnamment plus viscérale… Encore que je ne saurais pas argumenter bien au-delà – c’est quelque chose que je ressens sans forcément bien le comprendre… Mais demeure ce sentiment que ces textes, qui devraient sentir bien plus que cela la poussière, demeurent tout à fait lisibles et efficaces aujourd’hui, en fonction de critères postérieurs de plus d’un siècle.
Mais détaillons un peu le menu, maintenant. Le recueil s’ouvre sur… « Le Wendigo » (« The Wendigo »), une ample novella publiée pour la première fois en 1910 et qui prend place dans les forêts sauvages du Canada. Là, une partie de chasse est organisée (là encore un thème récurrent : « Passage pour un autre monde » emploiera exactement le même prétexte, et il y en a quelques traces plus diffuses dans « Celui que les arbres aimaient… », pour s’en tenir à ce recueil précisément, mais on pourrait aussi bien citer « Le Camp du chien », etc.). Un bon docteur et son neveu destiné à la prêtrise recourent aux services de deux guides, parmi lesquels le Canadien Français Joseph Défago, assistés d’un Indien du nom de… Punk (ce qui fait un peu bizarre). Dans une variation classique sur le récit d’horreur, ces braves gens font ce qu’il ne faut jamais faire : ils se séparent. Et dans une ambiance quelque peu oppressante, visiblement, surtout aux yeux de Punk et de Défago – on devine une menace latente dans ces sombres en même temps que superbes forêts… et le drame ne manquera pas de se produire : Défago disparaît dans des circonstances étranges et horribles – ses cris absurdes terrorisent le jeune chasseur qui faisait la route avec lui… Mais impossible de savoir où il est passé – or les cris semblaient provenir d’en haut… Ce qui est bien sûr impossible ! Mais suivre les traces laissées par Défago est également impossible – et il y a la suggestion, à peine plus, de traces d’un autre ordre, non humaines, et probablement pas animales non plus… De vagues réminiscences, quand les compagnies se retrouvent, évoquent la légende indigène du Wendigo – quelque monstre à l’allure inconnue qui enlève ses victimes, et les fait courir si vite que leurs pieds brûlent, avant de les élever tout là-haut dans le ciel… Mais on ne voit pas le Wendigo – on le devine, peut-être, à son odeur notamment… mais on ne le voit pas. Ce que l’on voit, peut-être, mais à terme seulement, c’est l’effet produit sur Défago. S’il s’agit seulement de lui ? Au fond, les chasseurs comme le lecteur ne voient rien, eux – ils devinent. Et c’est heureux – car Défago, lui, a vu le Wendigo, et c’est ce qui l’a condamné.
« Le Wendigo » est une merveille de suggestion – une démonstration particulièrement brillante des vertus de l’indicible. On ne s’étonnera guère, ici, que Lovecraft ait prisé ce texte – outre bien sûr, point déjà soulevé, le sentiment d’horreur cosmique ou peu s’en faut que Blackwood produit avec son cadre de nature sauvage, et, de même, le fait qu’il a puisé dans un folklore alors sans doute méconnu (en fait, la nouvelle de Blackwood a probablement contribué à populariser la figure du Wendigo) pour créer un monstre original, aux caractéristiques peu ou prou démoniaques sinon divines. La novella accuse un peu son âge dans quelques passages qu’on serait tenté de juger aujourd’hui maladroits (essentiellement les cris de Défago, qui sonnent faux), mais, ce petit bémol mis à part, « Le Wendigo » demeure un très grand texte d’horreur, dans lequel la peur n’est pas produite par le spectacle du monstre, mais par de vagues indices de sa présence seulement. Exemplaire – même si, à titre personnel, mais comme Lovecraft pour le coup, je place « Les Saules » encore au-dessus.
Mais peut-être aussi « Celui que les arbres aimaient… » (« The Man Whom the Trees Loved ») ? J’avais adoré cette longue novella (plus longue encore que « Le Wendigo ») datant de 1912, quand je l’avais lue pour la première fois dans le recueil (presque) éponyme publié par L’Arbre Vengeur, et ce sentiment persiste aujourd’hui – peut-être même renforcé. La nature sauvage aussi belle que terrifiante est à nouveau de la partie, mais l’approche est très différente – beaucoup plus subtile, à vrai dire. Le sentiment de peur n’y est longtemps pas frontal, l’auteur jouant plutôt sur le malaise, une vague angoisse latente qui progresse en silence…
La novella met en scène un couple anglais un peu âgé, Mr et Mrs Bittacy, qui vit non loin de la forêt. Mr Bittacy, en son temps, était chargé de l’entretien des bois, en Angleterre comme en Inde – il a toujours eu une profonde affinité pour les arbres. Mais on en arrive alors au point où cet attrait devient pathologique et chargé de menace – car il ne s’agit pas seulement, ici, de mettre en scène un homme qui aime les arbres, même excessivement, mais un homme que les arbres aiment. Une conversation avec un peintre affligé (?) des mêmes passions pousse toujours un peu plus Mr Bittacy sous la domination des arbres.
Du moins est-ce ainsi que Mrs Bittacy perçoit les choses – et le coup de génie de la nouvelle consiste précisément à en faire, progressivement, le personnage point de vue. Son portrait n’est pourtant pas très flatteur, initialement : Mrs Bittacy est une bigote, clairement, et pas forcément très futée. La novella ne nous épargne pas quelques saillies misogynes (p. 81) : « À dire vrai, comme beaucoup de femmes, elle ne pensait jamais vraiment : elle se contentait de refléter la pensée des autres, qu’elle avait appris à discerner. » Revers de la médaille : Mrs Bittacy est sincèrement bonne chrétienne au-delà d’être simplement bigote, et elle est une femme aimante et sensible. Elle perçoit la menace affectant son vieil époux – en des termes que lui-même ne pourrait jamais employer, car il est quant à lui ravi de sombrer, sans percevoir justement qu’il sombre. Ce qui suscite à vrai dire une certaine ambiguïté : à l’égard de l’emprise des bois sur son mari, Mrs Bittacy n’est-elle pas tout simplement jalouse ? Son point de vue phagocytant le récit, quel crédit doit-on lui accorder ? Est-il fiable ? Les arbres s’approchent-ils vraiment de la demeure ? Le vent emporte-t-il vraiment les paroles de la forêt, des paroles séduisantes murmurées au creux de l’oreille du seul Mr Bittacy ? La nouvelle joue forcément de cette incertitude – mais cela ne fait que renforcer la puissance de son discernement psychologique. Mrs Bittacy évoque tout autant, d’ailleurs, au-delà de la seule femme jalouse et possessive, mais qui n’en suscite pas moins la compassion la plus sincère, un parent, un amant ou un ami assistant aux premières loges à la déchéance d’un proche, dans, mettons, la dépression ou l’addiction, et qui voudrait intervenir mais se retrouve désemparé. Ce qui rend cette novella très émouvante – au point où c’en a quelque chose de douloureux, à vrai dire. Mais, au-delà, elle inquiète et fascine, séduit et terrifie – comme la forêt qu’elle met superbement en scène, toujours à l’arrière-plan, sans effets spéciaux, sans tours de manche grotesques. Je le maintiens : c’est un immense chef-d’œuvre.
Avec ces deux seuls textes, nous avons donc déjà lu plus des deux tiers du recueil. Ne reste plus que trois nouvelles autrement courtes, les deux premières surtout – et, autant le dire d’emblée, ces dernières ne sont clairement pas à la hauteur du « Wendigo » et de « Celui que les arbres aimaient… ». Elles ne sont pas mauvaises pour autant, c’est simplement qu’elles ne brillent pas autant.
« La Danse de mort » (« The Dance of Death », 1907), qui tient en treize pages, est un récit qui, aujourd’hui du moins, mais probablement déjà l’époque, a quelque chose d’un peu trop convenu pour séduire pleinement. On ne fait pas dans la surprise, ici – on sait très bien avec qui danse le personnage point de vue, le titre de la nouvelle est assez explicite comme cela. À vrai dire, votre serviteur n’a pas manqué de lire cette nouvelle comme un épisode de Sandman – la Mort y est tout sourire, car elle aime tout le monde. L’intérêt éventuel de ce court récit, pour le coup totalement dénué de références à la nature sauvage, est ailleurs, je suppose – dans une dimension plus inattendue, peut-être, car cette nouvelle a un thème plus ou moins vaguement social et/ou sociétal, qui touche bien plus que l’élément surnaturel justifiant le récit. Cet homme aigri par son travail minable et ennuyeux, affligé par une santé déficiente, et aussi possédé par un désir charnel assez animal, a quelque chose de paradoxalement intemporel, je suppose – et la conclusion de la nouvelle, très sèche, noue les tripes, en dévoilant en dernier recours une horreur très humaine au fond bien plus glaçante que l’horreur surnaturelle.
« Complice par omission » (« Accessory Before the Fact », 1911), la nouvelle… omise dans la table des matières, est la plus courte du recueil (neuf pages). Elle est bien plus troublante que « La Danse de mort » – mais aussi un peu confuse, ai-je trouvé… Un voyageur s’y égare dans un piège fatal tendu pour un autre – mais y voit enfin une prémonition qui le laisse totalement dépourvu : il ne pourra pas empêcher que le piège se referme sur sa véritable victime. La nouvelle a une ambiance assez onirique, sur un mode noir mais aussi absurde, avec ces figurants allemands égarés en Angleterre : si la nouvelle précédente m’a fait penser, en anticipant, à Neil Gaiman, celle-ci me paraît plus du côté de David Lynch, mettons. Il en résulte un cauchemar paranoïaque étonnamment moderne, mais… oui, il y a ce sentiment, chez votre serviteur, d’un récit un peu trop brouillon pour pleinement convaincre. Le texte est troublant, mais aussi un peu frustrant. Peut-être me faudrait-il le relire dans quelque temps…
Et le recueil de se conclure sur une nouvelle plus longue que les deux qui précèdent, mais bien moins que les deux premières, avec « Passage pour un autre monde » (« The Trod ») – un conte par ailleurs bien plus tardif que tous les autres, puisqu’il a été publié en 1946 seulement. Cette nouvelle, là encore, je l’avais donc déjà lue, et appréciée, dans L’Homme que les arbres aimaient. Elle nous ramène à une certaine forme de nature sauvage, mais surtout au thème de la partie de chasse – en même temps que le personnage point de vue, de par son côté « pas assez aristocrate pour ses fréquentations », mais aussi possédé par le désir amoureux, rappelle celui de « La Danse de Mort ». Le traitement est pourtant tout autre, encore qu’il emprunte là aussi à des thématiques plutôt classiques : en l’espèce, le Petit Peuple, cher à Machen, Buchan ou Howard. Il y a, dans la forêt, ce « passage », emprunté à l’équinoxe par le « Peuple Joyeux », lequel y « invite » à perpétuité des victimes (?) tout humaines. Les autochtones, terrifiés à l’idée que leurs enfants y disparaissent à jamais, ont recours à la superstition pour s’en prémunir – vaguement. Mais la chère et tendre de notre héros (très heureux d’avoir à se comporter en héros, et qui prend ses désirs pour des réalités) est dans une situation ambiguë – car sa mère, en son temps, a franchi le passage. Et elle a la conviction que, lors de cette partie de chasse (un vrai génocide d’oiseaux), malencontreusement organisée au moment de l’équinoxe, le passage l’appellera ; à vrai dire, c’est sans doute sa propre mère qui l’appellera en personne… Sacré dilemme ! La nouvelle fonctionne bien. Elle est bien conçue, et bien exécutée. Mais elle paraît un peu convenue dans ce recueil qui, avec « Le Wendigo », « Celui que les arbres aimaient… » et même « Complice par omission », faisait preuve jusqu’alors de davantage de personnalité. C’est donc à la comparaison qu’elle pâlit un peu – car, toutes choses égales par ailleurs, c’est une nouvelle à la lisière du fantastique et de la fantasy qui, oui, fonctionne bien.
Et l’ensemble est de très haute tenue. Algernon Blackwood était bien un maître du fantastique, un des tout meilleurs auteurs du genre. Ses textes n’ont pas vieilli, ou ont bien vieilli, et valent toujours le coup qu’on les lise aujourd’hui, sans se livrer spécifiquement à une entreprise d’archéologie littéraire.
Alors je vais conclure cette chronique par là où je l’ai commencée – et râler que l’œuvre de Blackwood, L’Homme que les arbres aimaient mis à part, soit peu ou prou indisponible en français de nos jours. Pour Machen, Dunsany, Hodgson, Chambers ou plus récemment M.R. James, on peut éventuellement (...) se référer à des publications plus ou moins confidentielles, mais pas pour Blackwood. Il mériterait assurément d’être réédité, bordel ! Que quelqu’un le fasse, pitié !