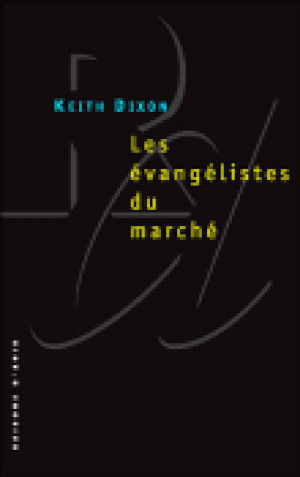L’ouvrage de Keith Dixon, professeur d’études anglophones, s’intéresse aux « origines intellectuelles » du néolibéralisme[1] anglo saxon, de Margaret Thatcher à Tony Blair (et ses successeurs). Ou plutôt, le chercheur s’intéresse aux structures intellectuelles-politiques, les think tanks, qui ont porté ces idées durant plusieurs décennies et qui ont permis (« condition nécessaire mais pas suffisante ») le développement et l’imposition de ces idées.
Remarque préalable, qui pourrait être un propos conclusif, l’ouvrage est loin d’être indispensable, par son côté « informationnel » qui lui donne un peu l’image d’un long article journalistique, sans la profondeur qu’on pourrait attendre d’une étude universitaire (manque de développement, d’argumentation, de travail « scientifique » notamment dans l'étude précise de l'impact concret des think thanks au delà du "ils sont influents", etc.). Néanmoins, malgré le manque de stimulation intellectuelle, il se lit bien et offre des informations intéressantes (très précises et minutieuses dont ma recension ne fait qu’une très lointaine synthèse) pour toute personne intéressée par la politique britannique et le rôle des think tanks.
L’origine de ces clubs de pensée néo-libéraux trouve se retrouve dans la première moitié du Xxe siècle, à la suite et pendant la « crise du libéralisme » jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette période, des « intellectuels », hommes politiques, personnalités du monde de l’entreprise sentent et voient le vent tourner et tentent de se structurer pour remettre sur scène un « nouveau libéralisme » modernisé.
La première initiative médiatique fut la tenue du Colloque Walter Lippman[2] (du nom du journaliste et essayiste étasunien) organisé en France en 1938 où sont notamment présents les économistes-philosophes de l’école Autrichienne Friedrich von Hayek[3] et Ludwig von Mises ou encore le français Raymond Aron.
La deuxième instance mise en exergue par Keith Dixon est évidemment la plus que célèbre société du Mont-Pèlerin, mise en place en 1947, structure qui elle aussi rassemble des personnalités diverses mais « unies » contre le dirigisme des sociétés « modernes », le keynésianisme dominant et l’Etat Providence au sein de laquelle seront notamment influents Hayek, le monétariste Milton Friedman (les deux figures de prou du « néolibéralisme », en tout cas médiatiquement, malgré leurs visions différentes) ou encore les ordolibéraux[4] allemands Wilhelm Ropke[5] et Walter Eucken.
Suite à ces débuts d’une structuration internationale des intellectuels « libéraux », se met en place en Grande Bretagne des organismes nationaux ayant pour objectif de vulgariser les idées « libérales » à destination notamment des décideurs politiques et du monde journalistique. Cette activité se traduisait par l’éditions d’ouvrages, l’organisation de conférences et de rencontres diverses. Preuve de l’influence d’Hayek, d’après ce qu’en dit l’auteur, la création du plus ancien et important think tank libéral britannique, l’Institue of Economic Affairs (EIA), trouverait son origine suite à des échanges entre Hayek et l’économiste britannique Antony Fisher. L’importance de l’influence de l’EIA se mesure notamment par la proximité des proches de Thatcher avec ce think thank qui finalement ressembla à une forme d’institut de formation pour toute une nouvelle génération de politiciens libéraux.
L’autre grand institut propagateur des idées néo-libérales, le Center for Policy Studies (CPS), dont Margareth Thatcher fut une des fondatrices, a été mis en place en 1974 suite à la défaite du parti conservateur aux élections qui était lui un organisme de conquête intellectuel et idéologique plus spécifiquement à destination du parti conservateur afin de l’imprégner davantage des idées néo-libérales. L’activité de ce think tank se traduisait en particulier par la mise en place de groupes d’études chargées d’analyser des politiques sectorielles et de proposer des recommandations (notamment concernant le système de santé ou la réglementation syndicale).
Globalement, ce que note l’auteur, c’est que les think tanks sont très actifs et influents jusqu’à l’accession de Margaret Thatcher au pouvoir en 1979 (ils permettent l’essor de la pensée néo-libérale et sa propagation) mais beaucoup moins ensuite. Leur idéologie étant au pouvoir, leur rôle s’est logiquement restreint du fait que leurs idées ont progressivement constitué le « sens commun ».
Ce qui est aussi intéressant avec l’activité des think tanks « libéraux », c’est plus que leurs liens avec les domaines de l’industrie et des grandes entreprises, c’est l’importance de leurs réseaux médiatiques et finalement toute l’utilité et l’efficacité de leur lobbying dans la popularisation, mais surtout, la « respectabilisation » de leur positionnement idéologique. Comme le dit à un moment Keith Dixon, ce travail de sape, ce rapprochement auprès des journalistes (et l’inverse), a permis aux idées « libérales », bien que minoritaires, d’être acceptées par les « faiseurs d’opinion », avant que la conjoncture socio-économique permette à ces idées d’occuper le devant de la scène. C’est finalement tout un système d’institutionnalisation qui a été mis en place par une véritable stratégie de conquête.
Cela peut être étonnant avec nos yeux de contemporains habitués au « libéralisme omniprésent » notamment chez nos confrères anglo-saxons, mais, même à l’époque de Thatcher, et surtout dans la décennies précédente, les nouveaux libéraux étaient loin d’être majoritaires (on peut même dire qu’ils étaient plus que minoritaires) au sein du parti conservateur. Celui-ci s’accommodant finalement pendant longtemps du « consensus keynésien » (on peut même élargir à la personne d’Hayek, qui connue la gloire à la fin des années 70 et durant les années 80 après avoir fait partie d’une petite minorité pendant 30 ans). Outre le parti conservateur, c’est même le milieu patronal qu’il a fallu convaincre, lui aussi étant finalement dans une situation de statut co avec le puissant mouvement syndical.
Finalement, ce qui a permis de fissurer 30 années de prédominance du « modèle » keynésien et de l’Etat providence fut bien la crise même de ce modèle. C’est parce que face à une crise généralisée (sociale, économique, politique) les méthodes traditionnelles de gestion publique et politique n’ont pu redresser la situation que les vannes alternatives se sont réellement ouvertes.
La crise britannique a pris plusieurs formes. Elle est tout d’abord économique et s’explique notamment par l’incapacité du gouvernement à renverser le déficit de la balance des paiements[6] (sommairement, les flux financiers et monétaires entrants et sortants du pays) et surtout par l’installation d’un climat de « stagflation » (barbarisme langagier qui décrit une situation d’inflation importante en période stagnation ou récession économique et d’une augmentation du taux de chômage).
En parallèle de cette situation économique, c’est le monde du travail lui même qui est touché avec une augmentation spectaculaire des mouvements de grève au passage de la décennie 70. Les puissants syndicats britanniques faisant d’ailleurs à l’époque pression sur les gouvernements tant travaillistes que conservateurs (qui durent renoncer à leurs promesses de « réformes »). Cette prégnance des syndicats servis d’ailleurs les intérêts du parti conservateur dont les courants libéraux et traditionnels vont se rapprocher face à un adversaire commun. Après une montée progressive du courant « libéral » au sein du parti conservateur, Thatcher emporta la présidence du parti en 1975 suite aux déboires des favoris (Keith Joseph son futur ministre de l’éducation puis de l’énergie ainsi que le dirigeant actuel et ancien Premier ministre Edward Heath).
En définitive, c’est au milieu des années 70 que semble émerger un tournant intellectuel et politique d’éloignement des politiques traditionnelles tant à Gauche qu’à Droite et où finalement le « néolibéralisme » se trouvait être une solution neuve à l’heure de la mise en cause du keynésianisme comme un des facteurs explicatifs de la crise. Le plus amusant est que, à l’instar du parti socialiste plus tard, le parti travailliste a semblé avaliser la nouvelle ère du temps libérale monétariste qui se traduisit aux affaires par des coupes dans les budgets sociaux et plus largement de mise en place d’une politique de rigueur, ce qui contribuera notamment à la fracture avec les organisation syndicales. Cette trahison de l’idéologie traditionnelle s’incarne parfaitement dans une anecdote que rappelle Keith Dixon, lorsqu’en 1976 le Fond Monétaire International, déjà converti aux thèses monétaristes, requis contre la demande d’un prêt une diminution importante (plusieurs millions de livres) de la politique sociale du gouvernement.
Concernant le champ médiatique, un peu comme la fraction médiatique de nos 68tards, une partie de l’intelligentsia journalistique travailliste se laisse séduire par ce nouveau courant de pensée comme des conservateurs plus old school. C’est ainsi dans ces années là que la presse d’une manière générale s’ouvre aux thèses « monétaristes[7] » (qui pour caricaturer s’intéresse surtout au contrôle de la masse monétaire comme principal danger pour le développement de l’inflation, donc, qu’en gros, trop de création monétaire entraîne irrémédiablement une augmentation des prix, ce qui entraîne, suivez mon regard une recommandation d’un Etat moins « distributeur » d’argent public) d’un Milton Friedman[8] trouve des relais que cela soit au sein du Financial Times, du Times ou du Guardian. En parallèle, même si on pouvait s’en douter, la majeure partie de la presse britannique, telle la presse française en 1995, pris position contre les grévistes et contribue ainsi à l’essor des thèses libérales et la publicité de leur programme anti syndical.
On peut donc s’avancer en disant que le "tournant néo-libéral" en Grande Bretagne fut un mouvement à la fois intellectuel, journalistique et politique « transparti » (qui a touché tant les conservateurs que les travaillistes).
En tout cas, Keith Dixon évite le piège (qui était en même temps facile) de faire de l’activité des think tanks libéraux la cause déterminante, unique, du changement de l’idéologie dominante au cours des vingt dernières années en Grande Bretagne. Il insiste bien sur le fait que cette forte présence est une condition nécessaire mais pas suffisante et surtout, que le déterminant aura été la crise sociale, économique et politique qu’a connu la Grande Bretagne qui marqua le coup d’arrêt du consensus keynésien et le repli de la défense de l’Etat Providence. En somme, sans la crise de gouvernance qu’a connu la Grande Bretagne l’idéologie « néo-libérale » ne serait certainement pas devenue aussi prégnante qu’elle l’a été, mais sans cette activité d’intense lobbying on pourrait comprendre que cela aurait pu prendre plus de temps.
En conclusion, ce que permet l’opuscule de Keith Dixon c’est de nous interroger d’une part sur la situation française où comme chacun peut le voir, une forme de quasi consensus « libéral » semble prédominer au sein des gros groupes médiatiques (en passant par l’éditocratie et « l’éconocratie ») ainsi que des principaux partis politiques (UMP et PS) et d’autre part, sur ce que représente Emmanuel Macron comme incarnation de l’époque et qui fait suite à une période de crise d’insatisfaction pour les « solutions » traditionnelles (bien qu’avec lui on ne fait pas « différemment » mais pareil de manière exacerbée) et qui a lui aussi (comme Thatcher) bénéficié de circonstances favorables pour s’imposer (suicide du PS, victoire de Benoît Hamon à la Primaire de la Gauche, affaires Fillon etc.).De même, Macron incarne parfaitement le fameux TINA (« There is no alternative ») cher à Thatcher avec l’idée que sa politique libérale est pragmatique, désidéologisé dans le sens où elle prend en compte le réel et constitue l’unique politique possible.
En espérant juste qu’Emmanuel 1er fasse moins de dégâts que Margaret. Et ça, c’est pas gagné.
[1] Terme évidemment polysémique et plein de nuances (comme"marxisme", "libéralisme" ou d'autres d’ailleurs). J’entends grossièrement par là une idéologie qui pourfend l’intervention de l’Etat (autre que régalienne, et encore …) et considère les dépenses publiques comme inutiles voire dangereuses (inflation, chômage, assistance etc.). Couplé à cela, l’idée que « le marché », et par suite la libre concurrence est une condition indispensable à respecter pour la prospérité. C’est aussi l’idée de laisser le plus possible la place à l’initiative privée et que l’Etat finalement est une entité semblable à une entreprise et qui doit se gérer de la même manière (contrôle des déficits, management comme une société, doit suivre des objectifs quantitatifs et son action mesurée à l’aune d’indicateurs de performance). Plus philosophiquement, c’est l’idée que l’utilité, l’intérêt, la maximisation du gain, du profit (monétaire ou autre), mènent en quelque sorte les comportements humains et sont valables dans toutes les sphères de la vie sociale. Néanmoins, contrairement à certaines visions libérales, nombre de "néolibéraux" ne veulent pas une disparition de l’Etat, il s’agit plus de l’utilisation des pouvoirs de l’Etat à d’autres fins (ce que j’appelle pour ma part le « libéral étatisme », libéral en économie, qui verse d’ailleurs en partie dans le « capitalisme de connivence » contraire au credo smithien du libéralisme …, et étatiste sur la sécurité et d’autres domaines). Bien entendu, les épigones de Hayek ou Frideman sont bien moins radicaux mais en conservent je trouve des présupposés philosophiques.
[2] Pour plus de détails sur ce colloque, voir l’ article de François Denord "[Aux origines du néo-libéralisme en France][1]"
[3] Pour une présentation des idées d’Hayek, voir les articles de Philippe Légé comme "[Le mirage du libéralisme hayékien][2]".
[4] Par ordolibéralisme, on peut entendre, sommairement, une doctrine néo-libérale qui insiste sur l’encadrement du marché (création humaine et non naturelle comme pour certains libéraux) par les pouvoirs publics et la vision de l’Etat comme « garant », gendarme des activités économiques. Il doit faire respecter les règles de libre concurrence et intervenir le moins possible dans l’économie, en tout cas pas autrement que pour jouer son rôle de gardien. Il s’agit en quelque sorte de séparer le politique de l’économie. Faire du secteur économique une sphère détachée du politique, soumis aux passions et aux intérêts personnels. En clair, les successions de majorités ne doit pas avoir un impact sur le fonctionnement du marché. Les politiques passent, le marché demeure. Un exemple parlant de l’ordolibéralisme allemande est le cas de la Banque Centrale Européenne, instance indépendante des Etats qui est censé (théoriquement) uniquement s’attacher à la maîtrise de l’inflation. Sur l’ordolibéralisme voir notamment "[Une voie allemande du libéralisme ? Ordo-libéralisme, libéralisme sociologique, économie sociale de marché][3]" ; "[L'économie sociale de marché][4]" ; "[L'ordolibéralisme, unité et diversité][5]".
[5] Sur Wilhelm Ropke voir notamment "[Retour sur une expérience : une biographie intellectuelle de l'économiste Wilhelm Ropke][6]"
[6] Sur la balance des paiements voir "[A quoi sert la balance des paiements ?][7]"
[7] Sur le monétarisme voir entre autre "[Les faux-fuyants du monétarisme][1]"
[8] Sur Milton Friedman voir notamment "[Milton Friedman, croisé du libéralisme][1]"