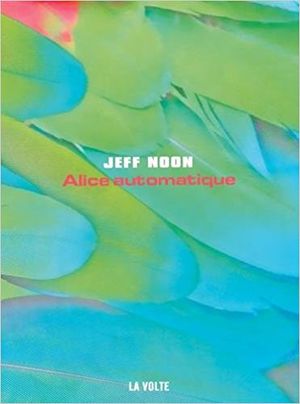Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2017/07/alice-automatique-de-jeff-noon.html
JE VEUX TOUT NOON
La Volte poursuit sa salutaire entreprise d’édition française des œuvres de Jeff Noon, en opérant cette fois un petit retour en arrière : sous le titre d’Alice Automatique, il s’agit en effet de reprendre le troisième roman de l’auteur – alors en plein « Vurt » –, qui avait déjà bénéficié d’une édition française en 1998 chez Flammarion, sous le titre d’Alice Automate, dans une traduction de Michèle Albaret-Maatsch ; ce qui avait également été le cas de Vurt, à la même époque, mais l’entreprise avait autrement été sans lendemain.
La Volte, depuis plusieurs années, s’attache donc à faire connaître en France l’œuvre iconoclaste et si réjouissante de Jeff Noon, et on ne l’en remerciera jamais assez ; mais, si elle avait déjà repris Vurt, le présent roman avait été laissé de côté – et était de longue date indisponible. Joie ! Joie ! Il nous revient donc aujourd’hui, et dans une nouvelle traduction signée Marie Surgers – laquelle avait déjà accompli des miracles avec Noon, traduisant successivement l’excellent recueil de nouvelles Pixel Juice, puis les romans Descendre en marche et surtout Intrabasses : son extraordinaire travail sur ce dernier titre lui avait valu un Grand Prix de l’Imaginaire amplement mérité. Aussi, si je ne suis pas en mesure de comparer la présente traduction avec celle parue chez Flammarion il y a… vingt ans de cela, disons que j’ai un a priori plus que positif.
ALICE, ÉPISODE TROIS
Si l’œuvre de Jeff Noon, prise dans sa globalité, est assurément des plus originale, elle n’en est pas moins traversée d’influences qu’il ne nie certainement pas. Et la plus importante est peut-être bien celle de Lewis Carroll, dont l’imaginaire fantasque et absurde mais aussi les jeux de langage peuvent être retrouvés dans les récits du « Vurt » et parfois au-delà. Dans Alice Automatique, son troisième roman, Noon « officialise » en quelque sorte cette influence séminale en livrant, présenté comme tel, un « troisième livre » consacré aux aventures d’Alice, après Alice au pays des merveilles et De l’autre côté du miroir : rien que ça !
On s’en doute bien : s’attaquer à de tels classiques est d’une ambition folle, à la limite de l’arrogance… Car « faire du Alice » n’est pas donné à tout le monde : les récits de Lewis Carroll ont quelque chose d’inimitable, ou du moins de rétif à la formule ; pour sonner juste, sans doute faut-il d’abord bien comprendre l’œuvre originelle, puis disposer du talent nécessaire à la prolongation du mythe – ce qui va bien sûr au-delà de la seule narration accompagnant une création d’univers nonsensique : le style lui-même doit baigner dans cette absurdité générale.
Et Jeff Noon se montre particulièrement brillant – car il a su retenir les meilleures leçons de son modèle, au point d’en livrer des échos bien intégrés, pas de simples ersatz, dimension tout particulièrement sensible dans son style tout en excès et jeux de mots, tandis que la logique chère au mathématicien Charles Lutwidge Dodgson perturbe à sa manière la troisième épopée absurde de l’alter-ego archétypal de la petite Alice Liddell ; tout cela fusionnant dans un délire tout personnel rattachant « Alice » au « Vurt », ou plus largement à un corpus noonien alors en gestation.
DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’HORLOGE
La petite Alice, en 1860, poursuit son train-train quotidien, tout de caprices et de cocasses malentendus, et de leçons d’anglais de quatorze heures, assénées par la sévère grand-tante Ermintrude, qui la menace cette fois avec ses incompréhensibles points de suspension. C’est d’un ennui…
Heureusement, le perroquet Whippoorwill va perturber cet emploi du temps morose en fuyant dans une horloge ; Alice suit comme de juste l’oiseau au plumage bariolé et goûtant les énigmes les plus abstruses, ce qui va la précipiter dans un troisième monde fantastique n’ayant rien à envier au terrier du Lapin Blanc, pas plus qu’à ce qui se trouve de l’autre côté du miroir. Mais Qu’y a-t-il donc de l’autre côté de l’horloge ?
Manchester, bien sûr !
Et Manchester en 1998. C’est fâcheux : Alice aura donc nécessairement 138 ans de retard pour sa leçon d’anglais de quatorze heures ! La grand-tante Ermintrude sera furieuse – et plus encore si son cher perroquet Whippoorwill disparaît par la même occasion !
Notre Alice part donc à l’aventure : il lui faut retrouver le perroquet volage (dont elle garde une plume constituant d’une certaine manière la genèse du « Vurt »), puis regagner son époque – à temps pour sa leçon d’anglais de quatorze heures. Rien d’insurmontable pour la hardie gamine…
NÉOMONIE ET PUZZLOMEURTRES
Mais cette Manchester de 1998 (deux ans après la date de publication du roman) est tout de même bien étrange – pour ne pas dire folle ; même si cette Madchester-là ne tourne pas tant autour de la Factory et de l’Haçienda – côté musical, il y en a forcément un, elle convoque bizarrement plutôt Miles Davis et Jimi Hendrix, guest-stars du roman…
C’est que la néomonie est passée par là – la néomonie, pas la pneumonie, petite sotte ! Une étrange épidémie qui fait fusionner les êtres et les choses. Alice, qui a vu pire, déambule ainsi dans un monde de chimères entre l’homme et l’animal – arachnogosses et blairhommes, chafilles et ordinatermites… sans même parler des boarocrates, tellement menaçants qu’ils ont eux-mêmes quelque chose de points de suspension…
Mais il y a pire : il y a les puzzlomeurtres. Parmi ces êtres chimériques, nombreux sont ceux qui s’avèrent être des victimes de crimes atroces, bousculant encore plus leur apparence improbable pour ne plus laisser derrière eux que des corps démantibulés, les yeux à la place des genoux, les moustaches aux coudes, la bouche dans le ventre… Et, sur ces scènes de crime improbables, on trouve invariablement une pièce de puzzle.
Ce qui réjouit Alice, en fait : elle faisait un puzzle du zoo de Londres, dans le temps – 138 ans plus tôt… Et il lui manquait très exactement douze pièces. Remonter la piste des puzzlomeurtres est ainsi le moyen le plus sûr (?) de trouver les pièces manquantes ; et cela doit faire sens, non ? Quand elle aura rassemblé les douze pièces de puzzle, et mis la main sur Whippoorwill, rentrer en 1860 sera un jeu d’enfants… Confiante, Alice suppose même qu’avec un peu de chance elle pourra rentrer avec suffisamment d’avance pour apprendre ce que sont les points de suspension – à moins que son séjour mancunien de 1998 n’ait la bonté de le lui apprendre de lui-même ?
Par ailleurs, elle n’est pas sans alliés dans cette aventure policière – des personnalités fantasques telles que le capitaine Fracaboum, spécialiste en aléatoirologie, ou la corneillofemme et brillante chercheuse à l’unipirsité Gladys Chrowdingler, qui s’y connaît en chrownotransductionologie – mais, après tout, quand on a un chat qui s’appelle Quark… Où est-il passé, d’ailleurs ?
Et il y a un autre allié de poids : Célia, à l’anagramme explicite – poupée de porcelaine avec des tiroirs dans les membres, elle complète le trio des Alice, en ajoutant à l’Alice Liddell bien réelle et à l’Alice imaginaire de ce brave M. Dodgson, l’Alice Automatique qui n’est ni réelle ni imaginaire, ou bien est les deux à la fois…
Pas dit, par contre, aussi sympathique soit-il, que ce M. Jean-François Midi soit véritablement utile en cette affaire – et puis il a cette marotte, de glisser des « u » partout dans ses mots, on n’y comprend plus rien…
BEAUX JEUX DE MOTS LAIDS
Les jeux sur la langue caractéristiques du style de Lewis Carroll ne sont certainement pas l’aspect de son écriture le plus facile à copier/prolonger/pasticher/parodier. Il y a chez lui une fraîcheur et un naturel, quand il a recours à de tels procédés, qui tranchent sur les maladroites tentatives de bien d’autres écrivains de faire de même – et qui ne parviennent guère qu’à se montrer lourds… Inutile de chercher bien loin : à la Volte même, suivez mon regard, le type qui (hordeducontre)vend bien, là…
Anagrammes, mots-valises, etc., sont des outils des plus périlleux – même chez les meilleurs, ça passe plus ou moins bien : pour citer une lecture récente, et bifrostienne également, voyez peut-être Les Hommes salmonelle sur la planète Porno, de Yasutaka Tsutsui ? Ou peut-être pas, dans la mesure où il y a alors un biais essentiel : celui de la traduction (aussi louable soit-elle en l’espèce, d’ailleurs) ; mais c’est justement un point important à développer.
Jeff Noon est coutumier du fait, sans doute : nombre de ses livres, mais peut-être tout spécialement ceux relevant du « Vurt » (d’une certaine manière, Alice Automatique en fait partie), usent abondamment de ce genre de jeux de langage ; mais globalement avec réussite ?
Ici, en tout cas, cela passe bien, dans l’ensemble – mais, bien sûr, il s’agit pour une bonne part d’une question de traduction. Comme bien d’autres ouvrages de Noon, sans doute (au premier chef Pixel Juice et Intrabasses, également traduits, et si magnifiquement, par Marie Surgers), Alice Automatique a dû être un vrai casse-tête pour la traductrice – un piège d’une complexité effarante, de quoi s’arracher les cheveux à chaque paragraphe…
Mais, globalement, ça fonctionne bien, et le double travail – de l’auteur, de la traductrice – a payé. Si la lourdeur n’est pas toujours facile à éviter, et si certains stigmates de la néomonie, ou d’autres concepts alambiqués, passent plus ou moins bien en français, il y a assurément de belles trouvailles : passer de « civil serpents » à « boarocrates » n’avait sans doute rien d’évident, mais s’avère en définitive pertinent. Or chaque paragraphe croule sous ce genre de néologismes… Mais le texte français demeure heureusement fluide. Félicitations, donc, et compassion, en même temps, à Marie Surgers. Une fois de plus.
Mais il faut rendre à César, etc., et donc remonter à Noon lui-même, derrière le motif de chaque jeu de mots ; et si Alice Automatique fonctionne, c’est aussi parce qu’il a su concocter une architecture nonsensique empruntant au plan même de Lewis Carroll dans ses récits consacrés à Alice (et sans doute ailleurs, au moins dans Sylvie et Bruno, peut-être également, même si l’approche est forcément un peu différente, dans ses Lettres à des petites filles) ; ainsi, nombre de ces jeux de mots doivent quelque chose à l’incompréhension de la part d’Alice – les malentendus et les confusions sont des outils de choix pour oser ces variations de vocabulaire, en égale mesure à la conception même de l’univers. Et c’est pourquoi Jeff Noon parvient, d’une certaine manière, à faire du Lewis Carroll – Alice Automatique, avec ses 130 années de décalage, pourrait bien constituer la troisième aventure « officielle » d’Alice.
LA LEÇON D’ANGLAIS DE MIDI
Mais ce n’est pas là tout le roman : cela faisait indéniablement partie du projet de Noon, mais il ne se contente pas de livrer un pastiche de Lewis Carroll, aussi savoureux soit-il. Alice Automatique est bien un roman de Jeff Noon – qui ne dépare pas dans son œuvre d’alors : troisième roman de l’auteur, le présent livre poursuit à sa manière Vurt et Pollen, ses deux prédécesseurs. Et si le point de vue de l’héroïne change forcément un peu la donne, s’instaure néanmoins une complicité entre l’auteur et le lecteur, et les clins d’œil à ce propos valent bien les références plus marquées à l’univers propre à Lewis Carroll.
À maints égards, Alice Automatique s’inscrit donc dans le « cycle du Vurt ». Le mot y apparaît (avec l’auteur lui-même !), mais d’autres traits signifiants peuvent être relevés – de la plume de Whippoorwill, que l’on peut voir j’imagine comme une sorte d’illustre précédent aux plumes de Vurt, aux chimères mi-animales, mi-humaines, en écho ou déformation fantasque de semblables hybrides déjà croisés dans Pollen ; la néomonie, au fond, peut très bien s’inscrire dans ce contexte.
Il y a donc dans tout cela quelque chose de plus profond, en guise de variation sur Lewis Carroll, que les seuls anachronismes – même s’ils ne manquent pas, bien sûr : ce décalage de 138 ans produit bien des moments savoureux, mais, avouons-le, la Manchester néomonique de 1998 n’est au fond pas moins déroutante pour le lecteur que pour Alice ; laquelle a d’ailleurs un avantage sur le lecteur – une force de caractère qui doit beaucoup à la candeur, et qui fait de notre héroïne peut-être la seule personne en mesure de traverser de bout en bout cette épreuve dans la seule optique bien prosaïque d’arriver à temps pour sa leçon d’anglais de quatorze heures… en ne prêtant guère attention à celle de midi, ou peut-être pas autant qu’elle le devrait.
NOON-SENS
C’est aussi un moyen d’injecter du « sens », ou du « Noon-sens », à l’aventure nonsensique d’Alice – parallèlement aux jeux logiques ou mathématiques parsemant le récit comme autant d’échos aux préoccupations « professionnelles » ou intellectuelles de Charles Lutwidge Dodgson. Et donc d’affirmer la singularité du roman, même s’il s’inscrit d’emblée dans un cadre hautement référentiel, et ce sans la moindre ambiguïté.
Et ça fonctionne très bien. Si l’on peut parfois lever un sourcil vaguement perplexe devant quelques jeux de mots qui passent plus ou moins bien, ou (très, très rarement, heureusement) devant tel ou tel contenu vaguement scatologique, l’exercice de style est une réussite – au point donc de dépasser cette seule dimension.
Alice Automatique est donc une belle réussite : les amateurs de Noon seront aux anges à cette lecture, les amateurs de Lewis Carroll ne sachant rien de Noon pourraient y trouver une porte d’entrée tout indiquée pour découvrir l’œuvre ô combien jubilatoire de celui qui est peut-être le plus singulier et en même temps le plus nécessaire disciple de leur idole.
Alors encore une fois merci à la Volte : Jeff Noon est immense, et il mériterait bien qu’on le lise davantage, bien davantage (je n’en reviens pas de ce qu’il ne bénéficie toujours pas d’une édition de poche ?).
Mais attention aux points de suspension, quand même… Ils ont quelque chose de menaçant...