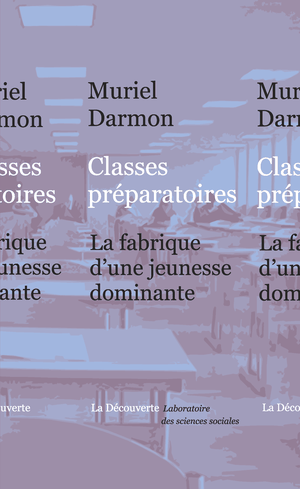C'est un ouvrage qu'il est difficile de ne pas confronter à d'autres plus anciens qui s'attachent en partie aux mêmes univers. Je pense en particulier aux ouvrages de Bourdieu où l'analyse de l'univers scolaire occupe une place très importante, par exemple La Noblesse d'Etat.
Muriel Darmon ne prend pas le contre-pied de Bourdieu, mais propose ici un travail qui en diffère un peu. Plutôt que d'entreprendre d'objectiver l'importance des classes préparatoires dans les stratégies de reproduction de la classes dominante, il s'agit ici de prendre ici pour acquis cette importance et d'analyser plus finement les médiations par lesquelles les classes préparatoires permettent cette reproduction, et de saisir les effets de ces médiations. En d'autres termes, Muriel Darmon ouvre la boîte noire : que les classes préparatoires participent de la sélection et de la reproduction de la classe dominante, soit, mais que se passe-t-il au juste au cours de ces deux, voire trois années ?
C'est là une question qui mérite plus d'attention qu'il n'y paraît. D'une part, une description fine d'une institution d'importance dans la sélection et la reproduction de la classe dominante vaut en soi qu'on s'y arrête. D'autre part, les effets de ces médiations ne s'arrêtent pas simplement aux questions de sélection et de reproduction : les institutions scolaires charrient des schèmes de classements et de comportements, des formes de rapports au monde incorporés par les agents qui exercent leurs effets bien après la consécration des concours, des diplômes et des titres. Il ne suffit donc pas de savoir que les classes préparatoires trient, classent, sélectionnent et reproduisent. Il faut encore comprendre comment elles le font, afin de saisir leur effet jusque dans les rapports aux connaissances scientifiques de ceux qui y sont passés.
L'enjeu n'est pas anodin : la part des anciens élèves de classes préparatoires est élevée dans le champ académique, y compris et notamment en sciences sociales. Saisir ce que les habitudes mentales et scientifiques des agents du champ académique doivent à leur parcours scolaire, c'est donc avancer sur le chemin d'une sociologie réflexive, c'est-à-dire d'une sociologie capable d'objectiver le sujet de l'objectivation.