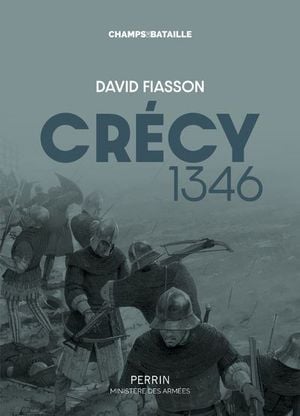Deuxième volet de la collection dirigée par Jean Lopez, spécialiste génial de la Seconde guerre mondiale œuvrant depuis des années à revaloriser l'histoire militaire en France, considérée avec dédain depuis l'Ecole des annales à partir des années 30 (on parlait d' « histoire bataille »), j'étais curieux de voir quelles méthodes pouvaient être appliquées pour étudier la guerre à la fin du Moyen Âge d'un point de vue strictement militaire. Le résultat ne m'a pas déçu. Historien à l'enthousiasme contagieux, David Fiasson propose une lecture à la fois succincte et fort détaillée de la campagne menée par Edouard III en 1346-47, s'ouvrant sur un débarquement audacieux, et donc inattendu, en Normandie (ayant, comme celui de 1944, demandé une logistique considérable), passant par la bataille de Crécy, et se terminant par la prise de Calais, qui restera anglaise jusqu'au XVIe siècle. Cette étude très méticuleuse, soucieuse de comprendre et de tenir compte du moindre détail, mobilisant de très nombreuses sources, tâchant de placer les décisions des protagonistes à l'aune des mentalités, croyances, superstitions de l'époque, remet en cause de nombreux « acquis » de l'historiographie française de la guerre de Cent Ans (que j'ai moi-même appris à la fac), il est vrai, assez moribonde et peu audacieuse. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Fiasson ne cite et ne débat presqu'avec des historiens américains ou anglais, l'histoire militaire, surtout médiévale, étant beaucoup plus active dans le monde anglo-saxon qu'en France.
La bataille de Crécy, ce désastre initial de la guerre de Cent Ans souvent conçu comme le modèle de tous les autres (Poitiers et Azincourt), où la chevalerie française fut bêtement massacrée par les archers longs anglais en chargeant frontalement dans le plus complet désordre, conserva, pour ces raisons, une grande notoriété dans la mémoire nationale française. C'est à peu de choses près ce qui s'est passé mais David Fiasson nuance un certain nombre de paramètres. Tout d'abord, les arbalétriers génois ayant ouvert les hostilités n'avaient pas leurs pavois, ceux-ci étant encore en cours d'acheminement, et n'étaient donc pas protégés comme ils l'étaient normalement des tirs adverses. De fait, Fiasson montre que si Philippe VI préconisait d'attendre l'arrivée des renforts pour livrer bataille, il fut contraint de céder à l'opinion qui avait déjà vu d'un mauvais œil son refus de livrer bataille aux Anglais trop bien retranchés à Buironfosse quelques années plus tôt. Le roi était contraint de correspondre à l'idéal chevaleresque prisé par son entourage et par la population en général. Ni roi mollasson, ni fol aventurier, Philippe VI avait au contraire mené une guerre prudente jusque là, et c'est bien ce qui lui fut reproché. Un trait significatif de l'état d'esprit de l'époque est l'insistance des députés des Etats généraux convoqués après la bataille pour continuer le combat coûte que coûte, invoquant l'urgence (irréaliste, la flotte française ayant été préalablement détruite) d'envahir l'Angleterre. La défaite de Crécy, loin d'avoir brisé le moral français, a allumé la flamme de la résistance. De l'autre côté, son rival Edouard III apparaît comme un stratège brillant, ayant mené une campagne marquée du signe de la prudence dont Fiasson montre qu'elle avait pour objectif de provoquer une victoire décisive, et non pas de piller. On apprend avec grand intérêt que de nombreux documents anglais ont été conservés, décrivant l'organisation de la logistique, la correspondance entre Edouard III en campagne et son gouvernement en Angleterre, des aspects rarement évoqués dans les monographies. De même que les combats navals, ayant joué un rôle certes marginal, mais ayant bien existé — avec de nombreuses opérations amphibies menées sur les côtes anglaises qui n'indiquaient en rien l'impossibilité d'une invasion de l'Angleterre, celle-ci n'étant pas encore, tant s'en faut, maîtresse des mers.
Crécy ne fut nullement le « tombeau de la chevalerie », comme le veut l'expression consacrée par Michelet et sans cesse reprise depuis. La ferveur pour l'idéal chevaleresque ne s'est jamais démenti jusqu'au XVIe siècle, dont Edouard III était lui-même un grand partisan (et non pas cet « esprit moderne » qu'ont voulu opposer les historiens républicains à l'aristocratie française décadente). Néanmoins, elle amorce une série de changements. Comme le note l'auteur, la guerre se faisait de façon volontaire au Moyen Âge tandis qu'elle l'est de façon contrainte à l'époque moderne ; le désastre de Crécy amorce une prise de conscience de la nécessité pour l'Etat d'organiser l'armée et de la discipliner pour ne pas mettre l'Etat au péril des hasards provoqués par le comportement potentiellement désordonné des combattants (motivés par la quête de gloire, le respect de l'honneur, ou l'appât du gain). Par exemple, un édit de 1351 essaye d'abolir le droit de fuite qui garantissait à chaque combattant la possibilité de choisir individuellement de prendre la fuite lors d'un combat, pour opposer le principe de la retraite ordonnée strictement par la hiérarchie... De même, dans un contexte où l'on considère que le peuple ne peut être imposé sans son consentement, les Français commencent à revendiquer la nécessité de contrôler les dépenses publiques afin d'éviter les gâchis d'une armée fort dispendieuse, à plus forte raison lorsqu'elle est mal employée. Tout au long de la guerre de Cent Ans une opposition vive se fera entre partisans d'une monarchie renforcée et d'une monarchie contrôlée par un Parlement. La défaite de Crécy lève également le doute sur la légitimité des Valois : n'était-ce pas un signe qu'ils n'étaient pas élus de Dieu ? De la même façon, jusqu'à la fin de la guerre, l'opinion française fut partagée entre le soutien aux Valois et à d'autres prétendants ayant été arbitrairement écarté, comme on le sait, en 1328, dont le roi d'Angleterre lui-même.