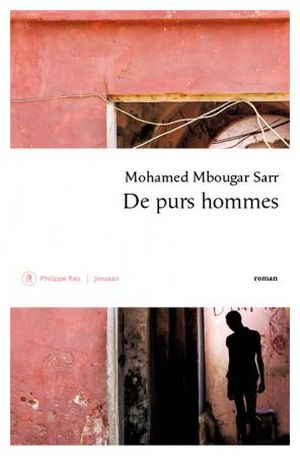Quel écho a eu, en moi, la lecture De Purs Hommes ?
Peut-être d’abord celui qu’avant que d’être, ou après avoir été un discours sur son objet – l’homosexualité – tel que vécu, ou tel que tu au Sénégal, De Purs Hommes est un discours multiple sur ce qui traverse l’homme qui vit — qui se questionne et questionne, se découvre et s’oublie ; sur l’homme-critique donc —, mais est encore un discours, comme les deux précédents romans de Mbougar Sarr, sur la littérature et le langage. Ces trois discours ne se font pas face, car indissociées dans le style de Mbougar Sarr : les questions du langage sont ici celles qui illustrent, interrogent et permettent l’existence de la question homosexuelle. En discourant par le langage de la violence, du corps et de sa sacralité, du deuil, de l’humanité ou du doute, le livre, par diffractions multiples, tout à la fois converge vers le sujet et tourne autour de lui. La promesse initiale du livre, celle de questionner nos jugements et certitudes sur l’homosexualité, n’est ici traitée que par (pour ?) la critique de notre langage, ou celle de la solitude du deuil, ou encore de la filiation. Circonvolutoire ou frontal, son discours prétend, par cette sorte de ballet, interroger le fonds de nos certitudes, leur crédit ; il prétend nous ramener à l’entraille fondamentale des choses que nous prétendons juger.
Le dernier des imbéciles est capable de donner un avis superficiel sur
un sujet qui lui est étranger. Or c’est parler des choses qu’il
faudrait, je veux dire de l’intérieur des choses, de cet intérieur
inconnu, dangereux, qui ne pardonne aucune imprudence, aucune bêtise,
comme un terrain miné…
Et c’est à interroger avec cette voix caverneuse, celle de l’intérieur, celle de l’entraille qui ne pardonne pas, celle du dedans qui compromet, que Mbougar Sarr s’emploie, avec une absence de lourdeur, de brusquerie et de valeur qui permettent, à l’inverse, de brusquer, bouleverser et appuyer, de toute la force de nos certitudes déracinées, avec nos propres doigts, nos béantes plaies morales. Par ce livre nos œdèmes moraux suppurent : nos opinions engorgées d’héritages illégitimes, imbibées de legs pris comme tels et de confortables enkystements, se penchent enfin dans le lac de leur saignée, au risque de se noyer dans leurs reflets.
Car plus que de sa spiritualité probable, plus que de ses promesses de damnation ou de salut, c’est de la potentielle humanité enclose dans chaque dogme, de cette fraternité qu’il peut permettre, que Mbougar Sarr semble vouloir traiter. De ce que toute religion, si elle se débarrasse de l’homme qui le porte, se défait également de son cœur. De ce que tout homme qui remplace en sa foi l’homme par le texte devient aussi désincarné que le texte, de ce que le dogme ne vit que parce qu’il permet à l’homme de l’habiter, de le troubler, de l’engorger. Son discours s’illustre alors par cette angoisse créée par la religion, qui, au contraire de sa vocation qui est de le rassurer, le fragilise. Face à son monde qui change, à ses opinions qui mutent, s’opposent à Dieu, rejettent plus ou moins consciemment le dogme, l’être et la société qu’incarne Ndéné baigne dans l’épouvante de la réflexion et de l’opinion personnelles : que vaut le confort d’une opinion sans conséquence face au vide creusé par sa propre opinion, murie, réfléchie, totale ? Comment aller à l’intérieur des choses sans, d’abord, y pratiquer une brèche ? Cette angoisse de ce que recèlent les choses, cette peur de l’entraille, de la tripe, de l’engloutissement, est tout à la fois une peur face à la toute-folie de la foule devant notre singularisation, et une peur du monstre-soi que nous trouverons au bout de cette solitude.
L’on ne peut s’empêcher alors, en se figurant les exhumateurs d’un cadavre supposé homosexuel à l’oeuvre, en se figurant ces colosses déterrant un homme que le tribunal moral vient chercher au cœur de son placenta dernier, de se demander où se serait placé l’imam Biram de Gelwaar. Quelle aurait été son opinion ? Lui, icône de tolérance et de fraternité, emblème immaculé de la prévalence de l’homme, de son coeur et de sa raison, sur le fanatisme et sur le dogme, aurait-il aussi arraché ce corps à sa sépulture, ou en aurait-il prononcé l’oraison ? Aurait-il fait prévaloir sa foi, l’acceptation sociale de sa foi, ou alors sa raison, son humanité, son interprétation personnelle, sa croyance débarrassée de sa lecture sociale ? Sommes-nous prêts, nous qui l’idéalisons tant, à accepter qu’il fût homophobe ?
C’est alors du plongeoir qu’en est le corps arraché, malmené, qui semble pourtant être empli de tous les troubles de la morale sénégalaise, de tous ses vices et ses paradoxes, que l’on s’enfonce ainsi dans ce qui, au fil du livre, parait être un piège. En nous montrant, non seulement le corps en lui même, mais le regard bouffi de Ndéné sur ce cadavre arraché à sa terre, l’empreinte qu’en garde son oeil englué dans la vase de sa culture, en nous montrant à la fois le choc entre la passivité du corps qu’on meurtrit jusques à son gouffre et la hantise de ce corps sur notre culture, Mbougar Sarr nous fait rentrer, brutalement, dans nos contradictions. Comment conjuguer alors la sacralité du corps dernier, celui que nous voulons être l’habit ultime de notre jugement, et la profanation qu’on lui fait subir ? Comment se penser musulman, en se rendant coupable d’une désacralisation de l’homme ? L’on se trouve à se voir sans vouloir se regarder, à se suspecter du pire, à se jeter à soi-même des regards assez obliques, et ainsi que Ndéné lui-même, à surprendre en soi des vacillements que l’on niait, où que l’on a jamais entrevus.
L’on se découvre d’abord amant du corps vivant de Rama, de ses corps-à-corps comme des monceaux défendus de sa chair, l’on se sait faible devant sa grain et son ébène, mais pourtant hystérique devant un corps enterré et enseveli. L’on se sait amoureux des enlacements langoureux prohibés par une religion trônant dessus toute question, mais pourtant, paradoxalement, tourmentés par un inerte cadavre mort, qui menacerait et les vivants et les morts et la pudibonderie des anges des cimetières.
Au Corps de la femme, terre d’inconnues et d’insaisissables, s’agrippe ensuite l’image du corps du défunt, tout autant essentialisé : le corps dans la mort cessait d’être — ou n’a alors jamais été — uniquement organique. Il devenait à la fois la vie de son propriétaire, ses actes, ses jugements, mais aussi et surtout l’avis de son entourage et de sa société, ses opinions, ses sentences, ses symboles. L’on regarde aveuglément le corps, le regard rivé sur son linceul, et l’on ne voit pourtant, uniquement, que ce qu’il n’a jamais été, c’est à dire autre chose qu’un simple corps. En ressassant ainsi l’image de son exhumation, Ndéné ne voyait plus le corps déterré, mais ce que ce corps disait de lui-même. Et de ce corps exposé à son jugement, Ndéné avait l’incidente impression que c’est son propre procès qui allait commencer. Procès sans témoins, même s’il allait devoir s’en expliquer à sa société et à sa culture, qui ne comprenaient ni ne toléraient la crise. Procès dont il allait être à la fois défendeur et demandeur, même si en fin de compte, son intégrité en serait la seule morcelée, transformée, ou détruite. Procès sourd, sans actes, qui pourtant allait devoir convoquer toute son histoire, ses attaches, ses amours, ses haines, ses combats et ses compromissions.
De Purs Hommes nous engage ainsi dans un questionnement diffringent dont la source, le thème incident, est le corps. L’homosexualité supposée du cadavre persistant n’est ici qu’un prétexte à l’auteur, au sujet et à la question qu’il veut traiter. À le relire, l’homosexualité n’y est rien de plus qu’une très bonne candidate : elle est la coupable idéale, tenancière de notre dégoût, agrégation des adresses de notre haine, celle qui, par sa pratique, montre le meilleur flanc à nos canines morales. L’homosexualité telle que traitée ici l’est moins par son essence, moins par son contenu réel, que par ce qu’implique d’inhumanité, en nous, son rejet, sa haine, sa prohibition. Si accepter l’homosexualité de l’autre, étranger mais congénère jusqu’à l’heure de sa dénonciation, revient à se renier, qu’adviendrait-il alors de notre propre humanité si nous la refusons à d’autres ? Qu’adviendrait-il de notre intégrité physique, de notre droit à la sacralité corporelle, si nous la refusons à d’autres, quelque subversifs fussent-ils ? Qu’adviendrait-il de notre droit à la rémission, à l’équité, si nous nous arrogeons le droit au jugement dernier d’un être ? D’où nous arrogeons-nous le contrat qui lie chaque être à sa conséquentialité, à ses croyances, à l’éternité de son gouffre post-mortem ?
Ce discours est alors une question ontologique sur la qualification de l’homme, sur sa légitimité en tant qu’homme, sur ce coffle qui le soude à ses semblables, ou l’en exclut. De l’inclination à la pitié, à l’amour, à la haine, ou à la solitude, les sentiments sont convoqués comme autant de témoins à la barre du procès en humanité de Ndéné. Jusqu’à cette magnifique démonstration de l’appropriation de l’homme par la violence, de son recel entier, total, dans le ventre de la violence :
J’ai toujours pensé que l’humanité d’un homme ne fait plus de doute
dès lors qu’il rentre dans le cercle de la violence, soit comme
bourreau, soit comme victime, comme traqueur ou comme traqué, comme
tueur ou comme proie. Ce n’est pas parce qu’ils ont une famille, des
sentiments, des peines, des professions, bref, une vie normale avec
son lot de petites joies et de petites misères, que les homosexuels
sont des hommes comme les autres. C’est parce qu’ils sont aussi seuls,
aussi fragiles, aussi dérisoires que tous les hommes devant la
fatalité de la violence humaine qu’ils sont des hommes comme les
autres.
Et à l’image de Terre Ceinte, Mbougar Sarr signe encore ici un bouleversant tableau du deuil. Celui d’une mère dont l’existence entière est éplorée, à l’image d’un corps malade qui ne sait plus quelle posture adopter sous la douleur, et dont chaque posture semble être une torture supplémentaire. Son discours sur le deuil et tout à la fois un tableau et une prétérition : il démontre ce que le langage ne peut jamais dire, montre les limites de l’entendement et de la langue face à la douleur d’un être. Plus que ce que la langue ne peut dire du deuil, incidemment, l’on voit ici tout ce que le deuil dit de la langue et de l’homme. Du langage, on entend le deuil dire ici, sobre, son incapacité à soulager ce que la simple présence permet de panser, à se solidariser à la peine qu’une seule poignée de main, un simple regard, un simple repas partagé, scelle entre deux êtres. Séparés pourtant par le corps absent du défunt, par la disproportion de la douleur des deux côtés du linceul, deux êtres s’adjoignent par l’unique langue que permet le deuil – celle de la silencieuse présence – à la fraternelle solidarité.
C’est alors, peut-être, sur cette incapacité ou sur ce refus de tout dire que le style de Mbougar se construit. Sur cette duplicité entre la volonté de dire, et la certitude de ne le pouvoir entièrement, sur cet intenable balancis de la parole – entre ce qu’il entend combler et sa nécessaire et préalable absence – que Mbougar entrepose son discours. Ambigu jusqu’à son écriture, jusqu’au style qui montre chaque chose par et avec son pendant, qui inocule toute vérité en nous persuadant par et grâce à son contraire, autant valides l’une que l’autre, Mbougar Sarr nous convainc de la vitale nécessité de la nuance, préalable, et peut-être même finalité, de toute recherche de vérité personnelle.
De Purs Hommes, Mohamed Mbougar Sarr. Ed. Philippe Rey / Jimsaan. 2018.
Lien vers la critique complète.