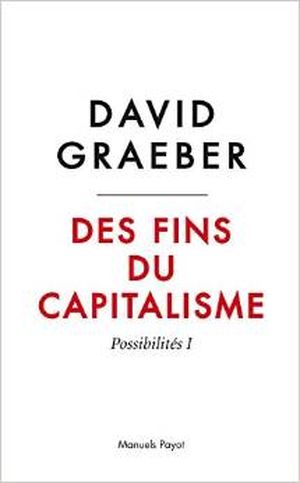L'approche des fins du capitalisme de David Graeber est essentiellement anthropologique. S'appuyant sur les nombreuses études de cette science de l'humain en ses différentes manifestations, il met en lumière que le capitalisme n'a rien du "naturel" auquel il prétend - que rien chez les êtres humains ne les prédestine à cette forme d'organisation sociale qui se révèle bien plutôt comme un reniement complet de notre humanité. Pour parvenir à ses fins, le capitalisme n'a jamais fait que poser des bornes pour circonscrire l'activité humaine dans la logique idéologique qui est la sienne, celle des possesseurs du capital justement; celle de leur vues bornées et de leur égoïsme mesquin dont chacun peut mesurer désormais les effets désastreux à l'échelle de notre planète. Au point que les "fins du capitalisme" semblent de plus en plus s'assimiler à notre propre fin.
L'important à nouveau consiste en ceci que les relations commerciales étaient dans de nombreuses sociétés typiques des rapports avec les étrangers, car elles exigeaient un travail d'interprétation minimal. Lorsque l'on a affaire à des personnes que l'on connaît mieux, d'autres formes plus complexes d'échange se présentent généralement. Cependant, ici aussi, l'introjection des relations commerciales dans les relations avec les voisins a permis de les traiter, de manière efficace, comme des étrangers.
L'analyse du capitalisme de Marx donne effectivement un rôle central à ce phénomène : il s'agit d'un effet particulier du marché pour effacer des transactions antérieures et créer de fait un voile d'ignorance entre les vendeurs et les acheteurs, les producteurs et les consommateurs. Ceux qui achètent un produit n'ont généralement aucune idée de qui l'a fait et dans quelles conditions il a été fait. Cela, comme on sait, se traduit par le "fétichisme de la marchandise".
Tout cela a évidemment contribué à établir les structures définitoires du capitalisme : à savoir un moteur de production infinie qui ne peut maintenir son équilibre que par une croissance continue. Des cycles infinis de destruction semblent alors constituer nécessairement l'autre face de ce processus. Pour ouvrir la voie à de nouveaux produits, il faut se débarrasser de ces rebuts; les détruire ou au moins les écarter comme démodés ou dénués d'intérêt. Et c'est bien cela la structure qui permet de définir la société de consommation : une société qui écarte toute valeur durable au nom du cycle sans fin de l'éphémère.
On mettra utilement cet ouvrage en relation avec celui de Pierre Clastres " La Société contre l’État : Recherches d'anthropologie politique "