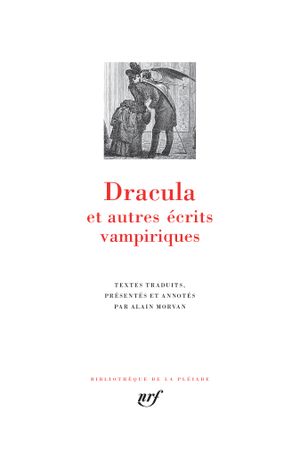[Dracula et autres écrits vampiriques, Bibliothèque de la Pléiade, 2019. Edition établie par Alain Morvan.]
Ce tome de la pléiade, encadré de nouveau par Alain Morvan, fait en quelque sorte suite à un premier volume qui avait été précédemment consacré aux romans gothiques anglais, jusqu’à Frankenstein. Ce second volume documente cette fois-ci la progressive popularisation de la figure littéraire « moderne » du vampire, de ses premières évocations chez les poètes romantiques anglais (Southey, Coleridge), en passant par la pose des premiers jalons du mythe moderne (Byron, Polidori), jusqu’à sa consécration-fixation quasi-définitive dans tous ses grands topoï contemporains chez Bram Stoker (à cela s’ajoute en toute fin de recueil un étonnant roman « colonial gothic » de l’autrice Florence Marryat, plus difficilement classable).
Après le précédent Frankenstein, l’essor de la littérature vampirique est aussi l’affirmation de véritables « récits de monstres » (qui seront plus tard largement exploités au niveau cinématographique), centrés sur des figures spécifiques d’un folklore ancien et populaire, réactualisées pour l’occasion. Les récits vampiriques sont également en tous points des descendants et représentants du genre gothique, avec la mise en scène d’un affrontement entre un bien martyrisé et un mal tentateur, le tout sur fond de folklore religieux chrétien, avec un goût pour l’exotisme, les décors lugubres, morbides et moyenâgeux, les scènes choc et les sous-textes érotiques.
Mais revenons-en à l’origine-même du vampire. L’idée du « non-mort » qui revient hanter les vivants joue un véritable rôle anthropologique : il est un outil social qui permet de désigner des boucs-émissaires (souvent des personnes étrangères et/ou des marginaux) pour justifier toutes les calamités qui peuvent s’abattre sur une communauté et la ressouder dans l’adversité. Plus largement, le vampire, avec ses attributs très spécifiques, et notamment son appétit pour le sang, s’inscrit dans une gamme plus large de revenants « matériels » que l’on retrouve dans les croyances de quasiment toutes les civilisations sous des attraits divers.
Le terme « vampire », originaire d’Europe de l’est (origine slave), s’est finalement imposé dans nos cultures/imaginaires et dans nos langues à travers la production littéraire d’Europe de l’ouest (Allemagne, France, Angleterre), parmi tout un ensemble de termes/créatures proches : « oupyr » russes (espèces de sorciers qui reviennent après la mort), « strigoi » du folklore roumain (revenants qui aspirent l’énergie vitale de leurs proches), « varcolac » ou « vrykolakas » en grec (sortes de loups-garous, mais parfois associés à des pratiques vampiriques).
Ce folklore d’Europe centrale et balkanique a lui-même ses racines dans des sources bien plus anciennes : le terme « strigoi » vient ainsi directement des stryges, ces démons mi-femmes mi-oiseaux du folklore romain, poussant des cris perçants et s’en prenant aux nouveaux-nés pour boire leur sang (ainsi qu’aux cadavres pour les dévorer). On peut également citer la figure de Lamia dans le folklore de la Grèce antique (démon femme-serpent s’en prenant aux hommes et aux jeunes enfants), le succube d’origine judéo-chrétienne (serviteur de Lilith – la 1ere femme d’Adam, avant Eve, selon des légendes juives datant du moyen-âge), ou encore la goule d’origine arabe, etc., tous des démons d’apparence féminine. Toutes ces créatures diverses ont par ailleurs fait le bonheur des auteurs romantiques au début du 19e siècle, ainsi que des peintres préraphaélites.
Le vampire littéraire a dans un premier temps été importé dans nos contrées au travers de récits de voyageurs et autres compilateurs, notamment dans la 1ere moitié du 18e, période coïncidant avec une véritable « épidémie » de vampirisme en Europe de l’est – comparable aux épidémies de sorcellerie des siècles précédents –, dans un contexte géopolitique complexe (guerre entre empire austro-hongrois et empire ottoman, famines, épidémies, etc.). Sont alors déjà rapportés certains des « remèdes » depuis associés classiquement à la lutte contre les vampires : destruction par le feu, décapitation, pieu dans le cœur, etc.
L’ecclésiastique Dom Calmet a proposé en 1746 un livre de référence (« Dissertations sur les apparitions des anges, des démons et des esprits, et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Bohême, de Moravie et de Silésie »), où il compile un très grand nombre de récits folkloriques, dans une optique plus ou moins « critique », et où il distingue clairement entre revenants spirituels/immatériels (fantômes, esprits) et revenants « en corps »/matériels (bref, les morts qui sortent physiquement de leur tombe). Mais à cette époque, les « vampires » demeurent encore des entités passablement abjectes et repoussantes (on est plus proche du zombie pour le coup). Cf. sur ce sujet l’excellent podcast qu’a consacré France Culture à la réédition de cet ouvrage de Dom Calmet !
Il faudra donc attendre le tournant romantique de la 1e ½ du 19e siècle pour voir la transformation du vampire peu ragoutant du 18e en la créature ambivalente et tragique, mi-attractive (voire carrément dandy), mi-repoussante, que l’on a tous en tête aujourd’hui (et qui, soit dit en passant, réactive se faisant une ambivalence qui était déjà souvent présente chez les démons pré-vampiriques gréco-latins et judéo-chrétiens que nous avons cité plus haut). N'y allons cependant pas par 4 chemins : les écrits proposés ici de cette période « romantique » (Southey, Byron, Coleridge, Polidori – et qui, pour les 3 premiers d’entre eux, sont seulement des extraits/ébauches) présentent aujourd’hui davantage un intérêt historique que véritablement littéraire – même si Polidori, en reprenant et en parachevant un brouillon laissé en plan par Byron suite au fameux défi de la villa Diadoti (qui aura aussi donné naissance à Frankenstein !), peut bien se vanter, malgré des dons littéraires de toute évidence limités, d’être en quelque sorte le géniteur du vampire dans sa forme moderne (un vampire aristocrate, immortel, aussi étrange que fascinant, notamment pour la gente féminine, etc.).
Mais alors que cette genèse romantique du mythe vampirique est analysée en long en large et en travers par Alain Morvan, on ne peut clairement pas en dire autant de la période séparant le « vampyre » de Polidori (1819) du Dracula de Stoker (1897). La nouvelle Carmilla de Sheridan Le Fanu (1871) est le seul texte qui nous est proposé pour combler cette césure : si le texte est sympathique au demeurant, issu d’un recueil plus large (« In the glass darkly »), il est avant tout resté célèbre a priori pour la dimension quasi-saphique de la relation dépeinte entre ses 2 principaux personnages féminins (faisant de Carmilla la représentante d’une littérature proto-queer) ; et il est vrai par ailleurs que le texte de Le Fanu n’est pas sans évoquer l’ambiance à venir de Dracula (Stoker était un véritable amateur de Le Fanu), même s’il fait pour sa part le choix de s’inscrire dans la lignée des vampires/ « mortes amoureuses » féminins (à la manière du Christabel inachevé de Coleridge), c’est¬-à-dire dans la lignée des démons antiques plutôt que slaves – faisant également écho aux thématiques développées par les peintres préraphaélites dans la seconde ½ du 19e, qui raffolèrent de telles créatures aussi démoniaques que tentatrices.
Cette impression de césure au cœur de 19e siècle est de toute évidence due en partie au fait que notre compilateur, Alain Morvan, fait explicitement le choix de ne se focaliser que sur la littérature anglaise, laissant de côté d’autres œuvres européennes (notamment françaises et allemandes) qui auraient eu tout autant leur place, à commencer par La Morte amoureuse de Théophile Gautier (1836), dont on a du mal à croire qu’elle n’ait pas largement influencé la nouvelle de Le Fanu, sans parler, pour revenir aux origines de la période romantique, du poème La Fiancé de Corinthe de Goethe (1797), qui aura eu de toute évidence une forte influence sur les romantiques anglais, et qui est souvent présenté comme la première œuvre moderne véritablement vampirique. Mais, même en restant scrupuleusement dans le domaine anglais (le domaine de prédilection d’Alain Morvan, qui assure lui-même la (re)traduction de toutes les œuvres présentées dans le volume), on restera par exemple sur notre faim concernant le roman-feuilleton (relevant de la production « penny dreadful ») Varney the Vampire ; or, The Feast of Blood (1845-1847), qui eut, a priori, pas mal de succès à son époque et une large influence sur la représentation grand public du vampire (il s’agit par exemple d’un des premiers vampires littéraires à maudire explicitement sa condition, tout en y étant condamné). Si Alain Morvan cite bien toutes ces œuvres dans son abondante préface, et justifie notamment le choix de ne pas intégrer Varney par sa longueur pléthorique et une qualité littéraire discutable, on regrette néanmoins de ne pas avoir eu tout de même quelques chapitres à se mettre sous la dent (c’est le cas de le dire), pour se faire une idée plus précise de ce type de littérature très populaire, et donc très influente (à défaut d’être littérairement mémorable).
On en arrive aux deux très dissemblables romans de 1897 qui viennent conclure le recueil (Dracula et Le Sang du vampire). On conçoit bien qu’il existe des différences sensibles entre ces romans de la toute fin du 19e siècle et les romans qui nous avaient été précédemment proposés dans le tome sur les romans gothiques anglais, à environ un siècle de distance entre eux. D’une part, Dracula et Le Sang du vampire se font le reflet des mœurs anglaises de leur époque de création (soit la toute fin de la période victorienne, 1837-1901, qui a correspondu à l’apogée et du capitalisme et du colonialisme anglais) et se révèlent notablement plus « corsetés » moralement que leurs prédécesseurs. Si les protagonistes mis en avant demeurent la plupart du temps membres de la haute-bourgeoisie ou de la noblesse anglaise (on est ici toujours bien loin des aventures du petit peuple – bien au contraire, on peut même considérer que le Dracula de Stoker présente une vision assez méprisante des classes populaires anglaises, constituées à l’en lire uniquement d’ivrognes patentés, toujours prêts à être achetés pour un petit verre de remontant…), on reste par exemple bien loin des exubérances en termes de violence et de sexualité du Moine de Lewis ou encore de Vathek de W. Beckford, qui nous avaient été proposés dans le précédent tome. A cet égard, les productions d’un Poe, ou encore certaines fictions horrifiques « décadentes » françaises de la fin du 19e semblent autrement plus radicale. Il est ainsi notable que le Bram Stoker’s Dracula de Coppola (1992) soit finalement bien plus explicitement sexualisé que le roman d’origine dont il se prévaut.
Avec ces 2 romans de 1897, on s’éloigne ainsi résolument du modèle du roman d’aventure du 18e et du théâtre shakespearien, pour aller plutôt vers un mélange de romans « de faits divers » et de romans « scientifiques » (cf. Dracula et son utilisation des journaux et de multiples nouveautés techniques de son temps, qui permettent à Stoker de mettre en scène une opposition entre la modernité technique de l’Angleterre de la fin du 19e et l’arriération du Comte Dracula et de sa Roumanie natale), voire (dans le cas du Sang du vampire de F. Marryat) du roman de villégiature bourgeois.
Une autre dimension frappante de ces 2 romans conclusifs, qui les démarque nettement des romans gothiques du tournant du 19e siècle, est leur dimension (quasi-)explicitement coloniale (qui les rattache plus ou moins directement au sous-genre très spécifique du « colonial gothic » anglo-saxon). Nous avons déjà évoqué ci-dessus le diptyque civilisation/barbarie dans Dracula, particulièrement sensible lors des séquences en Roumanie, où les populations Roms, notamment, sont présentées comme de purs serviteurs du mal en voie de dégénérescence…Cet aspect colonial se retrouve également sans fard chez F. Marryat, dont l’anti-héroïne est clairement racialisée et présentée, par son hérédité métisse-même, comme un produit décadent d’un milieu colonial arriéré (La Jamaïque), et dont le destin sera marqué par une fatalité toute « biologique » (mais reflétant surtout les conceptions racistes de l’époque tendant à objectiver scientifiquement les inégalités raciales…). La sentence qui condamnera irrémédiablement l’héroïne nous est d’ailleurs assénée par un médecin « deux ex machina » ayant précédemment séjourné à La Jamaïque – sorte de cousin anglais, mais beaucoup plus barbant, du truculent Van Helsing du roman de Stoker.
Toutefois, il serait dommage de s’arrêter à ces seules considérations. Si le roman de F. Marryat est, là encore, plus une curiosité qu’autre chose (bien qu’écrit d’une plume efficace, avec une belle galerie de personnages, dont une « baronne » très haute en couleur), le Dracula de Stoker est, sans conteste possible, le chef-d’œuvre du volume. S’il présente clairement certaines limites (outre les éléments évoqués plus haut, on regrettera notamment un format épistolaire qui parvient difficilement à demeurer vraisemblable, tant tous nos personnages semblent de véritables graphomanes impénitents – évoquant là le défaut récurrent du genre cinématographique « found-foutage », dont Dracula pourrait être considérée comme un lointain ancêtre), c’est aussi l’affirmation d’une horreur plus frontale et assumée, « démonstratives » et généreuse en « effets » horrifiques (quasiment pré-cinématographiques), moins psychologique (on est très loin du fantastique « à la Topalov »), centrée sur la peur de l’Autre (avec un grand A), de l’invasion de nos sociétés par une entité étrangère aussi irréconciliable que maléfique. Avec de nombreuses séquences très impactantes et mémorables (les agissements de Dracula et de ses succubes dans son château des Carpates ; l’arrivée du bateau Déméter dans le port ; la mort de Lucy, etc.), portées par une belle plume, Dracula annonce également l’horreur américaine qui va bientôt prospérée dans les magazines pulps (Lovecraft en tête), et l’on comprend dès lors sans peine la longue influence qu’aura pu avoir ce roman, faisant dès lors du vampire une figure incontournable de la « pop culture » postérieure, non seulement littéraire, mais également (et surtout) cinématographique.
A la fin de ce voyage en vampirie, l’on repartira un chouïa frustré en refermant ce fort volume. N’y aurait-il pas eu également de belles œuvres du 20e siècle à intégrer à ce recueil pour suivre les évolutions ultérieures de la figure du vampire (par exemple, si l’on trouve bien désormais dans Dracula des éléments comme l’ail, l’absence de reflet, ou le fait qu’un vampire ne puisse pénétrer dans une demeure sans y être invité, l’antagoniste vampirique a toutefois toujours la possibilité, dans cette diégèse, de se promener en plein jour, même si ses pouvoirs en sont amoindris)? Ce sera peut-être pour un prochain recueil, dans la Pléiade ou ailleurs !
Œuvres et évènements repères sur le vampirisme, en lien avec le recueil (en gras les œuvres littéraires présentées dans leur intégralité) :
1801 : « Thalaba the destroyer », poème narratif de Robert Southey
1813 : « Giaour, fragment d’un conte turc », poème narratif de Lord Byron
1816 [mais écrit sur la période 1797-1800] : publication de « Christabel » de Samuel Taylor Coleridge (poème inachevé)
Poème récité par Byron à ses amis à la villa Diodati au bord du lac Léman près de Genève en 1816
1819 : « The Vampyre : A Tale » de John William Polidori (écrit à 24 ans), inspiré d’un texte de Byron « A Fragment » (brouillon inachevé) qui sera publié quelques mois plus tard.
1836 : publication de « La Morte amoureuse » de Théophile Gautier
1845 : Début de la publication de « Varney the Vampire ; or, The Feast of Blood », publication périodique généralement attribuée à James Malcom Rymer et Thomas Peckett Prest.
1848 : fondation du mouvement pictural préraphaélite par Dante Gabriel Rossetti (apparenté à John Polidori), avec William Holman Hunt et John Everett Millais.
1871 : « Carmilla » de Sheridan Le Fanu, nouvelle publiée l’année suivante dans « In a glass darkly » (recueil de 5 nouvelles)
1897 : publication de « Dracula » de Bram Stoker et de « The Blood of the Vampire »de Florence Marryat.
1922 : « Nosferatu, une symphonie de l’horreur », film de Friedrich Wilhelm Murnau.
1931 : « Dracula », film de Tod Browning avec Bela Lugosi pour la Universal.