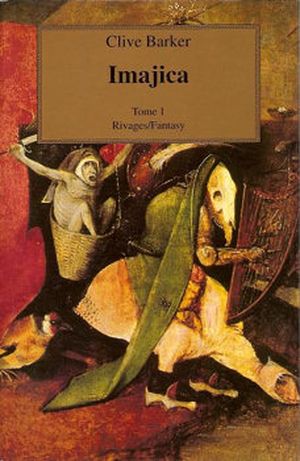Clive Barker est chrétien, peintre, gay et génial. Pas forcément dans cet ordre, mais ces attributs font de son œuvre quelque chose de foisonnant, de baroque, de multistrate et de foncièrement déviant. Pas exempte de défauts : la complaisance, la surcharge et la verbosité n’en sont pas les moindres. Mais il n’y en a pas trace dans les quelque 1000 pages d’Imajica, et de toute façon même ces défauts n’altèrent en rien son altérité radicale, quand ils ne la nourrissent pas comme dans Coldheart Canyon. Clive Barker est génial.
Dans les littératures de l’imaginaire, Barker est de ceux qui cassent les normes, traversent les genres et changent les règles du jeu : comme il y a un avant et un après Maupassant, Poe, Lovecraft, Matheson, il y a un avant et un après Barker. Dans la littérature tout court, il s’impose par la force polysémique de ses visions, la richesse et l’originalité de ses personnages métamorphiques, l’imagination imprévisible de ses intrigues et la beauté picturale de son écriture à la fois ciselée et épique. Imajica est son chef d’œuvre – ou plutôt son grand œuvre, tant Barker apparaît comme le plus chrétien des alchimistes.
« Je suis un homme, et les hommes sont des animaux qui racontent des histoires. C’est là un don de Dieu, qui fit advenir notre espèce par le verbe, mais laissa la fin de notre histoire inachevée. Ce mystère nous trouble. Sans la fin, comment pouvons-nous donner un sens à nos vies ?
Alors nous racontons nos propres histoires, dans une imitation jalouse et fiévreuse de notre Créateur, espérant que nous tomberons par hasard sur ce que Dieu nous a tu. Et qu’en finissant notre récit, nous parviendrons à comprendre pourquoi nous sommes nés. » (Prologue de Sacrements)
Bien qu’Imajica supporte sans problèmes plusieurs niveaux de lecture, de la fantasy ingénieuse à la mythologie spécifique, je pense qu’on tient là l’ultime palier, LA réponse de Barker à son questionnement follement ambitieux, tant la magie, qu’elle soit de l’ordre de l’horrifiant, du merveilleux ou de l’érotique, y apparaît comme l’outil d’un cheminement spirituel élevant à une Révélation. En cela la rigueur et la cohérence extraordinaires de cette structure monumentale truffée de sous-intrigues dont aucune n’est gratuite évoque irrésistiblement ces cathédrales qui écrasent le touriste profane et vaguement conscient que « c’est beau », et fascinent l’amateur avisé qui sait que « ça parle » et reviendra y contempler jusqu’à la moindre gargouille.
Mais même au niveau spirituel, Imajica supporte encore deux grilles de lecture, antinomiques et inséparables : l’une, blasphématoire, qui dynamite le christianisme comme mythologie, avec cette figure christique qui s’ignore dans une identité de faussaire minable et voluptueux, avec cette Vierge séquestrée et avide de vengeance, avec ce Jéovah complètement taré et pas particulièrement malin ; l’autre, iconoclaste, qui réinvente le christianisme comme message, avec une redistribution des cartes inédite et brouillée entre le Bien et le Mal (jamais de manichéisme chez Barker), avec une réhabilitation et une promotion du Féminin contre le Masculin, avec une redéfinition fondamentale des notions d’épiphanie, de révélation et de rédemption. Le lien entre les deux étant assuré par l’enjeu principal de l’intrigue : le Maestro d’aujourd’hui parviendra-t-il enfin à réconcilier la Terre avec les quatre autres Empires de l’Imajica, dont elle est séparée depuis si longtemps ? En clair, pouvons-nous aujourd’hui retrouver nos dimensions spirituelles dont nous sommes séparés depuis si longtemps ?
Que ses lecteurs actuels le perçoivent ou non, il y aura un avant et un après Imajica, le Troisième Testament.