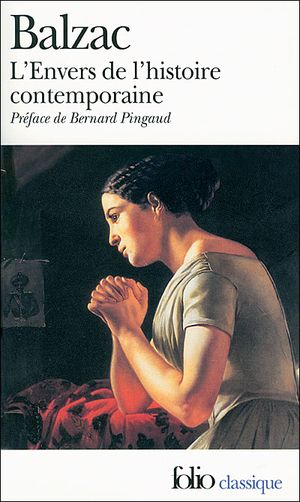L’envers de l’histoire contemporaine a comme postulat de départ assez intriguant le choix de Godefroy ( revenu du journalisme et d’autres expériences professionnelles infructueuses) de se tourner vers une entreprise de charité suite à son arrivée chez une logeuse particulière au passé contrarié. Dans cette première partie, Madame de la Chanterie, Balzac met en place son intrigue où l’intérêt est de montrer comment Godefroy plus animé par la volonté d’être utile à son prochain, va finir par entrer dans un système plus ambivalent qu’il ne le paraît. L’histoire de Madame de la Chanterie révélée à Godefroy par un pensionnaire, est aussi l’occasion pour l’écrivain de revisiter les thèmes de la chouannerie, de la trahison mais aussi de la rédemption qu’il a aimé aborder dans d’autres romans de sa Comédie Humaine. En tant que lecteur, j’ai pu concevoir l’esprit aventureux du personnage voulant découvrir l’assistance à des gens en difficulté mais j’ai eu du mal à accepter son relatif manque de jugement initial par rapport aux gens qui décident de lui mettre la main à l’étrier. Ces derniers étant liés à Madame de la Chanterie pour le fait qu’elle soit devenue une « sainte »vue les circonstances de sa vie.Quelque part, le romanesque demande une adhésion totale que j’ai eu du mal à avoir dans cette œuvre de Balzac. La deuxième partie du livre, L’initié, présente la première expérience de charité « sous couverture » de Godefroy où il doit aider un magistrat retraité dont la fille souffre d’une maladie rare ( entraînant symptômes physiques et mentaux très invalidants) et est clouée au lit. Là encore, Balzac , nous présente un deuxième microcosme assez particulier puisque l’aide est dévolue à une famille plutôt aisée où l’utilisation des ressources sert à donner du confort. Le génie de Balzac, c’est de faire entrer en résonnance ses deux parties pour finalement révéler au grand jour l’implication véritable de Godefroy dans toute cette affaire.Quelque part, ce roman échafaudé dans les dernières existences de l’écrivain démontre sa toujours plus immense lassitude face au genre humain, et sa description comme celle du médecin guérisseur, de la logeuse de Monsieur Bernard peu scrupuleuse en sont la démonstration. D’autres personnages comme Auguste ( petit fils du magistrat) ou celui de Népomucène ( petite cheville ouvrière et misérable de la mère Vauthier) sont emblématiques de la lutte dans l’adversité et apportent une lumière bienvenue. L’autre versant intéressant du personnage de Vanda ( la fille souffrante), c’est ses origines polonaises ( et on devine aisément qu’elle est une version « déguisée » de Madame Hanska, confidente et amante de Balzac). C’est là où l’entreprise fictionnelle de l’écrivain est relative puisqu’elle convoque des personnalités bien réelles de son entourage. Dernier point sur la question la charité est elle toujours désintéressée? À la lecture de ce roman, Balzac démontre fermement dans sa deuxième partie L’initié que beaucoup de gens aidés le sont parce qu’ils sont riches et peuvent prétendre un jour rendre les sommes engagées pour leur porter secours. Voilà l’envers de ce décor où générosité rime avec créance, où aide induit retour « sur investissement ». Comme Godefroy à la fin du roman, vous êtes émoussé et quelque peu lessivé par ce que vous avez traversé pendant cette aventure à double tranchant. Même si l’aspect sociologique développé par Balzac, est juste et sans concessions face aux finalités de l’Argent, il est difficile d’entrevoir une morale sur ce monde où on aide les riches par intérêt. Et l’inclination naturelle est de rendre le vrai sens du mot charité : celui d’aider le plus démuni des hommes en pleine conscience et sans rien attendre en retour. Une réalité galvaudée au dix-neuvième siècle et disons le assez écœurante.