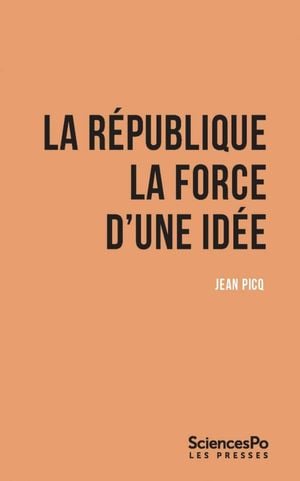Publication originale : https://journals.openedition.org/lectures/50455
Il faut être républicain face à l’ennemi !
La république est régulièrement évoquée, voire invoquée par les acteurs politiques, mais son contenu est rarement précisé. Le terme est parfois utilisé à la manière d’une injonction : « il faut être républicain face à l’ennemi ! », que celui-ci soit le Rassemblement national, l’abstention, ou la perte de principes tels que laïcité et la liberté d’expression. Ces appels et leur caractère versatile sont autant de rappels que le républicanisme est un projet politique qui nécessite un effort permanent afin d’être défini et renouvelé, sans quoi il risque de périr. Tel est le message principal de l’ouvrage de Jean Picq, juriste de formation, ancien fonctionnaire et professeur associé à Sciences Po.
En quoi le républicanisme est-il une idée forte dans l’histoire de nombreux pays européens ?
La pensée de l’auteur est organisée autour de deux séries de questions. Dans un premier temps, il s’interroge sur la nature de la république, et plus particulièrement sur la spécificité de la République française au regard de son évolution historique dans le contexte européen et, dans une moindre mesure, nord-américain. En quoi l’histoire de l’État et de la nation françaises est-elle fortement liée à la république comme régime et au républicanisme comme idéologie politique ? En quoi le républicanisme est-il une idée forte dans l’histoire de nombreux pays européens ? Dans un second temps, l’auteur pose des questions de nature plus politique, qui portent sur les institutions républicaines françaises. Comment préserver l’héritage républicain tout en renouvelant la république afin de répondre aux défis politiques, économiques et sociaux actuels1 ?
L’ouvrage est découpé en six chapitres. Les quatre premiers chapitres mettent en exergue la diversité du passé républicain en France, tandis que les chapitres cinq et six sont tournés vers les défis présents et futurs. L’ouvrage constitue une défense informée du régime républicain à la française et plus particulièrement de la Cinquième République, qui pour l’auteur s’est éloignée de l’équilibre entre pouvoir présidentiel et pouvoir gouvernemental sur lequel elle a été pensée à ses origines. L’ouvrage a l’allure d’un essai qui mobilise une large bibliographie et laisse une place généreuse à l’histoire des idées politiques et à la philosophie politique, en s’appuyant particulièrement sur les travaux de l’historienne Mona Ozouf, mais également des philosophes Blandine Kriegel, Simone Weil et Hannah Arendt.
Le républicanisme dans tout ses états
Dans le premier chapitre, Jean Picq ouvre des perspectives historiques en replaçant la République française dans le contexte plus large du républicanisme européen et états-unien. Des auteurs du républicanisme classique sont alors évoqués – Thomas d’Aquin, Machiavel, Cicéron et Aristote entre autres – afin de préciser en quoi leur pensée a influencé leur époque. En outre, un effort particulier est fourni afin de montrer l’apport dans la pensée politique de trois moments : la révolution hollandaise, la « Glorieuse Révolution » anglaise et la révolution américaine. Ainsi, Jean Picq va discuter de ces évènements en parallèle d’auteurs clefs qui s’en sont respectivement nourris pour forger leur pensée : Baruch Spinoza, John Locke, et les Pères fondateurs américains – en particulier Madison qui est évoqué indirectement à travers la lecture qu’en fait Tocqueville.
Dans quelle mesure la Révolution de 1789 et la république sont-elles liées ? La république est-elle réductible au moment révolutionnaire en France ?
Le second chapitre revient sur une discussion déjà bien présente dans la littérature sur l’histoire de France : dans quelle mesure la Révolution de 1789 et la république sont-elles liées ? La république est-elle réductible au moment révolutionnaire en France ? La réponse proposée par Jean Picq reprend les travaux de Juliette Grange2, Blandine Kriegel3 et Mona Ozouf4 : si le régime républicain est apparu en France après la Révolution, certaines idées républicaines – la recherche de principes fondamentaux, l’autonomie des villes et des universités, le respect de l’ordre public – étaient présentes bien avant. L’auteur, en reprenant les travaux de Claude Nicolet5, insiste tout particulièrement sur la continuité de la souveraineté de la nation, qui était présente bien avant la Révolution française.
Les chapitres trois et quatre passent en revue les institutions républicaines françaises de 1870 à 1958. Jean Picq y donne les raisons de la longévité de la Troisième République, ainsi que les causes de sa chute. Pour lui, la force du régime repose sur trois axes : le premier est son école au service de l’idéologie laïque ; le second renvoie à son armée coloniale et surtout au service militaire qui permit de générer un attachement aux institutions ; le troisième concerne ses libertés qui préfigurent l’État de droit contemporain actuel.
de Gaulle était-il réellement républicain ?
Une place conséquente est laissée à Charles de Gaulle et à son rapport avec les institutions républicaines, qui occupe non seulement le chapitre quatre, mais revient parfois en citations à d’autres moments de l’ouvrage. Si pour Jean Picq l’apport du général à la République française ne fait pas de doute, il remarque néanmoins qu’elle semble par moment absente de ses prises de parole. Jean Picq va alors poser la question suivante : de Gaulle était-il réellement républicain ? L’auteur y répond par l’affirmative, en rappelant l’importance pour l’ancien militaire de l’unité du peuple français autour d’un projet républicain et d’un État unifié à son service.
Les deux derniers chapitres de l’ouvrage forment un éloge du républicanisme à la française, et plus particulièrement de la Cinquième République. Ils constituent la contribution originale de l’auteur ainsi que sa thèse principale, à savoir que la Cinquième République gagnerait à retrouver sa dimension parlementaire, à retrouver une figure présidentielle plus distante des querelles de partis, et à réaffirmer son attachement et son engagement dans le projet européen.
Dans le chapitre cinq, Jean Picq met en avant les dynamiques européennes du républicanisme dès le moyen-âge, en insistant sur les liens transnationaux à l’appui des travaux de George Steiner6. L’ouvrage s’écarte un peu de sa question centrale afin de discuter plus en détail des liens entre l’Europe et la France – et non uniquement la République française. L’auteur offre alors sa vision politique des relations entre la France et l’Europe en insistant sur la nécessité de l’Union européenne pour la République française (p. 189).
Les trois cohabitations entre 1986 et 2002 ont montré la force du régime républicain
Dans le dernier chapitre, Jean Picq propose sa lecture des institutions de la Cinquième République en dénonçant la dynamique de présidentialisation du régime, en même temps que le raccourcissement du mandat de président, l’affaiblissement du Parlement, et l’affaiblissement de la justice face aux doutes qui émergent concernant son indépendance (p. 194). Pour l’auteur, les trois cohabitations entre 1986 et 2002 ont montré la force du régime républicain, qui a su trouver un équilibre en témoignant du potentiel rôle de contre-pouvoir que pouvait – et doit selon l’auteur – incarner le président face à un gouvernement composé par une autre famille politique que la sienne.
Ce chapitre permet d’aborder ce que Jean Picq appelle la « crise du commun » (p. 217) définie comme une perte de confiance à l’égard des institutions. Elle se manifesterait à travers les crises récentes, et en particulier celle des Gilets jaunes. L’auteur évoque les écrits du journaliste David Goodhart pour discuter de la fragmentation de ce commun, en mettant en avant la fracture de classe entre « gagnants et perdants » de la mondialisation. Contre l’individualisation des sociétés, Jean Picq rappelle l’importance « d’accepter des sacrifices pour le bien de tous » (p. 220-221).
En dépit de la volonté d’élargir les horizons de réflexion en mélangeant approche historique, philosophique et institutionnelle, il est parfois difficile de situer le propos de l’auteur entre ces trois niveaux
En dépit de la volonté d’élargir les horizons de réflexion en mélangeant approche historique, philosophique et institutionnelle, il est parfois difficile de situer le propos de l’auteur entre ces trois niveaux. Par moments, l’auteur évoque le potentiel de « la République » pour relever les défis contemporains – tels que l’écologie – sans préciser de quelle république il s’agit : l’institution actuelle, l’idéologie républicaine à la française, ou bien le républicanisme philosophique ? À d’autres endroits, les propos normatifs semblent découler du constat historique. Par exemple, le dernier chapitre mélange discussion sociologique autour de la cohésion sociale et discussion philosophique autour du bien commun. Ainsi, lorsque Jean Picq évoque le rôle important de la laïcité et de l’armée dans la création d’institutions républicaines légitimes, est-ce seulement un constat historique ou est-ce également une réponse définitionnelle à ce que doit être le républicanisme ? Comment les évènements historiques évoqués par l’auteur informent-ils les réflexions théoriques sur le républicanisme ? Enfin, notamment en fin d’ouvrage, le propos semble avoir une portée davantage politique qu’analytique, notamment lorsque l’auteur évoque sa vision de la Cinquième République.
le lecteur regrettera l’absence d’une discussion serrée sur certains enjeux qui semblent pourtant au cœur de l’agenda politique et du bien commun actuels : comment le républicanisme peut-il nous aider à résoudre les oppressions liées au genre, à la classe et à la race ?
Pour conclure, si un certain nombre d’enjeux politiques sont évoqués par l’auteur comme autant de défis pour « la République », le lecteur regrettera l’absence d’une discussion serrée sur certains enjeux qui semblent pourtant au cœur de l’agenda politique et du bien commun actuels : comment le républicanisme peut-il nous aider à résoudre les oppressions liées au genre, à la classe et à la race ? En quoi l’idée républicaine contient-elle un projet politique original et différent des idéologies libérales si répandues dans d’autres pays face à ces enjeux ? Comment le républicanisme français peut-il créer du commun tout en tenant compte des particularismes et des exigences éthiques contemporaines en matière de reconnaissance de la pluralité7 ? Des questionnements qui ont été largement ouverts il y a déjà plus de dix ans dans la littérature scientifique, notamment par Cécile Laborde8, Marie Garrau9, ou avec les travaux dirigés par Olivier Christin10 dans le cadre du Centre européen des études républicaines, et qui ne trouvent toujours pas d’écho institutionnel dans la Cinquième République.
1 L’auteur reste vague à propos de ces défis. Il évoque en particulier la montée des inégalités sociales, et mentionne « la crise écologique » à travers le dernier ouvrage de Serge Audier, mais sans entrer en discussion avec ses idées (cf. Audier Serge, La Cité écologique. Pour un éco-républicanisme, Paris, La Découverte, 2020).
2 Grange Juliette, L’idée de République, Paris, Pocket, 2008.
3 Kriegel Blandine, La République et le Prince moderne, Paris, PUF, 2011.
4 Ozouf Mona, De Révolution en République. Les chemins de la France, Paris, Gallimard, 2015.
5 Nicolet Claude, L’Idée républicaine en France. Essai d’histoire critique, Paris, Gallimard, 1982.
6 Steiner George, Une certaine idée de l’Europe, Arles, Actes Sud, 2005 [2004].
7 On pense notamment au débat entre Nancy Fraser et Axel Honneth autour de la reconnaissance et de la redistribution dans une société juste. Voir Fraser Nancy et Honneth Axel, Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange, Londres, Verso, 2003.
8 Laborde Cécile, Critical Republicanism. The Hijab Controversy and Political Philosophy, Oxford, Oxford University Press, 2008.
9 Garrau Marie, Politiques de la vulnérabilité, Paris, CNRS, 2018 ; compte rendu de Jean Zaganiaris pour Lectures : https://doi.org/10.4000/lectures.25839.
10 Christin Olivier (dir.), Républiques et républicanismes. Les cheminements de la liberté, Lormont, Le Bord de l’eau, 2019 ; compte rendu de Tristan Boursier pour Lectures : https://doi.org/10.4000/lectures.32759.