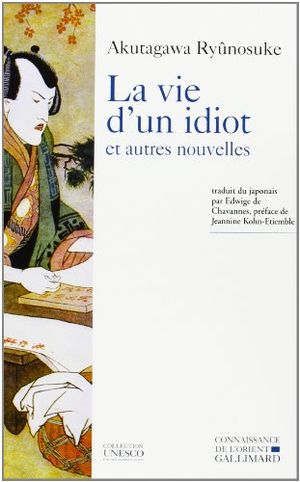Chronique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2016/09/la-vie-d-un-idiot-et-autres-nouvelles-d-akutagawa-ryunosuke.html
Akutagawa Ryûnosuke est à n’en pas douter un des très grands noms de la littérature japonaise contemporaine – ce qui va bien au-delà du prix qui porte son nom, créé après sa mort précoce par un ami écrivain, Kikuchi Kan, et dont on fait régulièrement, à plus ou moins bon droit sans doute, le « Goncourt japonais » ; c’est bien, on le dit souvent, le prix littéraire japonais le plus prestigieux – notons cependant qu’il a un domaine particulier, visant à récompenser essentiellement des œuvres brèves. Or Akutagawa était bien un spécialiste de la forme courte, connu essentiellement pour ses nombreuses nouvelles (il n’a jamais écrit de roman, sauf erreur), mais on lui doit aussi des haïkus sous le pseudonyme de Gaki.
Il a, dans ces registres, livré une œuvre finalement très diverse, pourtant toujours personnelle, ainsi qu’en témoigne tout particulièrement ce recueil intitulé La Vie d’un idiot et autres nouvelles, plus ou moins conçu comme un complément à Rashômon et autres contes, dans la même collection, qui comprend sans doute ses récits les plus célèbres (dont « Rashômon » et surtout « Dans le fourré » ayant inspiré le Rashômon de Kurosawa Akira, mais on peut relever aussi, par exemple, « Le Nez » ou « Gruau d’ignames », qui ont beaucoup contribué à sa gloire au Japon, et je ne peux m’empêcher de mettre en avant de ses incroyables récits louchant sur le fantastique, comme « Figures infernales » ou encore « Les Kappas »).
Toutefois, cette nature de « complément » ne doit pas nous tromper – on aurait sans doute bien tort d’y voir une compilation de textes de second ordre, un bon cran en dessous du « best of » que serait Rashômon et autres contes. Bon, il y a peut-être un tout petit peu de ça quand même… Mais le présent recueil demeure nettement au-dessus du lot, et les textes qui y sont compilés sont tout à fait bons, voire excellents, toute comparaison à part, et j’y relève au moins un chef-d’œuvre (« Lande Morte », qui va me faire m’extasier abondamment tout à l’heure), et probablement d’autres encore.
En fait, la véritable singularité de ce recueil est ailleurs, à mon sens – qui lui confère sans doute un aspect « documentaire », mais là encore au fil de textes très bons pour eux-mêmes, et pas seulement pour ce qu’ils nous apprennent de l’auteur. En effet, cette compilation balaye toute la carrière d’Akutagawa, dans l’ordre chronologique, partant d’un texte de jeunesse (caractère flagrant…) pour s’achever avec deux textes posthumes, composés peu avant le suicide de l’auteur, et dont le caractère morbide a quelque chose d’étouffant et d’immensément douloureux, sans pour autant nuire à la valeur littéraire des textes en question, immense (je dis « textes » et non « nouvelles » car, quoi que le titre global puisse laisser supposer, « La Vie d’un idiot » ne me paraît pas relever du genre nouvelle – bien plutôt de la poésie, en fait ; à vrai dire, la part essentielle d’autobiographie dans plusieurs des textes qui précèdent pourrait éventuellement, elle aussi, légitimer une critique de l’emploi de ce qualificatif, mais c’est davantage à débattre).
Au-delà, ce voyage au fil d’une brève mais intense carrière est l’occasion d’apprécier les goûts comme les divergences de l’auteur ; un trait essentiel du personnage comme de son art est sans doute la bascule inconfortable entre la culture japonaise classique, qu’il connaît bien et apprécie sans succomber à la tentation passéiste, et les cultures occidentales qui, suite aux bouleversements de l’ère Meiji, imprègnent de plus en plus la vie japonaise, quotidienne comme intellectuelle, et pour lesquelles il a un goût marqué, citant notamment à tour de bras des auteurs européens qu’il admire par-dessus tout (anglais – il en était professeur –, allemands, français…). « La vie humaine ne vaut pas même une ligne de Baudelaire ! », nous dit-il ici… Ce déchirement fondamental se double sans doute d’un autre, qui est donc le rapport ambigu au passé, sous la perspective des règles de l’art – l’écrivain prisant fort les récits « historiques », contre les mœurs « naturalistes » de son temps, dans sa classe tout du moins (cela passe même régulièrement par l’adaptation moderne de contes parfois fort anciens), mais se livrant enfin dans des récits « réalistes » et « intimes », mettant l’accent sur le réel et la subjectivité de l’auteur exprimant et questionnant son propre vécu…
Dans tous ces possibles, cependant, demeure la présence de l’écrivain Akutagawa – et d’autant plus quand il questionne son art, dont il voudrait faire un rempart contre l’absurdité et la médiocrité menaçante du monde… Tentative prégnante, mais sans doute vouée à l’échec, hélas – la douleur, la peur, la honte, l’emportent en fin de compte, et l’écrivain, oppressé par cette « vague inquiétude » permanente (l’explication qu’il avait laissée des raisons de son suicide – Maruo Suehiro l’évoquait dans son adaptation en manga de L’Île panorama, d’Edogawa Ranpo, dont je vous avais parlé récemment), prend sa vie insupportable…
Mais décortiquons maintenant un peu ce recueil…
L’EAU DU FLEUVE
« L’Eau du fleuve » (« Ôkawa no mizu », 1912) est vraiment un texte de jeunesse – l’auteur a vingt ans, et ça se sent… Ce texte dénué de récit, à la limite du poème en prose, loue les eaux d’un fleuve de Tokyo, en vibrant de romantisme. L’auteur y fait ses gammes, oui : le texte est d’une affectation indéniable, et Akutagawa cite à tours de bras tout ce qu’il aime – que ce soit dans la culture japonaise ou occidentale (allant jusqu’à garder les mots « Stimmung » ou « lifelike » dans le texte). C’est surtout là en fait ce qui est le plus intéressant – pas pour le texte pour lui-même (ça lui est sans doute plutôt préjudiciable), mais pour ce qu’il révèle des passions de son jeune auteur déchiré entre deux mondes. Mais il faut sans doute relever aussi le caractère très positif et sans ambiguïtés du texte – ça ne sera pas toujours le cas par la suite… Petit pincement au cœur, d’ailleurs, à la lecture de la dernière phrase : « C’est parce que le fleuve existe que j’aime Tôkyô ; c’est parce que Tôkyô existe que j’aime la vie. »
UN JOUR, ÔISHI KURANOSUKE
Suit, avec un décalage de cinq années, « Un jour, Ôishi Kuranosuke » (« Aru hi no Ôishi Kuranosuke », 1917), et là c’est de suite autre chose – avec un auteur qui s’affirme, notamment en ce qu’il aime à puiser dans l’histoire, quoi qu’en disent les naturalistes d’alors, pour qui le réel immédiat, le vécu de l’auteur lui-même, est la seule voie envisageable.
Il s’agit d’une variation sur le thème des 47 rônin, authentiques personnages ayant depuis le tout début du XVIIIe siècle, époque de leur exploit, constitué l’exemple ultime, le modèle indépassable, de l’honneur et de la loyauté au sens de la culture nippone – on y est sans cesse revenu, et on y revient encore.
Mais Akutagawa, alors, est déjà plus enclin à se pencher sur les difficultés éthiques que ce thème peut soulever – comme dans bien d’autres de ses textes. C’est peut-être l’occasion d’afficher la vanité de revenir en arrière, aussi séduisant cela peut-il paraître ? L’idée est probablement là, d’un passé qui n’a absolument rien de préférable au présent.
Quoi qu’il en soit, nos rônin viennent de commettre leur légendaire vengeance, et sont assignés à résidence en attendant que le shogun décide de leur sort – autant dire de les condamner à mort, cela ne fait aucun doute. Les rônin, d’une certaine manière, se la coulent douce… L’atmosphère est assez décontractée ; on rit…
Pourtant, Ôishi Kuranosuke, qui n’est pas le moindre des 47, sombre peu à peu dans la morosité ; cela commence quand il apprend que les habitants d’Edo (future Tokyo), et notamment parmi les gens du commun, prisent tant leur extraordinaire accomplissement qu’ils en viennent à le copier – suscitant vengeance après vengeance, à l’échelle d’une boutique ou d’une banale altercation dans la rue… Par ailleurs, Ôishi Kuronasuke ne cesse de penser à ces autres rônin, généralement de plus haute naissance, qui, pour faire partie du même clan, ne les ont pourtant pas suivis dans leur entreprise de vengeance – ce dont il fait la remarque… mais pour aussitôt être gêné par la haine à leur encontre que manifestent ses complices – lui voulait seulement prendre en pitié les parjures, ou du moins est-ce ce qu’il leur confie enfin… Et les louanges qu’on lui adresse pour son astuce, à lui le brave rônin qui, pour tromper ses ennemis, a simulé une vie de débauche bien loin de tout désir de vengeance, contribuent encore plus à son malaise – questionnant ses actes et ses motivations, en envisageant peut-être d’un autre œil, après coup, cette vie factice de décadence, qui n’était pas sans attraits, d’autant plus en regard de cette vengeance que les mœurs leur imposaient mais qui n’en était pas moins absurde, peut-être…
C’est un très beau texte, d’une immense subtilité, d’une finesse psychologique admirable.
LANDE MORTE
Mais c’est encore plus vrai du texte qui suit immédiatement, « Lande morte » (« Kareno-shô », 1918) que l’on peut d’ailleurs lier au précédent et à un autre texte encore, « L’Illumination créatrice », lui aussi excellent, et qui figure dans Rashômon et autres contes ; cette fois, je n’hésite pas à parler de chef-d’œuvre : c’est une nouvelle bouleversante, et qui m’a fasciné autant qu’elle m’a pris aux tripes.
Ce qui n’était pas gagné eu égard à son thème, pourtant : la mort du poète Bashô, entouré de ses disciples… Akutagawa, ou Gaki, on le sait, prisait tout particulièrement l’œuvre de Bashô, et y est sans cesse revenu – notamment vers sa fin, il en avait fait alors un nécessaire « compagnon de route ». Ceci étant, nul besoin d’apprécier les haïkus (ouf) pour admirer ce superbe tableau de l’agonie du poète, mais plus encore du trouble de ses disciples ; car chacun d’entre eux, au moment d’humecter d’eau les lèvres du maître mourant, comme la tradition l’exige, en vient à questionner ses propres motifs…
Leur attitude à l’heure fatale n’a en effet rien de la douleur théâtralisée qu’ils supposaient, ou de la « douleur infinie » que relèveront immanquablement les chroniqueurs enregistrant leurs actes aux yeux de l’histoire. L’un s’aperçoit avec stupeur qu’il ne ressent qu’indifférence ; un autre, à la probité par ailleurs indéniable, se rend compte qu’il a bien davantage en tête toute l’activité dont il a fait preuve en cette heure terrible, plutôt que la réalité de la mort frappant son maître – et, pire encore, il en tire une indéniable vanité… Celui-ci, qui s’est toujours dissimulé derrière un masque insolent de cynisme, joue une dernière fois sa partition – mais la façade n’en est que plus sensible et stérile ; celui-là, confronté à la mort du maître, n’y songe pas autrement que sous la forme d’un présage de sa propre mort – et c’est bien cela qui l’amène à pleurer, l’anticipation de sa fin, non celle du vieillard vérolé qui s’éteint doucement à côté de lui… Et il y a Jôsô, qui découvre ébahi que la mort du maître le libère du poids écrasant de son aura, et fait enfin de lui un homme libre.
Jôsô est probablement celui que l’on peut le plus rapprocher d’Akutagawa lui-même, dans ce texte qui fut clairement inspiré par la mort (1916) de Natsume Sôseki, son propre maître (qu’il faudra bien que je lise un jour…). Il reviendra d’ailleurs sur ce thème dans « Engrenage » et plus encore « La Vie d’un idiot », plus loin dans le recueil.
Il y a là une lucidité et une finesse qui n’appartiennent qu’aux plus grands écrivains – autant dire ceux qui s’émancipent ? C’est bien une très puissante esquisse de la douleur et de l’inconscient (thème important de l’auteur, qu’il emploie le terme freudien ou pas). Et cette nouvelle excursion historique questionnant les motifs de tout un chacun, comme « Un jour, Oîshi Kuranosuke », déploie en définitive une ironie tragique qui n’est pourtant pas entièrement dénuée d’aspects lumineux… Un texte extraordinaire – vraiment : d’une intelligence et d’une sensibilité bouleversantes.
LES MANDARINES
« Les Mandarines » (« Mikan », 1919) a beau être très bref, c’est un texte significatif d’une évolution essentielle. Akutagawa y délaisse l’histoire (éventuellement « mythique ») pour revenir à son quotidien, et probablement à lui-même et à sa subjectivité tant qu’à faire, ne serait-ce que pour un récit affichant son caractère anecdotique (et d’autant plus important ?).
C’est une brève scène dans un train, où un narrateur qui pourrait sans doute être l’auteur, las d’un monde qui l’ennuie, et méprisant par défaut, s’agace de la présence dans son compartiment d’une fillette évidemment pauvre et d’une allure qui le répugne. Le comportement envahissant de la fillette va pourtant le conduire à une épiphanie muette – et peut-être le ramener au monde.
C’est, comme sans doute la plupart des textes qui suivent, bien plus subtil que ça n’en a l’air, et d’une indéniable beauté formelle, même si elle est bien différente du chatoiement des textes « historiques » qui précèdent. Pour autant, si c’est bon, ça ne me fascine pas, je plaide coupable… Plus loin dans le recueil, cette approche donnera des choses plus hardies, mais éventuellement plus séduisantes à mon goût.
LE BAL
« Le Bal » (« Butôkai », 1919) retourne pourtant un peu à la manière « historique », même si c’est dans un cadre bien plus récent – le Japon de Meiji – et pas du tout « mythique » (ou bien… ?).
Nous y suivons une jeune femme se rendant à un bal, à Tokyo, dans un Japon de la haute passablement européanisé ; elle y danse avec un officier français… qui s’avère en définitive être Pierre Loti.
En fait, la nouvelle d’Akutagawa est directement liée à une nouvelle de Loti, « Un bal à Yedo », semble-t-il passablement méchante, et en tout cas ironique, pour ce Japon le cul entre deux chaises, et prompt à priser ce qui vient d’ailleurs. N’ayant pas lu cette nouvelle, une bonne dose de l’ironie de la réponse d’Akutagawa m’échappe forcément – à vrai dire, pour vraiment apprécier la nouvelle, sans doute faudrait-il aller au-delà, et connaître non seulement cette nouvelle de Pierre Loti, mais aussi le reste de son œuvre, et probablement sa vie tout autant… J’ai ce sentiment du moins – et comme je suis ignare…
En l’état la nouvelle n’est toutefois pas sans charme – la présentation relève son affectation, mais elle me paraît à propos, et elle ne saute pas à la gueule comme dans « L’Eau du fleuve » ; quant aux paillettes dans les yeux de la danseuse, a fortiori si on y ajoute la « révélation » finale, elles font sens à leur manière.
Je relève aussi, dans ce texte où l’on devine la déception nécessaire sous la joliesse du moment présent et de sa « mythification » après coup (tout compte fait…), la mention dès la première page d’une « vague inquiétude » étreignant la jeune fille – or c’est ainsi que l’on traduit en français la note d’Akutagawa expliquant son suicide, quelques années plus tard… Je ne sais pas toutefois si les expressions japonaises sont équivalentes. Quoi qu’il en soit, la « vague inquiétude » imprègne bien ce texte aux abords pourtant souriants…
Bien aimé.
EXTRAITS DU CARNET DE NOTES DE YASUKICHI
Mais le recueil prend alors une orientation plus marquée, dans la foulée du prélude constitué par « Les Mandarines », mais sur un mode un peu plus ample – mais faussement, peut-être, car en jouant de la succession de brèves saynètes très « tranches de vie », où il ne se passe pas forcément grand-chose, l’idée étant de faire surgir malgré tout quelque chose de ce rien, dans un cadre contemporain où s’exprime la subjectivité de l’auteur ; à une époque par ailleurs où il écrit semble-t-il moins de fictions, mais se pose d’oppressantes questions d’ordre théorique. L’autobiographie y a un rôle essentiel, plus ou moins déguisé tout d’abord, mais de moins en moins par la suite.
C’est tout d’abord le cas de « Extraits du carnet de notes de Yasukichi » (« Yasukichi no techô kara », 1923). Yasukichi, qui enseigne l’anglais dans une école rattachée à l’armée de mer, s’ennuie, comme de juste ; à bien des égards, on peut sans doute y voir l’auteur (qui, si j’ai bien compris, a alors livré plusieurs de ces textes « Yasukichi »).
Se succèdent ici cinq brèves anecdotes rapportant son morne quotidien, les gens qu’il croise, leurs bassesses et grandeurs, ou plus probablement leur insignifiance – encore que… Non sans humour, à l’occasion – éventuellement un peu tordu. Non sans colère aussi – un caractère qui tendra à s’amenuiser par la suite, quand la peur et la honte l’emporteront…
Mais je ne peux pas prétendre que ça m’ait emballé plus que ça, si la plume est belle, et si les portraits sont fins.
BORD DE MER
Dans ce goût-là, « Bord de mer » (« Umi no hotori », 1925), m’a étrangement davantage séduit. Le mode est assez proche, mais la façon peut-être plus radicale – la dimension de « récit » s’amenuise encore dans les saynètes, il y a comme une affirmation parfaitement assumée de ce que « rien ne se passe », un néant évoqué avec une « touche lente », pour reprendre deux expressions figurant dans la brève présentation de la nouvelle.
C’est étonnamment plus souriant, aussi – du moins, j’ai eu cette impression passablement bizarre ; qui vient sans doute de la relative sérénité qui se dégage des esquisses ? Là où Yasukichi cédait éventuellement au mépris en sus de la morosité, il y a ici quelque chose de plus détaché et aimable, chez ce narrateur qu’on assimile plus que jamais à Akutagawa, et qui dissimule à peine ses amis et collègues sous des initiales…
La présentation relie pourtant la rédaction de ce texte au traumatisme du grand tremblement de terre du Kantô (1923) – qui a anéanti Tokyo, laquelle a été rebâtie très vite sur un mode plus « moderne » et occidental. Mais c’est une dimension qui me dépasse totalement à la seule lecture de ces saynètes en bord de mer…
ENGRENAGE
Les textes qui précèdent immédiatement, globalement, m’ont moins séduit que les récits « historiques » qui précédaient. Mais cette nouvelle manière est parachevée dans les deux derniers textes, dont la superbe a quelque chose de profondément douloureux voire gênant – il s’agit de textes posthumes, imprégnés de bout en bout du désir de suicide… C’est l’expression de la douleur d’un homme obsédé par la mort, au point de l’accueillir comme un soulagement nécessaire – terrible, mais inévitable. Il en livre donc un double récit terriblement frontal, d’abord sur un mode assez proche des deux textes qui précèdent, ensuite dans une tout autre veine relevant plutôt de la poésie, évoquant la pente inéluctable qui le conduit à mettre de lui-même un terme à une vie devenue impossible – à moins qu’elle l’ait toujours été. Lugubre et tragique…
« Engrenage » (« Haguruma », 1927, publication posthume) poursuit, au moins sur le plan formel, l’approche de « Extraits du carnet de notes de Yasukichi » et de « Bord de mer », mais l’effet est tout autre ; si, comme dans ce dernier, Akutagawa ne se déguise plus vraiment, écrivant à la première personne et semant son texte d’allusions à son œuvre (la rédaction des « Kappas », par exemple) ou à ses proches, le sentiment produit est on ne peut plus différent. À tort ou à raison, j’avais perçu dans « Bord de mer » une étonnante sérénité, une forme de détachement éventuellement lumineuse… Mais ici, c’est la douleur qui domine (la colère de « Yasukichi » n’est plus de mise elle non plus) – suscitée par la peur et l’identification.
Le texte s’ouvre peu ou prou sur le suicide du mari de la sœur de l’auteur, qui le teinte d’emblée de noir et de blanc – couleurs du deuil qui l’obsèdent, comme l’obsèdent mille autres choses insignifiantes, autant de détails du quotidien qui prennent pour lui la forme de sinistres augures de son inéluctable sortie. On a pu parler d’hallucinations – au caractère limite fantastique, d’ailleurs, ainsi avec cet inconnu en manteau de pluie qui pourrait être un fantôme… Mais tout constitue une menace – l’auteur est bien pris dans un engrenage de significations outrées, et sans doute est-il conscient à sa manière de ce caractère, mais il s’abandonne bel et bien au mécanisme suicidaire.
Texte terrible, à la conclusion sans appel : « Je n’ai plus la force de continuer à écrire. Vivre dans ces conditions m’est devenu une souffrance intolérable. Ah ! Si quelqu’un pouvait avoir le geste de m’étrangler tout doucement pendant mon sommeil… »
Au-delà, « Engrenage » n’est pas un document, un cas clinique : c’est un récit subtil et poignant, pleinement littéraire – au sens où il a bien plus qu’une « simple » valeur de témoignage.
LA VIE D’UN IDIOT
C’est sans doute encore plus vrai de l’ultime texte, « La Vie d’un idiot » (« Aru ahô no isshô », 1927, publication posthume – il s’agit d’un texte figurant dans une dernière lettre à un ami, Kume Masao, lui laissant le douloureux choix de la publication ou pas…).
Le titre du recueil ne doit pas nous tromper : cette dernière œuvre relève bien plus de la poésie que de la prose. Il s’agit d’une série de 51 brèves vignettes composées peu avant la fin, et ne laissant aucun doute la concernant (la dernière de ces vignettes, intitulée « Défaite », va jusqu’à mentionner le Véronal dont il fera une overdose…). Il s’agit là encore d’une variation sur l’autobiographie (retour à la troisième personne, étrangement ou pas), mais qui délaisse le rendu prosaïque du moment présent, dans une suite d’anecdotes élaborées, pour envisager la vie entière de l’auteur au travers d’instantanés, avec le recul d’un philosophe et la plume d’un poète – éventuellement d’un Bashô, qui l’a donc, semble-t-il, beaucoup « accompagné » dans ses derniers moments. La forme de ces miniatures peut certes évoquer le haïku, mais avec un effet bien différent sur votre serviteur…
Le texte pourrait être d’un auto-apitoiement insupportable – tentation qui sourd déjà dans « Engrenage », forcément ; mais il y a pourtant bien plus : une authentique valeur poétique, qui transcende les anecdotes et souvenirs ; le prisme est bien sûr douloureux et tragique, mais la force demeure.
Le texte renseigne en outre sur les obsessions névrotiques de l’auteur, et tout particulièrement son complexe de la folie : fils de la folle fréquentant la fille de la folle, il se voit marqué du sceau du destin, le condamnant à de lugubres séjours dans de terrifiants hôpitaux psychiatriques… L’ascendance en la matière impose sa griffe très vite, et ne lâche plus l’auteur.
Tout n’est cependant pas morose dans ce dernier témoignage – il y a des moments lumineux, quand par exemple l’auteur rencontre son maître Natsume Sôseki… ou que ce dernier décède, ce qui renvoie au soulagement de Jôsô dans « Lande morte » ; ou encore quand il apprend la peinture via Van Gogh, ou plus largement l’art et la beauté en contemplant un banal objet de cuisine…
Oui, l’art, sous toutes ses formes, y a une place essentielle. On aurait pu l’espérer salvatrice… mais ce n’est pas le cas. Au-delà, la souffrance et la honte, suscitant parfois la colère (« Mais lui savait fort bien quelles étaient les racines de son mal : la honte de soi et la peur des autres ; les autres... – cette société qu'il méprisait ! »), et le grand tremblement de terre du Kantô est bien une occasion de choix pour exprimer cette haine des autres fondée sur le dégoût de soi. C’est qu’il a toujours la conviction d’être en dessous de tout, de ne pas être assez bon époux ou père ou écrivain…
C’est aussi beau qu’insupportable.
CONCLUSION
Recueil étonnant et enrichissant, bouleversant aussi au point où c’en est douloureux, La Vie d’un idiot et autres nouvelles propose de nouveaux aperçus de la vie et de l’œuvre d’Akutagawa Ryûnosuke, qui ne s’est certes pas arrêté aux brillantes nouvelles composant Rashômon et autres contes. Il faut cependant prendre en compte cette dimension très éprouvante – qui, forcément, ne m’a pas laissé indifférent…
J’ai encore deux recueils d’Akutagawa dans ma bibliothèque de chevet, La Magicienne et Jambes de cheval ; ça viendra, ça viendra…