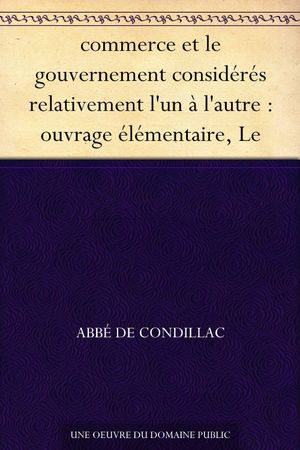Dans la veine de la philosophie empiriste des sciences dont il fut le principal représentant français, Condillac utilise une méthode purement hypothético-déductive pour son traité d'économie. Il pose des hypothèses simplifiées (une peuplade imaginaire partant de rien...) et explique, par déductions logiques et empiriques, les mécanismes par lesquels l'économie se développe, comment la liberté engendre l'égalité et la prospérité (Première partie) et ce qu'il se passerait si elle était entravée de différentes manières (Seconde partie). On lui a reproché cette méthodologie (J-B.Say, notamment). Néanmoins, loin d'être dénuée d'intérêt, elle porte en elle, malgré ses limites, une puissance explicative qui permet de discerner les causes et les effets au delà des contingences du moment qui embrument la compréhension. En outre, il ne faut pas oublier que dans l'esprit de l'auteur, il s'agit d'un ouvrage de vulgarisation.
Grâce aux intuitions lumineuses de Condillac, cette méthode prouve d'ailleurs son efficacité à l'examen des faits, puisque sur une multitude de points, ses analyses sont étonnamment prémonitoires. On peut citer entre autres exemple les problèmes monétaires ou les problèmes de la dette, mais Condillac fait également une analyse parfaitement lucide de la question des impôts, du libre-échange, de l'opinion publique (on vire presque dans la sociologie) et de biens d'autres thèmes. Comme il le dit lui-même avec cette phrase paradoxale :
En vérité les suppositions les moins vraisemblables que j’ai faites sont plus vraisemblables que bien des faits.
Si sur certains points de détails, Condillac fait quelques erreurs, ou bien analyse des problèmes qui ne sont plus d'actualité (avec un vocabulaire souvent désuet), on lui en tiendra difficilement rigueur, car il s'agissait à l'époque des balbutiements de la discipline économique. On rappellera d'ailleurs qu'Adam Smith n'avait pas encore publié La Richesse des nations, ouvrage qui lui aussi n'était pas exempt d'erreurs, notamment sur la question de la valeur, sur laquelle Condillac était largement en avance par rapport Smith. On sera même surpris de voir à quel point Condillac préfigure le marginalisme. Il y a déjà presque tout : subjectivité de la valeur fondée sur l'utilité, échange comme jeu à somme positive, une esquisse d'utilité marginale par ce que Condillac appelle le "surabondant", etc.
D'autre part, en montrant comment l'interventionnisme crée un problème qui doit être résolu par une autre intervention qui elle-même engendre un nouveau problème et ainsi de suite — en somme, comment l'interventionnisme mène in fine au chaos et à la dictature — l'ouvrage de Condillac n'est pas sans rappeler La Route de la servitude : à l'instar de Hayek, le propos de Condillac est de montrer comment le gouvernement trouble l'ordre spontané qui résulte de la liberté.
Si l'oeuvre a quelque peu vieilli, elle reste véritablement un classique (trop souvent occultée par Smith) pour tout passionné d'économie.